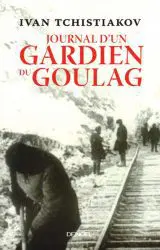Selon Irina Shcherbakova, qui signe l’introduction de ce livre, « le journal d’Ivan Tchistiakov […] est probablement le seul document de ce genre qui nous est parvenu, un témoignage historique unique ». Comment, en effet, cacher un tel objet de subversion dans un univers terrifiant où le bourreau d’hier peut devenir la victime d’aujourd’hui et inversement ? On pense en effet au récit d’Evguénia S. Guinzbourg, détenue à Kolyma à partir de 1939, qui partagea un morceau de pain avec celui qui l’avait jadis arrêtée et torturée. Déjà en 1935-1936, juste avant les Grandes Purges, au moment où Tchistiakov rédige son journal, tout est objet de suspicion, et c’est pour cette raison que n’importe quel document – lettres, carnet, agenda – est systématiquement détruit par son possesseur. Et puis, après cette époque noire, personne ne se vantera d’avoir fait partie du clan des bourreaux…
Que dit un gardien de camp de son travail ? Est-il capable de sympathie à l’égard des détenus ? La position de Tchistiakov est ambiguë, et montre à quel point les limites entre victimes et persécuteurs étaient floues dans le système concentrationnaire soviétique. Les conditions dans lesquelles vivent les gardiens sont terribles, et bien qu’ils ne meurent pas d’épuisement et de faim comme les prisonniers, ils souffrent de maux assez semblables aux leurs (à un degré moindre, évidemment). Comme le répète Tchistiakov, les gradés du camp, qui se goinfrent du pain d’autrui, se soucient peu de son confort et de celui des tirailleurs qu’il commande : il dort comme eux dans des cabanes où règne un froid tel que l’encre gèle, il ne mange pas assez, menace de souffrir de scorbut et de tuberculose, endure des rhumatismes, marche quotidiennement trente ou quarante kilomètres avec des bottes trouées. Au début du journal, qui commence à l’automne, Tchistiakov est horrifié. C’est un Moscovite pétri de culture et ingénieur de son état. Propulsé malgré lui dans un rôle qu’il ne veut pas jouer – à cause d’une faute qu’il aurait commise mais qu’il ignore lui-même –, il est en effet horrifié par sa propre situation, mais aussi par celle des prisonniers dont il comprend les innombrables tentatives d’évasion, vaines tentatives dans l’espace illimité, inhospitalier de la Sibérie. Cependant, il n’est pas absolument sympathique à leur cause puisque, selon lui, ils sont coupables d’actes anti-soviétiques. Mais sa foi à l’égard du régime n’est pas claire : le journal est en soi un geste de révolte.
Bien vite au cours des mois qui suivent s’installe l’indifférence qu’il redoutait tant, puis le désespoir lui devient tellement insoutenable que tout ce qui risque d’empirer son cas (de lui faire subir un procès pour négligence dans ses fonctions) le rend agressif, pour ne pas dire sans pitié. Ces « z/k » ne sont-ils pas en plus responsables de ses propres malheurs ? « Une évasion à l’isoloir de la 11. Ces salauds, il faudrait en fusiller quelques-uns pour l’exemple, mais chez nous on les dorlote. » En même temps, il est si désespéré qu’il finit par souhaiter qu’on l’arrête ; une issue plus intéressante que le suicide, qui l’obsède.
Humain, trop humain.