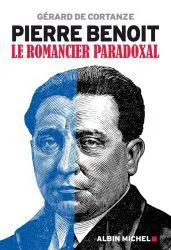« Pierre Benoit n’a pas écrit pour les snobs ni même pour la critique littéraire ; il écrivait pour les lecteurs, sans autre but, sans autre prétention que de leur raconter de belles histoires. […] Certains critiques lui ont reproché d’écrire trop vite et même très mal. C’étaient sans doute des gens qui écrivaient bien, sans que personne ne l’eût jamais remarqué… »
Marcel Pagnol
À quoi tient qu’un des auteurs français les plus lus de son temps ait sombré de nos jours dans l’oubli ? Pierre Benoit fait l’objet d’une fascinante biographie dont le maître d’œuvre est Gérard de Cortanze1. Spécialiste reconnu pour ses travaux sur Auster, Hemingway ou Borgès, le biographe se frotte cette fois au cas du romancier paradoxal qu’est à ses yeux Pierre Benoit. La publication de cet ouvrage chez Albin Michel coïncide avec la réédition de romans comptant parmi les plus importants de l’auteur :
 Mademoiselle de la Ferté2, La châtelaine du Liban3et Axelle4.
Mademoiselle de la Ferté2, La châtelaine du Liban3et Axelle4.
Les années maghébines
Né en 1886, Pierre Benoit quitte tout jeune la France pour accompagner son père, muté en Tunisie dès 1891. Un roman comme La châtelaine du Liban éveille d’ailleurs des réminiscences d’une enfance toujours en mouvement, traînée de garnison en garnison. À six ans, « j’avais imaginé que je possédais une maison à roulettes et que je me promenais de la sorte à travers le monde. Voyager, c’était alors mon rêve5 », dira-t-il. Jeune écrivain en formation, Pierre Benoit enjolivait la Tunisie de son enfance, en en cristallisant les plus beaux moments. Il conçoit lui-même le caractère déterminant de sa jeunesse au Maghreb : « Tout mon effort n’aura consisté qu’à mettre en valeur les trésors accumulés, à mon insu, durant mon enfance6 ».
Mondanités littéraires
Il rentre en France à 22 ans. Rastignac ambitieux, il y fera vite des rencontres décisives, se liant avec des auteurs pour qui il voue une grande admiration, comme la comtesse de Noailles ou Maurice Barrès. Le jeune homme mène alors la grande vie parmi les littérateurs célèbres de l’époque : Giraudoux, Henry Bataille, Larguier, Carco. Homme à femmes, il ira même jusqu’à élaborer un subterfuge pour échapper à une Fernande trop encombrante : otage bien volontaire, il simule son propre enlèvement, invoquant le Sinn Féin dans le seul but réel de folâtrer avec ses maîtresses.
La Grande Guerre et Axelle
1914. Mobilisé au front, il connaît le frisson des tranchées. « C’est le règne du silence et de la mort. Nous y craignons la pluie, parce qu’elle fait ébouler les pauvres tombes qui nous entourent, et laisse à nu de tristes spectres7. » Malade, il est évacué vers un hôpital militaire où, convalescent, il se remettra à l’écriture. Son premier roman, Kœnigsmark, est refusé par une dizaine d’éditeurs avant de paraître d’abord en feuilleton dans Le Mercure de France. Son entrée à la maison Albin Michel, qui cherche de nouveaux auteurs, est  ressentie comme un baume. Le roman, paru le jour même de l’armistice, obtient un succès populaire immédiat que n’a pas démenti l’accueil enthousiaste réservé à son deuxième roman, L’Atlantide. Pierre Benoit rate de peu cette année-là son rendez-vous avec le Goncourt.
ressentie comme un baume. Le roman, paru le jour même de l’armistice, obtient un succès populaire immédiat que n’a pas démenti l’accueil enthousiaste réservé à son deuxième roman, L’Atlantide. Pierre Benoit rate de peu cette année-là son rendez-vous avec le Goncourt.
« Un Français, une Prussienne. » Juxtaposés dans l’Allemagne vaincue de 1918, ces mots résument aux yeux d’Axelle qui les prononce une trame inextricable. Compte tenu du contexte politique de l’entre-deux-guerres, on a reproché à Pierre Benoit de proposer avec le roman Axelle un hymne à la gloire allemande jugé indélicat. Le roman connut néanmoins à sa sortie au printemps de 1928 un retentissant succès commercial. Si les circonstances martiales sont datées dans Axelle, le canevas, intemporel, est quant à lui classique, telle une tragédie racinienne.
Figure féminine empruntée au romantisme, Axelle est de ces personnages à la rêverie morne. Promise en raison d’alliances historiques au commandant Dietrich, de la glorieuse famille Reichendorf, Axelle est liée par son destin à l’histoire de la Prusse la plus orgueilleuse. Quand entre les murs du château Reichendorf, fouetté par les vents de la froide Baltique, est admis le jeune réprouvé français Pierre Dumaine, un tremblement imprévu dans le cadre de vie tout planifié de la belle Allemande finit par la secouer intimement. Axelle revisite le Sturm und Drang par un déchirant tiraillement des amoureux déçus. Il est clair que ce roman témoigne d’une germanophilie qui sera du reste reprochée ouvertement à Pierre Benoit…
Si les tirages des premiers romans de Pierre Benoit sont fabuleux, l’accueil critique est plus frileux. Son principal détracteur, Paul Souday (critique au Temps), s’en prend surtout aux affinités politiques de l’homme de droite. Comme nul n’est prophète en son pays, son succès provoque des ressacs de jalousie : on l’accuse même de plagiat. L’Atlantide rappelle trop fortement pour certains le She de sir Ridder Haggard, alors que le livre n’existe pourtant pas encore en traduction française et que Pierre Benoit ne lit pas l’anglais. Encore Souday : « De tels bouquins ne se lisent que dans les trains », faisant référence méchamment à la littérature de gare. Benoit, bon joueur, rétorque : « Dieu merci, on me lit aussi dans le métro ! »
Le travail de recherche est ce qui le passionne le plus lors de la construction d’un roman. Il se documente longuement avant d’entreprendre l’écriture du texte dans son appartement de la rue Raspail, ce qui lui confère en quelque sorte, par son engagement entier, l’attitude d’un journaliste. À cet égard, ses romans tiennent moins d’un projet aux clinquantes parures exotiques que d’un portrait juste du monde dans lequel il vit. Comme Benoit l’a dit lui-même : « Le devoir d’un romancier, c’est d’être de son temps ». Le Journal l’embauche justement en tant que grand reporter et le dépêche aussitôt en Turquie. Il aura tôt fait de devenir « [l]e grand observateur critique des désordres du monde et de ses absurdités8 ». Pierre Benoit pourra non seulement écrire des aventures mais les vivre en vrai. Président pendant une brève année de la Société des gens de lettres de France, ce titre aura été, pensent certains, « une sorte de tremplin vers des honneurs plus hauts et plus durables9 », comme cette élection à l’Académie française à l’âge de 46 ans.
Les années de déchéances
En 1940, pendant que les lignes françaises se faisaient enfoncer de toutes parts, lui songeait à voyager, à écrire pour échapper au drame… Son attitude, alors que la France sera sous la botte nazie, lui coûtera cher au moment de la Libération.
Au lendemain de la guerre, c’est un Pierre Benoit meurtri qui est incarcéré, car l’heure est à la vengeance et à la dénonciation. Les journaux veulent des têtes, comme celle de Pierre Benoit, accablé par le poids des qu’en-dira-t-on. Bien que rien n’ait pu être prouvé contre lui, il figure sur la liste noire du Comité national des écrivains, lui à qui l’on prête certaines sympathies avec l’oppresseur. Finalement, on invoque le motif courant d’intelligence avec l’ennemi pour l’inculper « d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État ». Son incarcération dans la misère profonde de la prison de Fresnes le marquera à jamais. À sa sortie, il est interdit de publication en France pendant deux ans. Même si officiellement il est blanchi, Benoit est marqué du sceau de l’opprobre. Ne se trouvera-t-il pas toujours un ennemi pour brandir le spectre du collabo au détour d’un article, d’un entretien ? Sans doute n’aidera-t-il pas sa cause lorsqu’il prononcera l’oraison funèbre du maréchal Pétain en 1951…
L’apparition du Livre de poche en 1953 insufflera une vie nouvelle aux œuvres de Pierre Benoit. Son Kœnigsmark inaugure la collection. Il sera suivi d’autres titres populaires, dont Mademoiselle de la Ferté. Eric-Emmanuel Schmitt, qui signe la préface de la réédition de 2012 de ce roman, l’affirme en connaissance de cause : le milieu littéraire n’aime pas le succès. Il tire cette conclusion de la réception critique de l’œuvre de cet écrivain qui aura eu « l’indécence de plaire au public de son temps ». On boude Pierre Benoit parce qu’il vend : « À quatre cents exemplaires, on a du génie ; à quatre mille, on conserve du talent ; à quarante mille, on décline mais à quatre cent mille, on sera dénoncé comme un crétin doublé d’une imposture littéraire ». En édition courante, Mademoiselle de la Ferté aura atteint un tirage de 647 000 exemplaires, auxquels s’ajoutent les 407 000 parus au Livre de poche…
Ce récit, comme c’est souvent le cas avec Pierre Benoit, offre des personnages féminins consistants. Voilà avec ses zones d’ombre un roman psychologique qui ne se vide jamais de ses mystères. Texte sensuel, aux contours volontairement indéfinis, Mademoiselle de la Ferté est chargé d’une pulsion érotique contenue, qui se manifeste notamment dans ce désir qu’ont Anne de la Ferté et Galswinthe de prolonger la mémoire de l’amoureux commun disparu.
Lire Pierre Benoit en 2012 requiert une tolérance à la lenteur. À l’instar des grands romanciers du XIXe siècle, l’auteur cultive cet art de la description généreuse, lui qui est possédé par ce souci de la documentation exacte et du détail maniaque. Emportées par le courant de l’indifférence, victimes de l’engouement intellectuel pour le Nouveau Roman, les œuvres de Pierre Benoit, désormais ignorées par le grand public, sont devenues l’objet d’un intérêt renouvelé chez les littéraires. Curieux phénomène inversé quand on songe qu’il y a cent ans cet auteur populaire était boudé par les lettrés…
1. Gérard de Cortanze, Pierre Benoit, Le romancier paradoxal, Albin Michel, Paris, 2012, 574 p. ; 34,95 $.
2. Pierre Benoit, Mademoiselle de la Ferté, Albin Michel, Paris, 2012, 304 p. ; 29,95 $.
3. Pierre Benoit, La châtelaine du Liban, Albin Michel, Paris, 2012, 320 p. ; 29,95 $.
4. Pierre Benoit, Axelle, Albin Michel, Paris, 2012, 400 p. ; 29,95 $.
5. Cité par Christine Garnier, dans L’homme et son personnage, Confidences d’écrivains, Grasset, Paris, 1955.
6. Pierre Benoit, « La Tunisie », dans Toute la terre, Souvenirs de voyages et inédits, Albin Michel, Paris, 1988.
7. Lettre à Anna de Noailles, datée du 28 novembre 1914.
8. Gérard de Cortanze, op. cit., p. 421.
9. Ibid., p. 248.
EXTRAITS
Des tombes de soldats français remplissaient le reste de l’enclos. À l’entour, c’était la ruine habituelle des villages sur lesquels la guerre s’est acharnée. Le clocher de l’église avait été percé à jour par un obus. Le coq qui le surmontait piquait du bec vers le sol. Des toitures effondrées, des collines de gravats, de briques et d’ardoises réduites en miettes, au milieu desquelles surgissait parfois un chat étique, alternaient avec d’humbles jardins saccagés. Les rares arbres restés debout, dénudés par la bise de décembre, étalaient leurs moignons à vif, tout hachés de mitraille.
Axelle, p. 362-363.
Il n’y a pas, la plupart du temps, de sincérité unique. Il y a des sincérités successives.
Mademoiselle de la Ferté, p. 82.
Toujours est-il que Mme de Saint-Selve ne parvenait pas à battre sa compagne sur ce domaine des souvenirs voluptueux, où la belle débauchée de Richmond eût semblé pourtant devoir régner en souveraine. Ses nuits d’amour les plus mouvementées n’étaient plus que d’inoffensives berquinades, comparées à certains épisodes dont la façon toute en sous-entendus dont ils étaient rapportés ne faisait qu’accentuer le mystère scabreux. Galswinthe pouvait protester avec véhémence. Anne opposait à ses dénégations un silence entendu et railleur. Puis, sur les prières de la mourante, elle consentait à continuer de parler. Jusqu’à ce que, finalement, elle s’effondrât, réduite à merci, parmi ses oreillers saccagés, Mme de Saint-Selve écoutait avec avidité les confidences monstrueuses issues de cette sombre imagination de vierge.
Mademoiselle de la Ferté, p. 224-225.