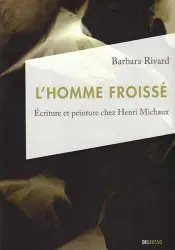Les premières phases de ce bref essai préfacé par Jacques Brault laissent entendre qu’il ne s’agit pas seulement d’une autre étude venant s’ajouter à la longue bibliographie consacrée à Henri Michaux. L’auteure, après « d’interminables années d’immobilité », suit patiemment la démarche de Michaux et se sent accompagnée par lui. C’est bien là l’effet salutaire de ce poète : il nous remet en mouvement, il nous apprend le mouvement.
L’essayiste abandonne la neutralité qui serait de mise dans une étude de type universitaire – elle se situe plutôt dans la lignée divergente de Jean-Pierre Richard. Michaux n’est pas tenu à distance parce que si souvent, si constamment, il dérange, mais au contraire approché pour cette raison même.
L’enfance de Michaux est rappelée, qui a été refus d’abord, paradoxalement celui du langage alors qu’il s’y est ensuite livré avec quelle passion et quelle invention ! Il a rêvé d’un « art de passage » d’un mot, d’une phrase, d’une pensée et d’une émotion à l’autre, d’un genre à l’autre. Et, tout naturellement passage de l’écriture au dessin et à la peinture dans une alliance du signe avec la chose qu’il trouve réalisée chez Klee, dans le pictogramme chinois ou dans le dessin d’un enfant, qui lui aussi provient d’un « étonnement face au monde ». Ce passage, dit Michaux, l’a « décongestionné des mots ». L’essayiste insiste donc sur les deux opérations de la main qui trace la ligne pour écrire et pour dessiner dans une continuité indissociable.
L’essai est le fruit d’une longue imprégnation de Michaux et nourri d’une culture qui, par Rilke, Bonnefoy ou Vadeboncœur, en prolonge les échos. Si, comme on peut s’y attendre, les citations sont nombreuses, elles s’insèrent naturellement, avec fluidité, dans le propos toujours à la hauteur de l’œuvre qui l’a suscité. L’auteure est fascinée par Michaux mais son étude (le terme est ici approximatif puisque celle-ci est en même temps réflexion et méditation) garde sa fermeté et sa personnalité. Les formulations justes et heureuses abondent, qui caractérisent à la fois la démarche de Michaux et celle de sa lectrice : « Vivre ainsi dans les livres, dit-elle, ce n’est pas trahir le monde, ni s’en détourner, c’est vivre dans ses plis, là où se révèle non pas la dureté du monde, mais sa lumière chatoyante comme une image fugace de soi sur un morceau de miroir dans un camp de concentration ».
Je m’étonne que dans sa lecture si pénétrante l’auteure ne prenne pas en compte la charge d’humour que contient l’œuvre de Michaux. Le mot apparaît à la dernière page, mais il est écarté. Certes, comme elle le dit, cette œuvre est « l’une des plus sérieuses de notre époque, en ce qu’elle convoque la main et l’œil, le mot et le dessin pour enchaîner l’homme à ce qui le libère : la ligne, le mouvement » – et enchaîner à ce qui libère n’est pas ici une contradiction. Mais l’humour fissure la carapace qui ne cesse de se reformer autour de nous : loin de s’exclure, sérieux et humour se conjuguent pour nous en dégager.
En refermant ce petit livre de facture soignée et de riche contenu, j’ai eu envie de rouvrir Michaux. Lui, « l’homme froissé », déplie celle ou celui qui le lit.