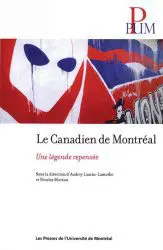Le club de hockey Le Canadien de Montréal est une institution montréalaise depuis au moins les années 1940, un objet culturel déterminant une part de l’appartenance des citoyens à leur ville et au Québec. Pourtant, le discours médiatique, les stratégies urbanistiques, les campagnes publicitaires qui accompagnent l’entreprise sont rarement étudiés, tout se passant comme si le sport était un fait acquis avec lequel il fallait composer, mais dont la valeur était passionnelle et non identitaire ou intellectuelle. L’objectif de l’ouvrage collectif dirigé par Audrey Laurin-Lamothe et Nicolas Moreau consiste à étudier, à partir de multiples points de vue, comment se construit le discours social qui représente Le Canadien en tant que fondement de l’imaginaire collectif et urbain. En se servant de la sociologie, de la théologie, de la philosophie politique, de l’urbanisme, de la communication, les auteurs abordent autant l’émeute de Maurice Richard, les modèles de normativité véhiculés par les sportifs que la construction d’une tradition autour du Tricolore par le moyen des réseaux sociaux ou des stratégies corporatives. Il en ressort un ouvrage certes inégal, mais qui permet de jauger l’inscription du hockey et du Canadien dans la construction discursive du Québec contemporain, avec ses tensions entre repli et ouverture, entre fébrilité partisane et refus de la marchandisation, entre nostalgie et espoir.
Les articles les plus intéressants sont ceux qui montrent à la fois les transmissions hégémoniques du discours par Le Canadien et les formes individuelles et collectives de recomposition du lien social que cette équipe permet, créant du coup une position nuancée entre le rouleau compresseur d’une industrie du sport-spectacle, nouvel opium du peuple, et l’angélisme à l’égard de la gratuité ludique du sport et de l’équipe. Dans ce cadre, il faut souligner la lecture perspicace, fouillée, sentie de Fannie Valois-Nadeau sur le rôle de la tradition assujettie au Canadien comme structure médiatrice des internautes dans les forums de discussion, dans la mesure où la voie empruntée situe exactement la nature de la mise en discours de la culture populaire par le moyen du sport, des médias, de l’expression de soi. Ce type d’analyses ouvre des portes pour comprendre les mécanismes de recomposition sociale et de substitution de la connivence dans un univers autrement atomisé. Hélas, l’article d’Olivier Bauer, trop long, rempli de certitudes assénées sans nuance, porté par des impressions jamais approfondies et qui vont dans toutes les directions, rappelle à quel point il est difficile de parler du sport. En général toutefois, cet ouvrage est l’étude sur le sujet la plus stimulante depuis l’essai de Benoît Melançon à propos de Maurice Richard.