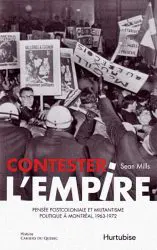La période visée par Sean Mills est extrêmement courte : même pas une décennie entre le début et la fin du temps soumis à l’examen. L’analyse y gagne en précision et la démonstration n’en devient que plus implacable. Les trois objectifs que se proposait l’auteur sont donc poursuivis un à un et nettement atteints. En premier lieu, Mills propose « une nouvelle façon de penser l’histoire du Québec et du Canada, en situant les bouleversements politiques survenus à Montréal dans les années 1960 dans le cadre de la contestation mondiale ». Par la suite, au lieu de dresser à la manière de silos parallèles des reconstitutions tantôt politiques, tantôt sociales, tantôt linguistiques, l’auteur insiste sur les interactions qui rapprochent et entremêlent des mondes distincts. Enfin, il souhaitera que s’ouvrent de « nouvelles perspectives au volet international des études sur les années 1960 ». Pareille pédagogie exige de l’auteur d’énormes apports de souplesse et de polyvalence, mais elle met le lecteur en contact plus direct avec la vie qui bat. Il faut beaucoup de doigté pour étudier un papillon sans l’épingler mortellement…
Cohérent et rigoureux, Mills s’applique à lui-même sa propre médecine. Il multiplie les coups de sonde, remonte d’innombrables sources, met en relation et parfois en opposition les versions les plus diversifiées et restitue ainsi à l’actualité de l’époque sa complexité et sa fluidité. Le syndicalisme montréalais, sous l’impulsion d’hommes comme Louis Laberge, Marcel Pepin et Michel Chartrand, sonne la charge, mais l’auteur puise intelligemment et abondamment dans les témoignages venus d’autres contextes. Les femmes, si souvent abandonnées à leur sort même par les ténors de l’égalité entre les peuples et les humains, se dotent de leurs propres agoras. Elles poussent même l’audace, du moins pour un temps, jusqu’à ignorer la barrière linguistique et à entremêler les points de vue des anglophones et de la majorité francophone. La méthode a l’avantage d’offrir au lecteur un tableau enrichi et plus équilibré. Pierre Vallières, déjà connu du public francophone, reçoit son dû, mais des événements comme le combat pour un McGill français et le saccage d’un centre informatique à Sir-George-William, que le public francophone aurait peut-être eu tendance à laisser à la marge, s’insèrent avec force dans l’ensemble du récit.