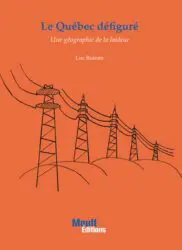Nuit blanche (no 167) avait salué l’excellent essai de Marie-Hélène Voyer intitulé L’habitude des ruines. Le sacre de l’oubli et de la laideur au Québec (Lux, 2021). D’autres universitaires ont posé les mêmes diagnostics sur les négligences quant à la préservation du patrimoine et à l’enlaidissement de nos villes. D’où le présent ouvrage, remarquable.
Dans un essai posthume intitulé Le Québec défiguré. Une géographie de la laideur, Luc Bureau (1935-2023) constate un faux pas, un oubli : les défenseurs de l’environnement ont négligé une dimension fondamentale et pourtant évidente, à savoir le goût de la beauté. Ils ne sont pas les seuls. D’ailleurs, le géographe distingue les écologistes – souvent des scientifiques – des environnementalistes, qui sont davantage des personnalités publiques ou des communicateurs, et non des penseurs, et encore moins des théoriciens. Alors, on ne saurait leur reprocher cette lacune. Et pourtant, la question du Beau devrait nous préoccuper même si c’est au nom de l’environnement (ou du développement durable) que les rénovations urbaines vont en fait (dé)bétonner le paysage citadin ou défigurer une route de campagne. Luc Bureau remarque fort à propos que dans le fameux rapport Brundtland (1987), véritable bible du développement durable, on mentionne rarement le mot beau (à peine trois fois) et jamais le mot laid. Les problèmes d’urbanisme de la ville de Québec servent d’exemples pour dénoncer l’étalement urbain – mais Montréal n’est pas en reste dans ce constat. Ayant connu l’Université Laval à l’époque où celle-ci était ancrée dans le Quartier latin, Luc Bureau explique que la vie de quartier semble avoir disparu au profit du mercantilisme, des mégaprojets et de l’enlaidissement des villes ; si les artisans d’autrefois contribuaient diversement à une multitude d’échanges dans des milieux où la proximité était possible, beaucoup d’entre eux ont aussi disparu. Ce problème s’exacerbe avec le surtourisme qui prévaut notamment dans le Vieux-Québec, mais aussi avec l’acquisition de nombreuses maisons patrimoniales par des investisseurs étrangers qui l’habitent à temps partiel et qui, plus largement, chassent la véritable population de quartiers devenus univocationnels, transformés en musées de pacotille où, mis à part les touristes de passage, plus personne ne réside vraiment (c’est-à-dire sur une base permanente). C’est ainsi que s’amenuise progressivement la vie de quartier, par l’intensification démesurée et incontrôlée d’une tendance : « La laideur provient souvent de la ‘dislocalisation’ des choses ».
Si la perspicacité de Luc Bureau demeure intacte, son style est à son sommet et, au lieu d’un pensum ou d’un réquisitoire, il nous sert un essai au sens le plus noble du terme, par exemple dans ce passage où il se désole de l’envahissement des bannières et des enseignes en anglais (Subway, Starbucks) dans le Québec rural, en quête de modernisation mal placée : « En terme fonctionnel, la campagne devient chaque jour la copie grimaçante de la ville ». Les références littéraires et géographiques y abondent, pertinemment ; et non, ce n’est pas du name dropping. Luc Bureau déplore que le monde rural soit devenu méconnaissable et que l’autosuffisance des familles habitant les fermes ait fait place à des monocultures à large échelle, changements accompagnés d’une idéalisation de la ruralité : « Faute de bien la connaître, de ne l’avoir pratiquée que par le biais de séries télévisées euphorisantes ou de romans simplets, on y projette mille stéréotypes extatiques, tels que les contacts vivifiants avec la vraie nature, les paysages bucoliques, l’espace infiniment ouvert, un silence de repos, un mode de vie moins stressant et quantité d’autres clichés éculés ».
Luc Bureau nous manquera. Mais il nous reste ses livres, et le souvenir d’un esprit perçant, d’une grande exigence et d’un humanisme exemplaire.