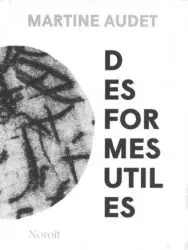On présentait autrefois Anne Hébert en recourant à une expression qui aujourd’hui ferait sourire. On disait qu’elle était une « grande dame » des lettres québécoises. La formule avait le mérite de souligner son importance. Elle pourrait reprendre du service dans le cas de Martine Audet.
Un bref avant-propos ouvre le recueil. La poète y confesse avoir lu un peu trop rapidement un énoncé. Elle avait substitué au mot ronde celui de monde. Il en résultait la phrase suivante : « Je n’avais jamais remarqué que le monde n’était pas tout à fait fermé ». Serait-ce là une invitation à substituer d’autres mots à ceux que l’autrice nous adresse ? Sans doute Des formes utiles incite-t-il à croire que le monde n’est pas tout à fait fermé et que l’on peut, à l’instar de l’écrivaine, donner « aux mots la puissance d’être / avant d’être / de croire / avant d’y croire ». Peut-être aussi peut-on donner aux mots la puissance d’être autre chose que ce qu’ils semblent être ou à tout le moins signifier. Chose certaine, c’est à une lecture singulière qu’elle nous convie.
De poèmes écrits au je, comme c’est ici le cas, on s’attend à ce qu’ils manifestent une présence incarnée. Souvent, à travers des poèmes de nature intime, une image du je en vient à se préciser. Les traits d’une personne plus ou moins imaginaire se dessinent. Or, ce que le je dit et accomplit chez Martine Audet laisse tout d’abord perplexe, offrant peu de prise sur la personnalité du je de ses poèmes. Par exemple, la poète écrit qu’elle « épingle l’origine côté face ». Ou, encore, qu’elle « coupe des mots à la nuque ». Pourquoi pas ? Dans ce monde poétique où l’on nous invite à faire une ronde, pour vraiment entrer dans la danse, il faut trouver ou se forger une clef. Évidemment, on y parvient à condition de ne pas lire trop rapidement. Mais « [i]l y a beaucoup de silence en une seule clef ».
Dans un recueil, des vers plus ou moins obscurs ressemblent parfois aux passages de récits où rien ne semble se passer : ce sont des passerelles. Ces vers dont la clarté nous échappe, c’est comme de la nuit intercalée entre les étoiles ; ils permettent aux plus fulgurants de briller davantage. Du reste, obscurs pour les uns, ils semblent pour les autres ne nécessiter aucun décryptage. Même si la poète les a vraisemblablement produits en suivant la dictée de ses fantaisies, elle doit voir en eux, au-delà de l’étonnement où ils la jettent, un trouble lui paraissant valoir non en tant qu’énigme, mais bien plutôt en tant que révélation. Les liens qu’échangent la rêverie et la création sont nombreux. En poésie, on ne les compte pas. On laisse parler les mots et l’on tente de les écouter, quand bien même la poète déclare que « [q]uoique je dise, / je me tais ».
Bien qu’elle s’exprime de manière plutôt discrète, Martine Audet est loin de se taire. Portés par des vers souvent lumineux, des aveux troublants apparaissent çà et là dans son recueil. Des émotions sont communiquées, et non pas uniquement exprimées. Elles ont trait principalement à la mort, à l’enfance, à la pluie et à la peur. Dans Des formes utiles, les poèmes sont prégnants. Aucun n’est insignifiant. À des sentiments parfois délicatement violents s’ajoutent des pensées, des interrogations : « N’ai-je fait que répondre / à des questions jamais posées ? » Dans cette poésie finement ouvragée, où se manifeste la plus sensible intelligence, le cœur semble être la seule réponse qui vaille.