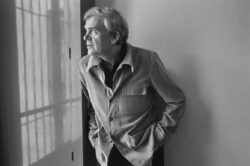Je me souviendrai toujours de l’émotion ressentie quand j’ai lu mon premier roman de Milan Kundera : L’insoutenable légèreté de l’être. Il venait de paraître et j’étais alors étudiant en philosophie.
Dès la première ligne du roman, il est question de l’idée de l’éternel retour présente chez Nietzsche. Cette idée n’est pas que mentionnée au passage pour étaler une érudition de façade. Kundera la développe et y trouve à la fois légèreté et pesanteur. Légèreté, puisque si tout devait se répéter éternellement, alors nos vies devraient s’en retrouver allégées et porter un poids de moins sur leurs épaules. Pesanteur tout de même, car la pensée que tout puisse se répéter à l’identique représente un lourd fardeau (das schwerste Gewicht, selon les mots mêmes de Nietzsche). Et l’écrivain d’origine tchèque conclut cette première amorce de réflexion avec le philosophe présocratique Parménide. L’étudiant que j’étais alors était ébahi de voir inscrite dans la trame narrative d’un roman autant de philosophie. Et tout en élaborant l’histoire, légère et lourde, de ses personnages, Kundera nous entretient du rapport corps/âme, de l’Europe centrale, de l’amour, de l’érotisme, de la musique, du kitsch, etc. C’est lors de cette première lecture que je me suis dit, et que bien d’autres se sont sûrement dit aussi : « Voilà mon écrivain, je vais tout lire de lui ». Une expérience que j’ai pu réitérer avec quelques auteurs comme Paul Auster, Philip Roth ou Michel Houellebecq.
Kundera n’a pas écrit des romans pour passer en douce des idées philosophiques. À l’instar de nombreux autres écrivains, il ne séparait pas la grande des petites histoires ; il intégrait celles-ci dans un tout. S’il y a présence de réflexion philosophique dans son œuvre, ce n’est pas pour élaborer un système de pensée qui se tiendrait tout seul à côté de la vie des personnages. « La pensée authentiquement romanesque […] est toujours asystématique ; indisciplinée ; elle est proche de celle de Nietzsche ; elle est expérimentale. » (Les testaments trahis) Pour Kundera, le roman n’a pas pour fonction de convaincre de la justesse d’une idée, de prévenir les objections et de les réfuter à l’avance. Ce qui ne l’empêche nullement, bien au contraire, de s’interroger sur un concept, une tendance ou un courant de pensée et montrer ensuite comment ses personnages se dépatouillent avec ces idées et les vivent concrètement.
Je m’intéressais bien sûr à l’histoire de ses protagonistes, mais, je l’avoue, je le lisais aussi pour le plaisir de le voir jouer avec des idées apparaissant comme des étoiles filantes servant à ouvrir des portes, et non à les fermer.
Prenons ce qu’il dit du kitsch. Dans L’insoutenable légèreté de l’être, Kundera écrit à son propos que « c’est l’accord catégorique avec l’être », sans hiatus, une harmonie trompeuse régnant sur le monde. L’écrivain donne en exemple le défilé militaire communiste du 1er mai, un kitsch totalitaire puisqu’il imposerait à lui seul ce qui a une valeur esthétique ou non. Il écrit dans L’art du roman, à la suite de Hermann Broch, que le kitsch ne saurait se réduire au mauvais goût. En se contentant de le définir ainsi, on demeurerait dans le vague et le kitsch des uns ne serait pas celui des autres. Il dira ailleurs qu’il est « le besoin de se regarder dans le miroir du mensonge embellissant et de s’y reconnaître avec une satisfaction émue » (L’insoutenable). Kundera était d’avis que notre modernité était celle du kitsch puisque les goûts populaires sont constamment formatés par les médias de masse, générateurs d’idées reçues. Avec les réseaux sociaux actuels et notre crainte de rater quelque chose (FOMO, de fear of missing out), les idées irréfléchies courent encore plus vite qu’à l’époque où il écrivait ces lignes. Bon joueur, il écrit aussi que « nul d’entre nous n’est un surhomme et ne peut échapper complètement au kitsch ».
Kundera est demeuré romancier parce que la littérature lui apportait une plus grande liberté qu’un cadre théorique strict. Le roman se rapproche de la vérité en se permettant de tout questionner. Et quoi de mieux que l’ironie et l’humour pour y arriver ? « La sagesse du roman est différente de celle de la philosophie. Le roman est né non pas de l’esprit théorique mais de l’esprit de l’humour. » (L’art du roman) L’humour et le comique brillent trop souvent par leur absence dans les discours sérieux visant l’objectivité et l’universalité. La littérature réussit mieux que la philosophie – et il arrive à cette dernière de le reconnaître – à nous faire pénétrer au cœur même de la vie. La manière même de la philosophie exige qu’elle se situe toujours un peu en retrait, en décalage conceptuel par rapport à la réalité.
Quant au comique, sa présence dans les écrits de l’auteur relève bien sûr du deuxième degré, un peu comme lorsqu’on se dit à l’annonce d’une nouvelle tragique : « Ce n’est pas vrai, c’est une blague ! »Commentant un passage de L’idiot de Dostoïevski, Kundera rappelle que le personnage de Pavlovitch rit en apercevant trois filles rire sans raison : « [F]ace à cette comique absence de comique, il éclate de rire » (Une rencontre). On associe volontiers l’écrivain Franz Kafka, un autre Praguois, avec la pesanteur. Or, aux dires de Kundera, il ne faut pas ignorer l’aspect comique du Procès. Même que « quand Kafka a lu à ses amis le premier chapitre du Procès, tout le monde a ri, y compris l’auteur » (L’art du roman). L’absurde se dévoile autant dans ses aspects tragiques que dans ses aspects comiques.
Ce qu’écrit Kundera à propos des petites nations européennes se transpose aisément à la situation québécoise : « Les petites nations ne connaissent pas la sensation heureuse d’être là depuis toujours et à jamais ; elles sont toutes passées, à tel ou tel moment de leur histoire, par l’antichambre de la mort ; toujours confrontées à l’arrogante ignorance des grands, elles voient leur existence perpétuellement menacée ou mise en question » (Les testaments trahis). Le contexte des pays de l’Est, absorbés par l’URSS, inspirait sûrement ces pensées à l’auteur du Livre du rire et de l’oubli, mais, en fin de compte, cette précarité demeure même après la dissolution de l’empire soviétique. Pour la petite nation, consciente de sa possible disparition, écrit-il dans Un Occident kidnappé, « la culture devient la valeur vivante autour de laquelle tout le peuple se regroupe ». Il ne faut pas se surprendre si une amitié entre l’écrivain et essayiste québécois François Ricard et Kundera s’est développée à un point tel que ce dernier a confié au premier l’édition de ses œuvres dans « La Pléiade ». S’il s’agit là d’un hasard de la vie, c’est peut-être au sens que Kundera lui donnait : seul lui « peut être interprété comme un message », car « ce qui arrive par nécessité […] n’est que chose muette » (L’insoutenable).
***
Il y a plusieurs années, je me suis rendu à Prague, en pleine période communiste. J’avais l’impression que la ville était lourde et qu’elle manquait de légèreté. C’était sans doute dû au climat, autant atmosphérique que politique. (Rien à voir avec mon voyage de 2019 : la ville rayonnait.) Me promenant alors dans la grisaille des rues de Prague à l’atmosphère d’invasion russe, j’ai pu bavarder avec un citoyen tchèque. Je lui ai demandé s’il connaissait Milan Kundera. Il me répondit : « Bien sûr que si ! » Nous étions à flanc de colline et il m’indiqua un endroit, au loin, où le célèbre écrivain avait habité quelque temps. Je lui ai demandé le nom de la rue, mais je l’avais mal noté. Je n’ai pas trouvé cet endroit. Depuis plusieurs années, Kundera ne donnait plus d’entrevues. Désormais, pour le trouver, il ne nous reste plus que ses livres. Ce qui est déjà une richesse incroyable.