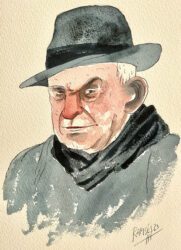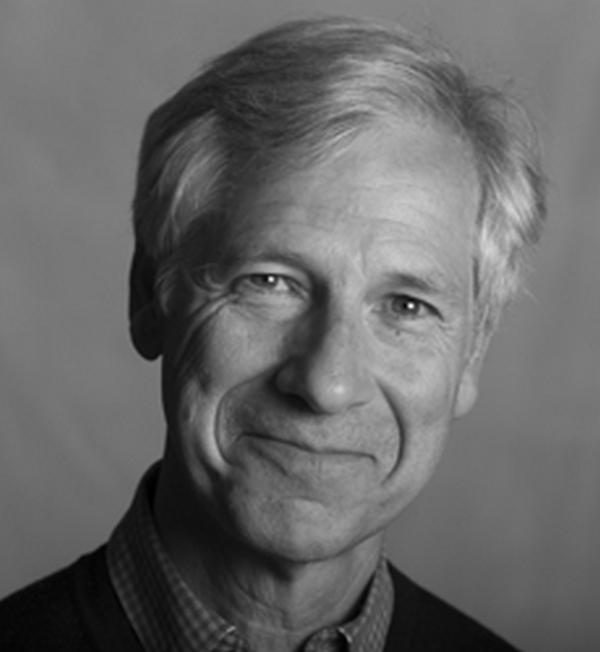« On ne peut reprocher au roman d’être fasciné par les rencontres de hasard », écrit Milan Kundera dans L’insoutenable légèreté de l’être, par leur multiplication qui nous offre autant de motifs et de raisons d’être ébloui par la virtuosité du romancier. « Mais, poursuivait-il, on peut reprocher à l’homme, entendu ici dans son acception universelle, d’être aveugle à ces hasards, à leur répétition, et de priver ainsi la vie de sa dimension de beauté, d’une expérience plus riche. » Son œuvre, qu’il nous faut lire et relire, est un vibrant plaidoyer pour en restituer toute l’importance. Retour sur les derniers titres parus1.
L’ignorance
D’emblée le titre annonce le propos, l’humeur, la désillusion qui anime le narrateur du dernier roman2 de Milan Kundera à être consigné dans l’édition définitive de la Bibliothèque de la Pléiade, parue en 2011 et entièrement revue par l’auteur. L’ignorance s’inscrit à la suite des autres titres qui livraient sans ambages l’état d’esprit, la prise de position, voire la dénonciation du romancier, non pas à titre de dissident, comme on a souvent cherché à l’étiqueter, mais bien à titre d’écrivain qui interroge et livre sa vision sur la condition humaine : Risibles amours, La plaisanterie, La vie est ailleurs, La valse aux adieux, Le livre du rire et de l’oubli, L’insoutenable légèreté de l’être, L’immortalité.
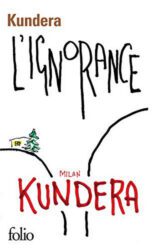 Tous ces titres ont en commun d’exprimer un point de vue sur la condition humaine, sa finalité, et d’en rappeler les grandeurs et les misères. Une « méditation sur l’existence », comme le disait lui-même Kundera. Les personnages de ses romans et de ses nouvelles évoluent dans un univers sous haute surveillance (rappel d’un autre univers ?) et jouent très précisément le rôle qui leur est dévolu, soit de sonder l’âme humaine, de tenter d’en comprendre ce qui l’anime. Certes, le choix d’un narrateur omniscient favorise la mainmise de ce dernier sur les personnages, assure l’harmonie et la cohérence du récit, mais cette dimension prend chez l’auteur des proportions qui vont bien au-delà du seul choix d’un point de vue narratif. L’approche n’est pas sans rappeler celle des romanciers philosophes du XVIIIe siècle, en particulier Voltaire, qui utilisait la forme romanesque pour illustrer ses thèses, les expliquer, voire les confronter à d’autres points de vue. La vérité, comme la beauté, ne se décline pas au singulier. Au fur et à mesure que son œuvre se déploiera, Kundera empruntera autant à l’essai qu’aux techniques narratives pour étayer ses points de vue sur la condition humaine. En cela, il dérogera en toute liberté au fameux diktat : Show, don’t tell. Pour Kundera, le roman est le lieu de tous les possibles, de toutes les libertés, l’expression la plus pure de la créativité. Il enfreint les règles et entremêle les registres pour ouvrir de nouvelles voies de compréhension, sans jamais que cela se fasse au détriment de l’harmonie de l’ensemble. Comme le soulignait François Ricard dans sa préface de l’Œuvre, dans la Bibliothèque de la Pléiade : « Tout a droit de cité dans un roman de Kundera3 ».
Tous ces titres ont en commun d’exprimer un point de vue sur la condition humaine, sa finalité, et d’en rappeler les grandeurs et les misères. Une « méditation sur l’existence », comme le disait lui-même Kundera. Les personnages de ses romans et de ses nouvelles évoluent dans un univers sous haute surveillance (rappel d’un autre univers ?) et jouent très précisément le rôle qui leur est dévolu, soit de sonder l’âme humaine, de tenter d’en comprendre ce qui l’anime. Certes, le choix d’un narrateur omniscient favorise la mainmise de ce dernier sur les personnages, assure l’harmonie et la cohérence du récit, mais cette dimension prend chez l’auteur des proportions qui vont bien au-delà du seul choix d’un point de vue narratif. L’approche n’est pas sans rappeler celle des romanciers philosophes du XVIIIe siècle, en particulier Voltaire, qui utilisait la forme romanesque pour illustrer ses thèses, les expliquer, voire les confronter à d’autres points de vue. La vérité, comme la beauté, ne se décline pas au singulier. Au fur et à mesure que son œuvre se déploiera, Kundera empruntera autant à l’essai qu’aux techniques narratives pour étayer ses points de vue sur la condition humaine. En cela, il dérogera en toute liberté au fameux diktat : Show, don’t tell. Pour Kundera, le roman est le lieu de tous les possibles, de toutes les libertés, l’expression la plus pure de la créativité. Il enfreint les règles et entremêle les registres pour ouvrir de nouvelles voies de compréhension, sans jamais que cela se fasse au détriment de l’harmonie de l’ensemble. Comme le soulignait François Ricard dans sa préface de l’Œuvre, dans la Bibliothèque de la Pléiade : « Tout a droit de cité dans un roman de Kundera3 ».
Tout au long de L’ignorance, qui se déploie en tranches finement ciselées, l’écrivain nous rappelle que « le retour, en grec, se dit nostos. Algos signifie souffrance. La nostalgie est donc la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner ». Le roman met en scène deux personnages, Irena et Josef, tous deux ayant émigré, la première en France et le second au Danemark, lorsque les Russes ont envahi la Tchécoslovaquie en 1968. Confrontés à la remise en cause de leur choix dès lors que le régime communiste qui les avait forcés à s’exiler s’est effondré, Irena et Josef voient soudainement leur passé les rattraper. La remise en question qui l’accompagne n’émane toutefois pas d’eux, du moins pas uniquement, pas essentiellement pourrait-on dire, mais de leur entourage et, ce faisant, révèle leur véritable statut. Aux yeux des autres – de leurs amis d’aujourd’hui comme de ceux d’hier et de leur famille –, ils seront toujours des émigrés. Ce qui justifiait jusque-là leur présence en terre étrangère, leur statut de citoyen réfugié, s’écroule en même temps que le régime qui les a conduits à l’exil. Dès lors, Irena et Josef ne peuvent échapper au retour, à la pression qu’exerce sur eux leur entourage, amis et famille, tout en sachant qu’ils n’appartiennent plus à ce passé qu’ils ont depuis longtemps enterré, ou cherché à faire disparaître. Mais les fondements de l’oubli, comme de la nostalgie, s’avèrent plus complexes. Avec les années, ils ont découvert d’autres motifs que le refus d’un régime totalitaire pour justifier leur choix d’exil. L’ignorance dont il est ici question fait autant référence au regard que nous portons sur nous-mêmes qu’à celui que nous portons sur les autres, qui se révèle souvent plus efficace que le pire des régimes pour enfermer les gens à l’intérieur d’eux-mêmes. À leur façon, Irena et Josef nous rappellent que la vie est ailleurs.
La fête de l’insignifiance
Refermant ce court roman4 de Milan Kundera, qui échappe à l’œuvre complète scellée dans la Bibliothèque de la Pléiade, comme un rire qu’on ne peut retenir, une dernière espièglerie en réaction à un monde qui sombre chaque jour un peu plus dans l’esprit de sérieux, dans la laideur oserait-on ajouter, je n’ai pu m’empêcher, une fois de plus, de penser au Candide de Voltaire.
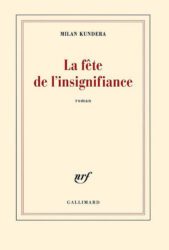 Pour ce qui en est de l’addition d’un nouveau titre, François Ricard avait vu juste en amorçant la préface de l’édition définitive en ces termes : « Sans qu’on puisse dire à coup sûr que l’œuvre de Milan Kundera soit maintenant achevée, l’ampleur qu’elle n’a cessé de prendre au fil des décennies, la beauté singulière qui est la sienne et le degré de plénitude auquel elle est parvenue lui confèrent aujourd’hui ce caractère d’évidence et de totalité qui est l’apanage des œuvres durables […]5 ». La fête de l’insignifiance étant parue trois ans après le rassemblement de l’ensemble de l’œuvre dans la Bibliothèque de la Pléiade, Kundera lui aura donné raison.
Pour ce qui en est de l’addition d’un nouveau titre, François Ricard avait vu juste en amorçant la préface de l’édition définitive en ces termes : « Sans qu’on puisse dire à coup sûr que l’œuvre de Milan Kundera soit maintenant achevée, l’ampleur qu’elle n’a cessé de prendre au fil des décennies, la beauté singulière qui est la sienne et le degré de plénitude auquel elle est parvenue lui confèrent aujourd’hui ce caractère d’évidence et de totalité qui est l’apanage des œuvres durables […]5 ». La fête de l’insignifiance étant parue trois ans après le rassemblement de l’ensemble de l’œuvre dans la Bibliothèque de la Pléiade, Kundera lui aura donné raison.
Autant chez Voltaire que chez Kundera se déploie une même volonté d’affronter le tragique de la comédie humaine en le désarçonnant à sa base, en refusant, sans pour autant fermer les yeux, de céder à la pression de l’avilissement culturel et politique qui tend à rendre toutes choses semblables, égales entre elles et, ce faisant, à les rendre insignifiantes. Le roman s’ouvre ainsi sur une réflexion sur le nombril des jeunes filles qui arpentent le jardin du Luxembourg autour duquel, comme pour le nombril, se portera notre attention. Notre époque ne s’est-elle pas, à l’image de ces jeunes filles, mise à nu au point de concentrer le regard du passant honnête sur ce point anatomique des plus sensibles, souvent perforé d’un anneau dont l’ambivalence du symbole, qui relie autant qu’il isole, emprisonne la personne qui le porte ? L’analogie n’est sans doute pas fortuite. La métaphore qui s’ensuit n’est pas aussi gratuite qu’il peut y paraître à première vue. « La mode du nombril, proclame l’un des protagonistes de La fête de l’insignifiance, a inauguré le nouveau millénaire ! Comme si quelqu’un, à cette date symbolique, avait soulevé un store qui, pendant des siècles, nous avait empêchés de voir l’essentiel : que l’individualité est une illusion ! »
Réunissant autour d’un narrateur six personnages qui deviseront tour à tour du sens de l’existence, de l’avenir de l’Europe, ou plutôt de son déclin, et d’autres problèmes qu’aucune frontière ne peut contenir à l’extérieur de son territoire, thèmes chers à Kundera, ce dernier se livre ici à une ultime dissection de l’absurde, avec l’adresse chirurgicale de qui sait manier le scalpel, adresse dont l’exercice se verra interdit pour le personnage de Thomas dans L’insoutenable légèreté de l’être. Kundera pousse même la farce jusqu’à faire dialoguer ses personnages dans une langue qu’ils inventent afin de s’assurer de demeurer incompris des invités qui les entourent et de désamorcer entre eux la banalité des échanges qui les afflige. Ils ne s’efforcent pas moins de prononcer distinctement chaque phonème, d’articuler chaque syllabe, de respecter le caractère prosodique de cette langue pour lui donner la tessiture de la vraisemblance, avec le même sérieux que celui qui manipule les ficelles du récit et qui, à l’occasion, sort de l’ombre pour nous rappeler qu’il ne s’agit que d’un jeu. Les personnages ne sont pas ici en quête d’auteur, ni ce dernier en quête de personnages. Ils se sont donné rendez-vous pour effectuer un dernier tour de piste, même si le spectacle est terminé, l’œuvre achevée, pour en résumer toute la gravité en nous rappelant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce que Kundera résume à sa façon en livrant sa finale : « L’insignifiance, mon ami, c’est l’essence de l’existence ».
Le rideau
 Kundera a pratiqué l’essai avec autant de virtuosité que le roman et la nouvelle. En témoignent Jacques et son maître, L’art du roman, Les testaments trahis et Le rideau, ce dernier titre paru en 2005. Divisé en sept parties, cet essai6 est un remarquable plaidoyer en faveur de l’art romanesque. Remontant d’abord à ses origines pour mieux en circonscrire l’évolution, et ainsi souligner la continuité qui caractérise le roman, Milan Kundera illustre ce qui en fait la spécificité, ce qui le distingue, par exemple, de la tragédie et de la poésie. « La prose, écrit-il, ce mot ne signifie pas seulement un langage non versifié ; il signifie aussi le caractère concret, quotidien, corporel de la vie. » Se référant aux œuvres de Cervantes, de Henry Fielding, de Dostoïevski, de Gustave Flaubert, d’Honoré de Balzac, de Léon Tolstoï, Kundera expose, en s’attardant au contexte historique et politique des œuvres qui retiennent son attention, comment le roman a pris forme et évolué depuis Cervantes. Les auteurs auxquels il s’intéresse ont en commun d’avoir sans cesse cherché, chacun à sa façon, de nouvelles formes pour exprimer la vie et essayer de la comprendre. Pour Kundera, l’art romanesque repose avant tout sur l’exploration de formes propres à permettre l’étude et la compréhension de la condition humaine, à en révéler toute la complexité et la beauté, qui se révèle peut-être l’unique fil conducteur de son œuvre. À maintes reprises, dans une volonté de réconciliation du roman avec la totalité de son passé, comme le soulignait François Ricard, Kundera rappellera à cet égard l’immense tribut dû à Cervantes, qui a permis au roman de trouver sa voie : « Un pauvre gentilhomme de village, Alonso Quijada, a ouvert l’histoire du roman avec trois questions sur l’existence : qu’est-ce que l’identité d’un individu ? qu’est-ce que la vérité ? qu’est-ce que l’amour ? »
Kundera a pratiqué l’essai avec autant de virtuosité que le roman et la nouvelle. En témoignent Jacques et son maître, L’art du roman, Les testaments trahis et Le rideau, ce dernier titre paru en 2005. Divisé en sept parties, cet essai6 est un remarquable plaidoyer en faveur de l’art romanesque. Remontant d’abord à ses origines pour mieux en circonscrire l’évolution, et ainsi souligner la continuité qui caractérise le roman, Milan Kundera illustre ce qui en fait la spécificité, ce qui le distingue, par exemple, de la tragédie et de la poésie. « La prose, écrit-il, ce mot ne signifie pas seulement un langage non versifié ; il signifie aussi le caractère concret, quotidien, corporel de la vie. » Se référant aux œuvres de Cervantes, de Henry Fielding, de Dostoïevski, de Gustave Flaubert, d’Honoré de Balzac, de Léon Tolstoï, Kundera expose, en s’attardant au contexte historique et politique des œuvres qui retiennent son attention, comment le roman a pris forme et évolué depuis Cervantes. Les auteurs auxquels il s’intéresse ont en commun d’avoir sans cesse cherché, chacun à sa façon, de nouvelles formes pour exprimer la vie et essayer de la comprendre. Pour Kundera, l’art romanesque repose avant tout sur l’exploration de formes propres à permettre l’étude et la compréhension de la condition humaine, à en révéler toute la complexité et la beauté, qui se révèle peut-être l’unique fil conducteur de son œuvre. À maintes reprises, dans une volonté de réconciliation du roman avec la totalité de son passé, comme le soulignait François Ricard, Kundera rappellera à cet égard l’immense tribut dû à Cervantes, qui a permis au roman de trouver sa voie : « Un pauvre gentilhomme de village, Alonso Quijada, a ouvert l’histoire du roman avec trois questions sur l’existence : qu’est-ce que l’identité d’un individu ? qu’est-ce que la vérité ? qu’est-ce que l’amour ? »
Ailleurs, Milan Kundera abordera un autre thème qui lui est cher : celui de la reconnaissance de l’écrivain, ce qui l’amène à illustrer comment il est plus facile pour un écrivain issu d’une grande nation de prétendre à l’universel que pour un écrivain issu d’une petite nation. Pour le premier, la défense et l’illustration de l’identité nationale ne représentent pas un enjeu, alors que pour le second la question se pose en ces termes : être ou disparaître. Cette façon de cataloguer les œuvres romanesques a eu pour effet d’enfermer nombre d’entre elles dans l’exiguïté des notions politiques, ce que n’a cessé de dénoncer Kundera, et a eu un impact important sur la manière de lire une œuvre et d’appréhender la réalité selon que l’on est issu, ou non, d’un pays de l’Est. Ici, le romancier porte un jugement sévère sur l’attitude provincialiste qui a freiné – et freine toujours – le développement d’une pensée libre de telles contraintes géopolitiques. « L’Europe n’a pas réussi à penser sa littérature comme une unité historique et je ne cesserai de répéter que c’est là son irréparable échec intellectuel. » La guerre qui se déroule aujourd’hui en Ukraine lui donne une fois de plus raison.
Pour l’auteur de L’immortalité, le roman n’est pas un genre littéraire, mais un art autonome qui ne se compare pas aux autres genres. L’exigence du roman est de mettre à nu, de découvrir une parcelle du monde jusque-là inconnue, ce qui amène l’essayiste à écrire des pages élogieuses sur les écrivains (Witold Gombrowicz, Franz Kafka, Gabriel García Márquez, pour ne nommer que ceux-là) qui nous ont permis d’élargir nos horizons, « d’avancer sur la route héritée », comme il le souligne, sans recopier « des vérités brodées sur le rideau de la préinterprétation ». Ce retour aux écrivains qui ont marqué son propre cheminement l’amène également à s’interroger sur la nature même de l’écrivain. Le véritable écrivain, rappellera Kundera, cherche d’abord et avant tout à demeurer fidèle à sa propre démarche, à ne pas verser dans la répétition, à déchirer le rideau qu’on lui tend. Remarquable par sa concision, sa clarté et son étendue, cet essai intéressera tous ceux qui cherchent dans le roman, et dans la lecture en général, autre chose qu’un divertissement. Comme l’œuvre entière, c’est avant tout une véritable fête de l’intelligence.
1. Les titres des ouvrages auxquels fait référence le présent article ont déjà fait l’objet de recensions dans Nuit blanche. Son auteur les a revus et enrichis à la lumière d’une relecture de l’œuvre.
2. Milan Kundera, L’ignorance, Gallimard, Paris, 2003, 181 p.
3. Id., Œuvre, Gallimard, Paris, 2011. Préface et Note sur la présente édition par François Ricard.
4. Id., La fête de l’insignifiance, Gallimard, Paris, 2014, 141 p.
5. Id., Œuvre, Gallimard, Paris, 2011. Préface et Note sur la présente édition par François Ricard.
6. Id., Le rideau. Essai en sept parties, Gallimard, Paris, 2005, 197 p.