« Peut-on encore poser des questions ? » : c’est ainsi que la journaliste, documentariste et féministe québécoise Francine Pelletier titrait sa chronique dans le quotidien Le Devoir en avril 2020, pressentant, un mois à peine après le début de la pandémie, « une certaine censure – ou du moins, une certaine façon de faire – flottant dans l’air », au regard des réactions critiques aux mesures prises par nos gouvernements. Son départ du journal, en 2022, après sa chronique controversée « La pandémie revue et corrigée », a été l’occasion pour elle d’obtenir indirectement sa réponse, et de s’exprimer plus amplement et sans restriction au sujet de la liberté d’expression au Québec.
Avec son ouvrage L’art de se mouiller. Chroniques pour nourrir le débat1, appuyé par les éditions Écosociété, sensibles aux questions environnementales et de justice sociale, Francine Pelletier creuse le sujet de la liberté d’expression et répond assurément à ses détracteurs. En regroupant ses chroniques au Devoir sur neuf ans (2013-2021) avec quelques hommages de figures inspirantes, et en encadrant le tout par deux lettres publiques de soutien, reçues au moment de son retrait de la vie journalistique, de la part d’intellectuels, d’artistes et de politiciens (« Lettre ouverte à la direction du quotidien Le Devoir » et « Le débat public en temps de pandémie »), une préface socialement engagée de son éditrice Barbara Caretta-Debays – ne tarissant pas d’éloges à l’égard de l’auteure dissidente, « véritable électron libre » qui « n’a jamais eu peur de se mouiller » – et finalement sa propre introduction, la journaliste réaffirme haut et fort sa position en faveur de la liberté d’expression et du débat d’idées.
La liberté d’expression avant tout
Les chroniques sont classées sous trois grands thèmes qui correspondent aux grands combats de Pelletier : « L’identité », pour le Québec d’adoption de l’Ontarienne de naissance ; « La sexualité », pour les droits des femmes défendus depuis toujours par la cofondatrice de la revue féministe La Vie en rose ; et « La pandémie », pour la liberté d’expression sur tous ces sujets. Et c’est essentiellement cette liberté qui s’impose comme préoccupation centrale de la compilation d’articles : la liberté des femmes, de pratique religieuse, la liberté médicale, linguistique, de parole, d’information ou autre. L’auteure signe ainsi avec ce livre ce qui ressemble à sa plus longue et principale chronique sur le sujet. Elle s’affirme comme essayiste à part entière et comme penseuse clairement engagée en faveur du thème de l’émancipation. Le style des chroniques est tout aussi libre et correspond aux revendications déjà exprimées dans les années 1980 par la rédactrice de La Vie en rose, à savoir « le droit à la dissidence, à l’humour, à la contradiction », autant dire à l’essai littéraire tel que défini par l’écrivain Montaigne. Comme l’essayiste de la Renaissance, cette plume assumée humblement à la première personne, au raisonnement à la fois rigoureux et simple, sait nous surprendre par ses expressions populaires et savoureuses, ses comparaisons, ses métaphores, ses dictons et surtout ses innombrables points d’interrogation.
En effet, Pelletier affirme beaucoup plus rarement qu’elle ne questionne, elle s’exprime souvent au conditionnel, en modérant son propos par des formules telles que « je ne crois pas », « à mon avis » ou « c’est plus compliqué » et en structurant son argumentaire en deux temps, lequel s’apparente à un perpétuel oui… mais. Elle nous dit vouloir « fouiller les angles morts » et elle s’y exerce en se faisant souvent l’avocate du diable, en s’élevant au-dessus des partisaneries et des clivages sociaux habituels, en nuançant ses arguments, en reconnaissant les qualités de ses adversaires et en critiquant tout autant son propre camp idéologique. Féministe mettant en question les excès du mouvement #MeToo, québécophile critiquant le nationalisme toxique, francophile défendant le bilinguisme, agnostique contre la loi 21, vaccinée s’interrogeant sur le vaccin…, l’auteure de L’art de se mouiller est finalement plus réconciliatrice que polémiste. Mais c’est sans doute cette hybridité de pensée et ce métissage de convictions – qui lui vient peut-être de sa double identité d’Ontarienne anglophone et de Québécoise francophone – qui ont pu déranger et l’exposer davantage aux critiques, surtout en période pandémique où tout doit être tranché, pur, aseptisé et où toute pensée complexe infectée de son contraire effraie autant qu’une gouttelette échappée dans les airs par une bouche mal masquée.
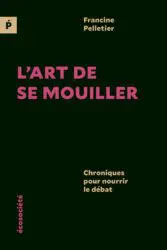 Reconnaissons que la journaliste touche dans ces chroniques à d’innombrables sujets hautement sensibles puisque renvoyant presque tous à une image de la société québécoise et que, vue sous le prisme des principes libertaires affectionnés, cette image est rarement flatteuse. La province passe, dans l’ensemble, pour être intolérante, autoritaire, repliée sur elle-même et dans le déni de ses propres crimes. « Le Québec a donc l’insigne honneur d’avoir créé deux grandes premières dans les annales des crimes haineux en Occident : un massacre de femmes, suivi d’un massacre de musulmans », ose déclarer l’auteure pour nous sortir de ce déni qu’elle perçoit dans le fait de considérer comme des actes isolés et inanalysables la tragédie de Polytechnique et la tuerie perpétrée dans la mosquée de Québec. L’analyse du film portant sur la figure historique de Louis Cyr sert quant à elle de prétexte pour dénoncer « un nationalisme exclusif, plutôt passéiste et peu ouvert sur le monde ». La loi 21, sur l’interdiction des signes religieux dans la fonction publique, devrait être clairement rejetée parce qu’elle compromet la liberté de religion et qu’elle constitue « un bris de démocratie ».
Reconnaissons que la journaliste touche dans ces chroniques à d’innombrables sujets hautement sensibles puisque renvoyant presque tous à une image de la société québécoise et que, vue sous le prisme des principes libertaires affectionnés, cette image est rarement flatteuse. La province passe, dans l’ensemble, pour être intolérante, autoritaire, repliée sur elle-même et dans le déni de ses propres crimes. « Le Québec a donc l’insigne honneur d’avoir créé deux grandes premières dans les annales des crimes haineux en Occident : un massacre de femmes, suivi d’un massacre de musulmans », ose déclarer l’auteure pour nous sortir de ce déni qu’elle perçoit dans le fait de considérer comme des actes isolés et inanalysables la tragédie de Polytechnique et la tuerie perpétrée dans la mosquée de Québec. L’analyse du film portant sur la figure historique de Louis Cyr sert quant à elle de prétexte pour dénoncer « un nationalisme exclusif, plutôt passéiste et peu ouvert sur le monde ». La loi 21, sur l’interdiction des signes religieux dans la fonction publique, devrait être clairement rejetée parce qu’elle compromet la liberté de religion et qu’elle constitue « un bris de démocratie ».
La hantise du bilinguisme et du multiculturalisme est vue comme une réaction inappropriée à de faux problèmes. Elle est conçue comme tout aussi nuisible pour la démocratie, tandis que la censure reposant sur le thème de l’appropriation culturelle est perçue comme un nouveau purisme inquiétant.
Toutefois, Francine Pelletier ne se complaît pas dans ces dénonciations, qui sont régulièrement assouplies par des analyses historiques, voire des psychanalyses collectives, éclairant l’origine des tendances stigmatisées et conséquemment leur offrant une solution. « Nous avons travesti l’inquiétude millénaire que nous avons de disparaître dans la hantise de l’autre », comprend l’auteure avant de proposer de travailler sur une culture commune plutôt que sur une langue commune. Elle se mouille également en comparant le peuple québécois au peuple juif, toutes proportions gardées, pour sa situation historique de survivant, de soumis, d’oppressé, qui expliquerait aujourd’hui son « sentiment de supériorité morale », celui de l’éternelle victime immunisée contre les fautes et les reproches. La chroniqueuse fait ainsi constamment pivoter l’axe du débat d’actualité qu’elle aborde pour créer un nouveau paradigme nous conduisant vers sa résolution. Cette façon de faire nous permet, par exemple, de mieux appréhender le conflit autour de la loi 21, quand on comprend la mésentente générationnelle qui le sous-tend, les Québécois plus âgés percevant le signe religieux comme un rappel de l’oppression cléricale passée quand les jeunes le conçoivent comme un symbole d’intégration culturelle.
Par-delà ses propres convictions
Sur la question féministe, qui est pourtant son principal cheval de bataille, Pelletier fait preuve de tout autant de discernement et de nuance. Celle qui a aidé autrefois les femmes à se faire avorter clandestinement et qui s’est retrouvée sur la liste des féministes à abattre de Marc Lépine – l’auteur de la tuerie de masse à Polytechnique Montréal – s’effraie certes d’un retour en arrière dans le combat pour les droits des femmes, en dénonçant la montée d’une certaine droite réactionnaire aux États-Unis comme en France, mais elle est aussi intéressée à débusquer les raisons profondes de ce dénigrement de la cause féministe. La lettre de suicide de Marc Lépine, qu’elle avait exigé de rendre publique il y a plus de 30 ans, était déjà l’occasion d’une analyse constructive de ce qu’elle appelle le « backlash au féminisme ». Aujourd’hui, les mêmes régressions lui font dire que « `[n]ous avons sous-estimé les coûts personnels du féminisme. Nous avons eu tendance à croire qu’en changeant les lois, les structures, tout le reste tomberait en place. Mais le reste, les rapports personnels, l’intimité, les émotions, est beaucoup plus résistant au changement ». Et c’est cette capacité d’investigation du côté de l’intime et de l’émotif, en dépassant la colère première et en sortant du principe pur, qui donne à ces chroniques et à ce féminisme toute leur valeur et leur utilité.
Tout en embrassant la cause du mouvement #MeToo, la féministe s’interroge sur l’émergence de la « sexualité psychopathe » d’un Harvey Weinstein et sur son lien avec le difficile ajustement des hommes à l’émancipation sexuelle des femmes. Elle n’hésite pas à faire une sorte de mea culpa du féminisme et s’inquiète de la radicalisation du mouvement, notamment avec le phénomène de « La liste » qui rassemble sur Facebook les noms de plus de 800 hommes accusés anonymement d’agressions sexuelles sans autre forme de procès et que l’auteure appelle une « tribune populaire à saveur maoïste ». Pelletier sait être sévère à l’égard du mouvement qu’elle chérit depuis toujours quand elle voit qu’il risque de trahir l’impulsion profonde qui l’avait motivé et qui reste principalement celle d’un amour de la liberté et de la justice pour tous et toutes. Assurément progressiste, elle se réjouit de la nouvelle fluidité des genres tout en déplorant le manque de discussions à propos du phénomène de gestation pour autrui, du mouvement queer ou des revendications trans. Outre ses positionnements, c’est le débat d’idées que l’intellectuelle défend essentiellement pour sortir des impasses et des haines stériles.
L’idéal syncrétique en temps de pandémie
La révolte de Francine Pelletier à l’égard des menaces portées à notre démocratie et à la liberté d’expression atteint son apogée dans la troisième partie du recueil de chroniques, portant sur la pandémie. Sa pensée demeure transversale au clivage le plus évident de cette période puisque l’auteure ne cesse de réaffirmer sa pleine adhésion à toutes les mesures gouvernementales – au masque, au confinement et au vaccin – tout en appréhendant très tôt (avril 2020) tous les dérapages que la réponse politique à la pandémie risque d’engendrer. Outre les répercussions économiques, la détresse psychologique, l’isolement des mourants, la division sociale, ce sont les abus d’autorité, la désignation de boucs émissaires, l’interventionnisme étatique, la censure sur tous les plans (académique, artistique, médiatique) ainsi que l’absence de transparence et de débat qui inquiètent la journaliste au plus haut point. « Les contraintes liées à la liberté de mouvement ne devraient jamais inclure la liberté d’information », s’insurge celle qui voit peser la menace sur son métier.
La pensée unique qui découlerait d’une mainmise de la santé sur toute la vie publique – ce prisme jamais questionné ni relativisé – lui fait craindre des abus d’autorité policière, de surveillance électronique, l’instauration d’une ligne de parti qui divise les citoyens en bons et en mauvais, enfin un « nouveau puritanisme » et type d’exclusion qui donnerait à voir le pire chez l’humain. « Nous avons une occasion en or, en fait, d’examiner ici ‘en direct’ comment se créent les attitudes racistes et sexistes », va jusqu’à ironiser l’auteure dans son cri d’alerte contre l’instauration d’un nouveau climat d’intolérance, avant d’en responsabiliser le gouvernement qui, par ses mesures autoritaires et incomprises, selon elle, « porte atteinte au contrat social ».
Le renvoi de la chroniqueuse du journal, qui lui offrait depuis une décennie une tribune pour exprimer ses appels à la vigilance concernant nos libertés essentielles, accrédite et signe son réquisitoire. Francine Pelletier n’a pas eu de temps ou le recul ici pour analyser les motifs profonds de ce sursaut autoritaire de notre gouvernement, qui a pourtant sûrement contribué à sauver des vies. En ces temps difficiles de maladie collective et de peur, où chacun se replie dans l’exercice de ses propres mécanismes de défense psychologiques, souvent porteurs d’intolérance et trahissant notre complexité, s’est-elle laissée éblouir par la notion de liberté ? S’est-elle perdue dans l’idéologie libertarienne et une écriture en porte-à-faux avec ces temps de crise où il faut pouvoir trancher plus clairement et rigoureusement, sacrifier, avancer ?
L’écrivaine reste attachée, dans ses chroniques, au clivage politique traditionnel de la droite et de la gauche. Voilà une dichotomie qu’elle ne déconstruit pas. Elle se mouille moins quand elle diabolise perpétuellement la droite et qu’elle la considère, au mieux, comme une réaction aux excès d’un féminisme castrateur, mais jamais pour ses qualités libertaires, antiétatiques et antiautoritaires qui correspondent pourtant à ce qu’elle ne cesse de prôner dans ce livre. Telle est peut-être sa contradiction majeure et son déni essentiel, la principale critique que nous puissions accoler à cette écriture par ailleurs difficile à étiqueter. Cette plume tremperait-elle trop dans son idéal en oubliant, par exemple, que c’est la langue qui fait la culture, la contrainte qui renforce cette langue, les restrictions qui protègent nos libertés, les erreurs qui font avancer et les couvre-feux qui évitent les morts ? Quoi qu’il en soit, le prix de ce possible aveuglement semble assumé dans cet ouvrage où l’auteure se mouille essentiellement en tentant l’exploit louable d’un syncrétisme discursif et qui s’y tient toujours. Et s’il invite à une émancipation encore plus radicale dans l’expression littéraire et poétique, où cette polyphonie pourra se déployer sans contraintes, alors il s’agit d’une excellente nouvelle pour le lectorat de Francine Pelletier. Les hommages, en fin de livre, le laissent à penser, tant ils nous révèlent en elle une femme plus sentimentale que cérébrale, une documentariste plus sensible à la main tremblante d’un Jacques Parizeau qu’à ses déclarations officielles, une féministe toujours émue par l’idéal amoureux et la poésie d’un Leonard Cohen.
Enfin, la dernière chronique, exaltée, sur l’exposition virtuelle L’infini, préfigure cet envol ultime et cette liberté absolue, celle qui consiste à se lancer dans l’univers, à quitter la Terre et les humains pour mieux les voir et les aimer, de loin, dans leur fragilité et leur beauté. Souhaitons que le licenciement de cette journaliste qui ose les questions, les contrastes et les angles nouveaux soit l’occasion d’un plongeon du même type, dans l’infini littéraire et créatif, loin des rigueurs et des diktats des petites planètes médiatiques.
1. Francine Pelletier, L’art de se mouiller. Chroniques pour nourrir le débat, Écosociété, Montréal, 2022, 218 p.
EXTRAITS
La liberté d’expression est un bien fragile, particulièrement en temps de crise. Ce livre est là pour le rappeler.
p. 23
Qu’il s’agisse d’organismes gouvernementaux, de médias, d’universités ou encore de militants un peu trop zélés, on voit poindre un nouveau puritanisme intellectuel. De plus en plus, on cherche à faire taire des propos susceptibles de blesser ou de choquer. Il y a aujourd’hui une tendance à ne pas vouloir indisposer qui que ce soit.
p. 17
Le combat pour la liberté d’expression est beaucoup plus compliqué aujourd’hui parce qu’il a très peu à voir avec un État répressif imposant ses règles à une population largement impuissante. Aujourd’hui c’est la population qui, loin d’être soumise et repliée sur elle-même, exige une autre façon de faire par rapport à l’establishment culturel, politique ou autre. Les rôles ont été renversés en d’autres mots.
p. 77
L’« autre » est d’abord vu comme étranger à soi, un être à part. Puis un « étrange ». Ensuite un ver dans la pomme, capable de pourrir les bonnes mœurs et l’harmonie sociale. […] À partir de là, sans que ce soit toujours conscient, on crée deux classes de citoyens : les acceptables et les inacceptables.
p. 179
Il nous a permis de croire en l’amour, précisément au moment où il devenait plus difficile de le faire. Au moment même où on cassait la baraque des rapports hommes-femmes, où on désacralisait l’amour, Leonard Cohen en a fait une chose sacrée. Pour moi, il s’agit de son legs ultime, de son plus beau cadeau.
p. 193










