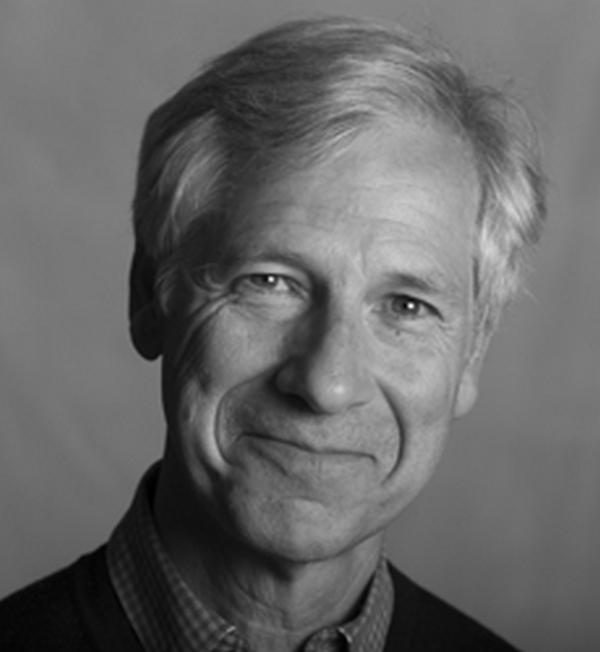Écrire, comme peindre ou toute autre activité créatrice, vise avant tout à répondre à un besoin, à une exigence, voire à combler un manque existentiel. S’y consacrer requiert un engagement personnel inconditionnel. Un engagement de tous les instants.
 Lorsqu’en apparence – et peut-être davantage dans ces cas-là – on semble libéré de ce besoin viscéral, de ce désir d’une vie augmentée que seule la confrontation avec ce qui est plus grand que soi peut combler, ce besoin n’en devient que plus fort. L’écrivain, comme tout autre artiste, n’a d’autre choix que d’accepter de se mesurer chaque jour à ses propres limites, à ses propres manques et défaillances, et de se répéter que la persévérance demeure la seule issue possible. Comme le souligne Jonathan Harnois, dans la correspondance échangée avec Robert Lalonde au cours d’une année et qui a pour titre Tu me rappelles un souffle1, « l’insuffisance assumée est préférable à la plénitude feinte ».
Lorsqu’en apparence – et peut-être davantage dans ces cas-là – on semble libéré de ce besoin viscéral, de ce désir d’une vie augmentée que seule la confrontation avec ce qui est plus grand que soi peut combler, ce besoin n’en devient que plus fort. L’écrivain, comme tout autre artiste, n’a d’autre choix que d’accepter de se mesurer chaque jour à ses propres limites, à ses propres manques et défaillances, et de se répéter que la persévérance demeure la seule issue possible. Comme le souligne Jonathan Harnois, dans la correspondance échangée avec Robert Lalonde au cours d’une année et qui a pour titre Tu me rappelles un souffle1, « l’insuffisance assumée est préférable à la plénitude feinte ».
C’est à la fin d’un repas qui les réunit après une trop longue absence, un intervalle indépendant de leur volonté, au moment où l’on voit apparaître dans l’espace public des gens masqués et se multiplier les gestes barrières pour soi-disant se protéger les uns des autres, que le désir de rapprochement s’impose aux deux écrivains qui désirent poursuivre leur échange fraternel. L’impulsion vient de Robert Lalonde, qui s’apprête à publier La reconstruction du paradis, le carnet qui lui permet de renaître après qu’un incendie eut détruit la maison qu’il habitait avec sa conjointe depuis plus de 40 ans. Tout ce qu’elle contenait est réduit en cendres. Jonathan Harnois, qui sent battre en lui, comme il l’exprime, « l’aile des mots fragile »,s’empresse de répondre présent lorsque l’idée d’entreprendre cette correspondance jaillit dans l’esprit de son aîné. S’ouvre alors un nouveau chemin que tous deux décident d’emprunter, de débroussailler avec leurs mots et leurs élans spontanés. L’échange prend aussitôt forme et s’invente d’une missive à l’autre en pleine liberté, « dans une sorte de jeunesse à la fois fragile et indestructible ». Sans égard au rôle que chacun endosse, mentor ou disciple, les deux épistoliers y trouvent leur compte, et les courriels qui s’ensuivent se déclinent sur le mode du partage, de la complicité et de l’amitié. Bien sûr, la pratique de l’écriture – avec l’investissement, le devoir d’honnêteté qu’elle impose et exige à tout moment – demeure l’assise sur laquelle se construit cette correspondance atypique où chacun à son tour tend un miroir à l’autre : « [T]u m’écris comme peut-être je t’écris. Tes mots me disent, comme peut-être les miens t’épellent ». Si Jonathan Harnois avoue avoir besoin de cette filiation littéraire, Robert Lalonde endosse le rôle de guide avec générosité, rappelant en cela que cette correspondance est rapidement devenue un rite fraternel. « En nous extirpant de nos solitudes respectives, précisent-ils d’entrée de jeu, elle nous a permis de réaliser que l’autre est parfois un raccourci vers soi-même. »
Apparaissent au fil des missives la véritable nature du travail d’écrivain, les aléas du quotidien et du métier avec lesquels il faut composer, les blessures que ce travail met à jour, les petits bonheurs qui illuminent parfois une journée, les souvenirs d’enfance, sans oublier les pertes d’amis qui continuent de vivre en soi et d’investir l’écriture. L’un envie à l’autre sa « prose opulente et sensorielle, ce pulsant d’âme converti en intransigeante générosité du verbe », alors que le second est ébloui par la force, par l’audace des images qui jaillissent du clavier du premier. Les envies et les jalousies se fondent ici au creuset de l’amitié, l’effet miroir brouillant parfois les pistes. À maintes reprises, on pourrait leur attribuer indifféremment des assertions comme celle-ci : « [J]’imagine que l’important – en matière d’écriture – est de trouver sa porte vers une présence accrue au monde ».
Le même désir d’accroître sa présence au monde que tous deux ressentent, s’accompagnant des élans comme des doutes qui les animent, renforce ici les liens qui se tissent au fil des saisons. Une telle entreprise exige parfois d’accepter le reflet brouillon qui en émane à certains moments. En d’autres mots, d’abaisser sa garde en toute confiance : « Hier soir, nous avons longuement parlé de cette correspondance qui depuis un bon moment déjà nous chauffe le désir d’apparaître vraiment tels que nous sommes, dans la vraie vie comme en art ».
Deux vies se déploient et s’entrecroisent, avec tous les méandres, les échappées belles que cela suppose, durant ces quatre brèves saisons. Cette correspondance va toutefois bien au-delà. Il y a fort à parier qu’elle se poursuivra, et, comme lecteur, nous l’accueillerons avec autant de bonheur qu’ils en auront à la prolonger.
1. Robert Lalonde et Jonathan Harnois, Tu me rappelles un souffle, Boréal, Montréal, 2023, 200 p.
EXTRAITS
Tu écris clair, sans escamoter l’ambiguïté inévitable et même nécessaire à tout véritable appel de fond, parole branchée sur l’irrésolution et le désir – encore une fois –, ce désir ardent de voir et de faire voir, de faire résonner ce que tu aperçois, soupçonnes, pressens.
Robert Lalonde, p. 16.
Comment se garder dans le feu d’écrire ? Comment l’habiter heureux, le vivre en se sentant nourri ? Pourquoi écrire ? Vers quoi écrire ? D’où écrire ? Comment garder vivante une écriture qui nous donne la vie ? Ça me fait du bien de parler de ça.
Jonathan Harnois, p. 44.
On écrit aussi – peut-être surtout – avec et pour nos chers en allés. Pour celles et ceux qui n’ont pas su, pas pu parler.
Robert Lalonde, p. 53.
Comme toujours te lire me ranime. C’est de la défibrillation littéraire.
Jonathan Harnois, p. 106.