Avec seulement deux titres parus, Mégaptère1 de Martine Béland et Le cabinet de Barbe-Bleue2 de Thomas O. St‑Pierre, il est difficile d’établir le portrait de la prometteuse collection « L’inconvénient » que lançaient les éditions Leméac en février dernier.
Le communiqué de la rentrée s’en tenait aux généralités d’usage : « Fidèles à un esprit d’exigence, les courts essais littéraires proposés se distinguent par un amour de la langue et une rigueur de la pensée. Le petit singe du logo rappelle la nature fragile, contingente de notre humanité ». Cela offre l’avantage d’ouvrir sur un vaste horizon.
Que la collection « L’inconvénient » soit dirigée par Mathieu Bélisle et Alain Roy, du périodique du même nom, a cependant quelque chose d’immédiatement engageant : la revue occupe depuis déjà longtemps une place de choix dans la vie intellectuelle, et le partenariat avec une grande maison d’édition permettra une bénéfique extension de la réflexion qui loge à cette enseigne. On ne lit pas un livre de la même manière qu’un article de revue : quand l’idée peut se déployer sur 100 pages, la lecture s’accorde à une autre temporalité, la pensée s’accorde un temps différent, que j’ai envie d’appeler le temps long.
Le dénominateur commun des deux titres initiaux est l’attention au symbole, quoique les auteurs n’aient pas de cette notion le même entendement. Chez Martine Béland (Mégaptère), la remontée fortuite en mai 2020 d’un rorqual à bosse jusque dans le port de Montréal, abondamment commentée dans la presse et au coin des rues, invitait à l’expression de certaines de nos préoccupations, le dérèglement climatique au premier chef, en leur donnant l’âcre consistance de la réalité.
 Chemin faisant, on ne tarde pas à comprendre que l’on sera moins dans un essai à proprement parler que dans un récit – qui en est l’un des visages, me direz-vous. En effet, le funeste et inexorable destin du grand cétacé égaré se fond dans le glissement vers la mort, tout aussi inéluctable, de la mère de l’autrice, qui désignait les cétacés par mégaptères (étymologiquement « géants aux grands ailerons »). De la portée collective d’un événement étrange, on passe à la dimension personnelle, intime. Voir venir le moment où l’on va perdre sa mère n’est pas insignifiant : les symboles se mettent en place afin de donner du sens, de la signification à l’inacceptable, sans garantie de succès. Le Saint-Laurent, vu de Longueuil ou de Saint-Michel-de-Bellechasse, puis la baie Sainte-Marie et l’océan, au large de la Nouvelle-Écosse acadienne, se déposent comme les pièces d’une catalogne, ce « chaos ordonné », cette « allégorie des discours familiaux », « discours tissés, répétés et cousus pour recouvrir un autre discours, celui des gestes posés, des événements ». La mort gagne fatalement, mais la mère n’a pas perdu, car elle a fourni la trame de sa survie et sa fille a repris la catalogne à son compte en tissant ce qu’elle connaît le mieux : les mots.
Chemin faisant, on ne tarde pas à comprendre que l’on sera moins dans un essai à proprement parler que dans un récit – qui en est l’un des visages, me direz-vous. En effet, le funeste et inexorable destin du grand cétacé égaré se fond dans le glissement vers la mort, tout aussi inéluctable, de la mère de l’autrice, qui désignait les cétacés par mégaptères (étymologiquement « géants aux grands ailerons »). De la portée collective d’un événement étrange, on passe à la dimension personnelle, intime. Voir venir le moment où l’on va perdre sa mère n’est pas insignifiant : les symboles se mettent en place afin de donner du sens, de la signification à l’inacceptable, sans garantie de succès. Le Saint-Laurent, vu de Longueuil ou de Saint-Michel-de-Bellechasse, puis la baie Sainte-Marie et l’océan, au large de la Nouvelle-Écosse acadienne, se déposent comme les pièces d’une catalogne, ce « chaos ordonné », cette « allégorie des discours familiaux », « discours tissés, répétés et cousus pour recouvrir un autre discours, celui des gestes posés, des événements ». La mort gagne fatalement, mais la mère n’a pas perdu, car elle a fourni la trame de sa survie et sa fille a repris la catalogne à son compte en tissant ce qu’elle connaît le mieux : les mots.
Tout le monde a une bonne idée, du moins dans ses grandes lignes, du conte populaire « La Barbe-Bleue »auquel Charles Perrault a donné sa version classique : une jeune femme épouse un homme riche, que sa barbe rend effrayant. Avant de partir en voyage, le mari lui accorde la libre jouissance de son château, à l’exception d’une pièce dont il lui donne pourtant la clef. La curiosité (mais s’agit-il vraiment de cela ?) l’emporte sur l’injonction et sur la prudence. À son retour, le monstrueux homme s’apprête à punir l’épouse en la tuant, comme il l’a fait souvent à en juger au nombre de cadavres jonchant la pièce interdite. Heureusement, les frères de la femme surviennent à point nommé pour l’envoyer ad patres.
Ce résumé ne rend pas compte de la richesse du texte, surtout que l’interprétation de ce type de récit à haute charge symbolique exige non seulement que l’on ne néglige aucun détail, mais qu’au contraire on s’y appuie. Dès le début du Cabinet de Barbe-Bleue, Thomas O. St‑Pierre balise le terrain de ses outils, empruntés à Freud, sans orthodoxie : « [L]es meurtres qu’il [Barbe-Bleue] a commis, quel que soit leur nombre farfelu et aussi terribles soient-ils, sont avant tout des symboles, c’est‑à-dire des outils conceptuels qu’on peut détourner de leur usage premier (si tant est qu’il soit même possible de leur en attribuer un) ».
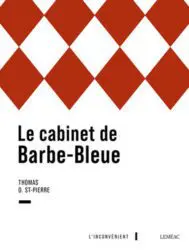 Je ne suis pas sûr que les gens au fait de la psychologie et de ses théories, ce que je ne suis pas, laisseront passer sans protester cet énoncé un peu mou. La chose importe peu : on n’est pas dans un ouvrage à prétention scientifique, mais dans la tentative, qui a peut-être d’abord été une tentation, un petit plaisir coupable, d’interpréter le conte à partir de soi. Ce n’est pas répréhensible, au contraire ! Dans sa brièveté, dans son outrance, dans sa violence (on peut parler sans ambages de féminicides dans le cas qui nous occupe), le conte de fées travaille au fer rouge l’âme des lecteurs et des auditeurs, peu importe leur âge.
Je ne suis pas sûr que les gens au fait de la psychologie et de ses théories, ce que je ne suis pas, laisseront passer sans protester cet énoncé un peu mou. La chose importe peu : on n’est pas dans un ouvrage à prétention scientifique, mais dans la tentative, qui a peut-être d’abord été une tentation, un petit plaisir coupable, d’interpréter le conte à partir de soi. Ce n’est pas répréhensible, au contraire ! Dans sa brièveté, dans son outrance, dans sa violence (on peut parler sans ambages de féminicides dans le cas qui nous occupe), le conte de fées travaille au fer rouge l’âme des lecteurs et des auditeurs, peu importe leur âge.
On est néanmoins un peu surpris qu’il ne s’agisse pas ici plus particulièrement de lectrices et d’auditrices, comme aux yeux de Clarissa Pinkola Estés dans Femmes qui courent avec les loups, ouvrage paru en 1992 qui garde aujourd’hui toute sa pertinence : les destinataires qu’elle identifiait étaient appelées à se méfier du « prédateur naturel de la psyché », de « l’homme noir qui habite la psyché de toutes les femmes ». Quant à Bruno Bettelheim, qui suppose que l’épouse a profité de l’absence de son mari pour goûter au plaisir interdit (Psychanalyse des contes de fées), probablement la pierre angulaire dans le domaine, il voit une histoire de désir sexuel si fort que, pour le satisfaire, la jeune femme est prête à encourir la fureur de son jaloux et pileux mari. Et Perrault lui-même ? Un conte de fées n’est‑il pas chargé d’intentions ? Sa première moralité (il y en a toujours une seconde) débute ainsi :
La curiosité, malgré tous ses attraits,
Couste souvent bien des regrets
Suit un commentaire social qui laisse croire à l’adoucissement des mœurs masculines, sinon à la domestication de l’homme marié :
Il n’est plus d’époux si terrible […]
Prés de sa femme on le voit filer doux.
Dans l’ouvrage de St‑Pierre, dont le premier chapitre est humoristiquement intitulé « La morale de cette histoire », il allait de soi que le verdict tombe tôt : « Le cabinet de Barbe-Bleue, c’est le symbole de tout ce que nous n’aimons pas de nous-mêmes ». Ce que l’on pourrait voir comme un piège tendu par le mari, la clef offerte, c’est son besoin de se mettre à nu devant son épouse, qu’elle aperçoive « tout ce qu’il y a de laid en lui » et qu’elle l’aime quand même.
Comme dans Mégaptère, le récit a tôt fait de poindre. Basta Freud, le surmoi, la sublimation : devant le spectre de Barbe-Bleue, haute figure du non-parent, Thomas O. St‑Pierre se sert du sinistre cabinet pour nous raconter ce qu’a été sa vie de nouveau père. Quiconque a été un parent dépassé par la tâche sera amusé, et peut-être rasséréné, en se comparant à ceux qui apparaissent (ou disparaissent…) dans « La belle au bois dormant », « Le petit chaperon rouge », « Le petit Poucet » ou « Cendrillon », « insouciants jusqu’à la négligence et égoïstes jusqu’à la violence ». À quelque chose malheur est bon, surtout quand il arrive aux autres et que ceux-ci sont des êtres fictifs.
Il est de bon ton de déclarer que, pour arriver à aimer les autres, il importe d’abord de s’aimer soi-même. Ce principe fondamental de la psychologie populaire est d’emblée séduisant, de l’aveu de l’auteur : soit l’on parvient à atténuer la détestation de soi, ce qui, à longueur de journée, est bien avantageux ; soit l’on échoue à établir des relations harmonieuses avec autrui et l’on peut se désigner comme une victime inéluctable. À ce jeu, perdre, c’est gagner.
La réussite de l’auteur vient de ce que ses lectrices et lecteurs (mère et père, même combat !) épouseront volontiers sa position, de même que lui a fait sien le noir (bleu ?) tourment du tyrannique époux. « Nature fragile, contingente de notre humanité » : tout bien considéré, le communiqué des éditions Leméac disait juste. Par sa nature, l’essai couvre large. La collection « L’inconvénient » semble vouloir poser la vitalité de la subjectivité. Avoir des enfants et n’avoir « que [son] impuissance à leur offrir » (Le cabinet de Barbe-Bleue), être l’enfant tout aussi démunie de quelqu’un qui s’en va (Mégaptère) : sur la foi du propos des deux premiers titres, cette collection a de l’avenir.
1. Martine Béland, Mégaptère, Leméac, Montréal, 2023, 81 p.
2. Thomas O. St‑Pierre, Le cabinet de Barbe-Bleue, Leméac, Montréal, 2023, 104 p.
Prochain titre à paraître en septembre dans la collection « L’inconvénient » :
La nostalgie de Laure par Isabelle Arseneau.
EXTRAITS
Ma mère est un écosystème où je me nourris, où je me repose et m’assoupis, et dont la forme m’échappe, comme les contours des ossements de la baleine qui a sombré échappent au regard des créatures qui s’y cachent. Je dois être un bien petit poisson.
Mégaptère, p. 77.
La maison est un poème que ma mère a composé, mais qu’elle n’a pas consigné dans l’un de ses carnets. Elle est une robe que ma grand-mère s’est cousue, mais qu’elle n’a pas portée.
Mégaptère, p. 57.
Il y a des livres, des spectacles, un secteur économique tout entier consacré à la déculpabilisation des parents.
Le cabinet de Barbe-Bleue, p. 76.
Je crains d’être en train de donner un atelier pratique de haine de soi.
Le cabinet de Barbe-Bleue, p. 81.
Il s’agissait de gagner du temps contre les pleurs, c’est‑à-dire contre notre incompétence.
Le cabinet de Barbe-Bleue, p. 55.
Nous grandissons en apprenant qu’il faut se battre contre soi, comme s’il y avait au fond de chacun de nous un puits de laideur qu’il fallait à tout prix dissimuler.
Le cabinet de Barbe-Bleue, p. 21.
Essentiellement, l’espace moral est davantage peuplé de questions que de réponses.
Le cabinet de Barbe-Bleue, p. 16.











