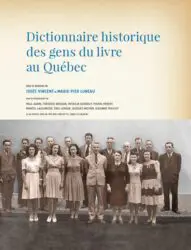Comme le français a existé avant Le Petit Larousse illustré et Le Petit Robert de la langue française, les dictionnaires ont beau être parmi les premiers ouvrages que l’on consulte quand on se lance dans l’apprentissage d’une matière, leur conception survient tard dans l’étude du sujet traité.
Il faut avoir balisé, analysé et décrit un sujet – ici l’histoire matérielle du livre chez nous – avant d’en circonscrire la trajectoire chronologique, ce qu’a fait pour l’époque moderne, sous la direction de Jacques Michon, le Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec (Université de Sherbrooke), fondé il y a une quarantaine d’années, en produisant les trois tomes de l’Histoire de l’édition littéraire au XXe siècle au Québec (Fides, 1999, 2004, 2010). On y décrit le mouvement général et le contexte ayant présidé à l’existence de cette chose à la fois puissante et fragile qu’est le livre.
Le Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, récemment paru aux Presses de l’Université de Montréal, relève quant à lui de la mosaïque, d’un découpage en plus de 400 pièces délimitées par les différentes facettes de la vie de l’imprimé, au premier chef la production et la diffusion, excluant cependant les revues, « étant donné l’ampleur du corpus » et en dépit de la proximité qu’y ont entretenue leurs animateurs avec les gens du livre, sans parler de la concomitance des idéaux ayant porté les uns et les autres. Ainsi, l’absence de mention de Lettres québécoises (187 numéros), du périodique Les libraires(de surcroît adossé à une association professionnelle), du magazine Nuit blanche (né d’une librairie, il y a 40 ans – 169 livraisons) et de la défunte revue Québec français me chagrine, vu leur longue présence dans le paysage littéraire, alors que l’on a tenu compte d’entreprises pour le moins éphémères, mais bénéficiant de la patine du temps.
Néanmoins, le Dictionnaire des gens du livre couvre large : individus, associations professionnelles et communautés religieuses ayant œuvré dans l’édition, l’imprimerie, l’illustration, la traduction, la librairie, les manuels scolaires, l’édition pour la jeunesse, la bibliothèque, la bibliophilie, en somme les différentes facettes de la vie des publications.
Une entrée à son nom dans un dictionnaire est pour quiconque une magnifique forme de tribut, un peu comme une attribution toponymique, voire l’érection d’un monument. Certaines notices se lisent dans un esprit de célébration. Une question se pose toutefois, en plus de l’évaluation du mérite à l’origine de cette forme de consécration : quand y a-t-on droit ? Sur ce point, les directrices de l’ouvrage (757 pages, sur deux colonnes), Josée Vincent et Marie-Pier Luneau, aussi de l’Université de Sherbrooke, ont statué que la date du décès (avant 2019) faisait loi.
Admettre ici des personnes encore vivantes et parfois toujours engagées dans la pratique professionnelle (la notion de retraite étant plutôt aléatoire dans cette sphère) aurait comporté sa large part de problèmes : comment établir le bilan (aspect qui clôt chaque entrée du dictionnaire) de personnes résolument actives, si elles sont encore à pied d’œuvre ?
Ne pas l’avoir fait enlève toutefois au portrait général du livre québécois des éléments primordiaux pour que nous puissions en comprendre la complexité et la richesse, certains de ses acteurs les plus importants étant toujours vivants. À titre d’exemples, pensons à un Denis LeBrun, une Marie-Madeleine Raoult, un Serge Théroux, un Paul Bélanger, un Gaston Bellemare – je m’en tiens à des amis, question de confesser la subjectivité totale du présent point de vue. Même René Bonenfant, décédé il y a bientôt trois ans, créateur du Noroît en compagnie de Célyne Fortin et formateur émérite ayant fait figure de phare, échappe au critère d’admission, si légitime soit-il.
Cette limite étant reconnue, nous avons droit à un ouvrage foisonnant (de la Nouvelle-France à presque maintenant) dont le principal mérite est probablement de rappeler à quel point le livre constitue un acteur clé dans la vie d’un pays et, qu’à ce titre, il en raconte l’histoire, fût-ce parfois par la bande. Il arrive que les gens du livre traitent de politique, qu’ils en rendent compte, d’un point de vue amical : les accointances y ont été nombreuses et parfois essentielles entre, d’une part, le pouvoir ou les autorités religieuses et, d’autre part, les imprimeurs ainsi que les éditeurs ; à l’inverse, critiquer le parti au pouvoir, surtout quand il le reste pendant longtemps, ou ne pas souscrire aux diktats de l’Église peut s’avérer dommageable – le mot est faible. La vindicte de Mgr Ignace Bourget était terrible !
Les mérites de la perspective historique sont nombreux, quoi qu’en disent ses contempteurs actuels, y compris quand elle met en lumière ces pratiques aujourd’hui répréhensibles que sont les patronages de tout poil, car elle permet ainsi d’évaluer le chemin parcouru, par exemple quant au rôle des femmes dans l’édition et au commentaire sur les livres.
Par leur nature biographique, les entrées permettent de reconstituer l’histoire du livre à partir de ses artisans, perspective d’autant plus agréable qu’il s’agit d’un monde tributaire d’initiatives individuelles, voire de personnalités. En cela on se situe près de la littérature elle-même (ainsi, Réjean Ducharme, pas loin d’être un ovni, a entraîné une kyrielle d’écrivains dans son sillage). Chez les professionnels du livre, ils ont pour nom Fleury Mesplet, Ægidius Fauteux, Louvigny de Montigny, Albert Lévesque, John Lovell, Marie-Claire Daveluy, Philip Stratford, Pierre Tisseyre, Simone Bussières, Georges Laberge, Lise Bergevin, chacun à sa façon.
L’effet de mosaïque pourrait faire voir de nombreux arbres plutôt que la forêt ; heureusement, l’ouvrage s’ouvre sur une éclairante introduction de Vincent et Luneau, que l’on relira à profit en fin de parcours. On pourra aussi y aller de ses propres constats. M’a frappé la place occupée par l’édition de qualité, de riche facture matérielle, alors que l’édition courante peinait parfois à s’établir (à cet égard, l’ascension de Pierre Péladeau, fondée sur la culture populaire, illustre la trajectoire inverse). Peut-on y voir la marque d’un souci de noblesse, un idéal esthétique, un idéal de beauté ?
Le livre est grand, l’univers du livre est vaste ; ce livre-ci en rend compte.