J’étais étudiant lorsque j’ai entendu parler pour la première fois de la ville de Moncton, capitale culturelle acadienne. On avait dit devant moi : « Moncton est la ville la plus laide du Canada ». Quelques années plus tard, j’ai connu un Acadien originaire de Moncton, mais établi à Québec, qui lui non plus n’en pensait rien de bon.
Il m’a fallu lire un roman de France Daigle, Pas pire, publié en 1998, pour découvrir que la littérature acadienne ne se résumait pas à la Sagouine et à Pélagie-la-Charrette (1979) d’Antonine Maillet, pour aimer la ville de Moncton et avoir envie de la connaître. Dans cet ordre : aimer d’abord, parce que la littérature est au préalable une émotion ; connaître ensuite. Comme cela arrive parfois en amour. Depuis, je ne refuse aucune occasion d’aller à Moncton, car cette ville peut-être laide (appréciation subjective et relative) est devenue pour moi belle et fascinante par la littérature (sentiment tout aussi subjectif et relatif). Cette expérience littéraire qui assimile la nature des lieux pour la transformer dans le regard et le cœur du lecteur, c’est proprement le sujet du captivant petit essai de Benoit Doyon-Gosselin, Moncton mentor. Géocritique d’une ville1.
Ce dernier est professeur de littérature à l’Université de Moncton. Je me souviens, en mai 2011 dans un colloque à Fredericton (il était alors jeune professeur à l’Université Laval, qu’il devait quitter ensuite pour l’Université de Moncton), l’avoir entendu dire son admiration pour des essais rédigés dans le style des Littératures de l’exiguïté (1992) de François Paré, ouvrage célèbre sur les « petites » littératures, les corpus minoritaires qui sont en manque de reconnaissance institutionnelle. Doyon-Gosselin y a visiblement trouvé son inspiration de ton et de forme pour écrire Moncton mentor. Cela donne un essai qui, dans sa structure fragmentée, est à la fois personnel et savant, un livre pleinement accessible à tout lecteur, car il sait rendre très simple et très clair un discours complexe.
Il s’agit donc d’un essai de géocritique, et plus que cela : à la fois l’une des meilleures introductions à ce mode d’analyse que l’on puisse trouver et un livre que l’on prend plaisir à lire comme un roman. « La littérature transcrit une expérience des lieux, critique et parfois transforme la réalité. L’étude de l’expérience multiple des lieux par et dans la création, littéraire ou autre, se nomme la géocritique. Cette approche tente de mieux saisir les identités culturelles », rappelle Doyon-Gosselin avant de citer le chef de file de la géocritique, Bertrand Westphal, pour qui il s’agit « d’une véritable dialectique (espace-littérature-espace) qui implique que l’espace se transforme à son tour en fonction du texte qui, antérieurement, l’avait assimilé ».
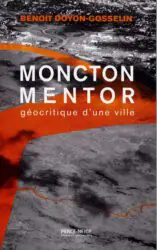 C’est ainsi que l’essayiste arpente Moncton, nous promène d’un lieu à l’autre (cafés, parcs, institutions, etc.) à travers le prisme de la littérature et parfois des arts visuels, cherchant à montrer comment les écrivains et les artistes – qui habitent ou non à Moncton (comme le romancier Jacques Ferron ou le poète Jean-Paul Daoust), et à partir de points de vue complémentaires mais aussi divergents –, ont contribué à fonder la représentation et l’appropriation culturelles francophones de la ville acadienne. Ici, la cour Robinson et ses cafés, mythifiés par Gérald Leblanc, Mathieu Gallant, Sarah Marylou Brideau et d’autres. Là, le parc Victoria ; ailleurs, le théâtre l’Escaouette, les rues de Moncton. Car Moncton est une capitale littéraire et culturelle seulement en français. Doyon-Gosselin observe que, si la ville est composée de 80 % d’anglophones, l’imaginaire littéraire de Moncton n’existe guère en anglais.
C’est ainsi que l’essayiste arpente Moncton, nous promène d’un lieu à l’autre (cafés, parcs, institutions, etc.) à travers le prisme de la littérature et parfois des arts visuels, cherchant à montrer comment les écrivains et les artistes – qui habitent ou non à Moncton (comme le romancier Jacques Ferron ou le poète Jean-Paul Daoust), et à partir de points de vue complémentaires mais aussi divergents –, ont contribué à fonder la représentation et l’appropriation culturelles francophones de la ville acadienne. Ici, la cour Robinson et ses cafés, mythifiés par Gérald Leblanc, Mathieu Gallant, Sarah Marylou Brideau et d’autres. Là, le parc Victoria ; ailleurs, le théâtre l’Escaouette, les rues de Moncton. Car Moncton est une capitale littéraire et culturelle seulement en français. Doyon-Gosselin observe que, si la ville est composée de 80 % d’anglophones, l’imaginaire littéraire de Moncton n’existe guère en anglais.
L’essayiste évoque aussi des projets collectifs, comme celui de « Moncton 24 » (en 2012), où vingt-quatre écrivains, pendant vingt-quatre heures, ont écrit depuis et sur un lieu de la ville, afin « de créer une cartographie mentale de Moncton », ou encore l’activité « Une ville, un livre » (en 2016), qui consistait en une promenade littéraire balisée par des poèmes reproduits sur des panneaux.
Parfois, les créations artistiques inventent carrément un espace francophone, comme la carte du faux métro de Mark Young, qui se superpose à l’espace référentiel en lui substituant un imaginaire essentiellement francophone, ou encore le quartier de la Terre-Rouge qu’imagine France Daigle dans Pas pire. Le poète Raymond Guy LeBlanc refait à sa guise le quartier de son enfance : « J’entre en ville sur le chemin du roi je rebaptise les rues pour l’avenir pour l’héritage / La rue Cornhill porte le nom Dupuis Marie à Ferdinand ma mère. » Doyon-Gosselin rappelle que, à l’occasion du Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Moncton en 1999, le conseil municipal avait pris la décision de changer trois noms de rue afin d’honorer la mémoire historique francophone. « À ce moment, il y avait 32 rues avec un nom français sur plus de 920 rues, alors que la population francophone s’élevait à plus de 33 %. On comprend mieux pourquoi le fantasme de l’odonymie francophone devient un élément crucial de la géocritique de Moncton », commente l’essayiste.
Il n’y a pas que la littérature qui transforme une ville, il y a aussi le temps. La géocritique s’attache également à saisir la manière dont agit la superposition des strates de temps dans un lieu donné. La Déportation ou les combats collectifs au tournant des années 1970 font partie de l’appréhension géocritique de l’Acadie, ils sont très souvent (surtout dans le premier cas) sous-jacents à la saisie imaginaire de la ville contemporaine. Se déploie en somme l’image d’une ville profondément remodelée par la littérature et les arts, une ville qui habite notre imaginaire autant qu’elle est physiquement habitée, cette dynamique instaurant un va-et-vient créateur entre le passé et le présent, entre le présent et l’avenir que construit un héritage culturel composite, à la fois matériel et fictionnel.
À cet égard, certains référents sont devenus des hauts lieux de la culture acadienne : le Centre culturel Aberdeen, l’Université de Moncton, la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, qui joue un rôle central dans un roman de Pierre-André Doucet, Des dick pics sous les étoiles (2020). La rivière Petitcodiac et son mascaret occupent une place privilégiée ; ils se donneraient à lire notamment comme métaphore de la séparation entre deux univers linguistiques et culturels distincts, où le « mouvement de l’eau de l’aval vers l’amont » symboliserait « le retour [des Acadiens] sur leur terre natale ». C’est le propre de l’écrivain d’influer sur le monde, de le transformer, de le fabriquer, de l’improviser, voire de le contredire. D’écrire son histoire, de se réinscrire dans l’histoire.
Moncton mentor. Géocritique d’une ville donne envie de lire et de se déplacer dans la ville. Lecteur, si tu n’as pas encore mis les pieds à Moncton, découvre d’abord Pas pire, roman exemplaire qui a aussi été le premier contact de Benoit Doyon-Gosselin avec cette ville. D’autres romans de France Daigle redonnent vie aux personnages et à l’imaginaire de la ville de ce roman inaugural : Un fin passage (2001), Petites difficultés d’existence (2002), Pour sûr (2011). Lis aussi la poésie de Gérald Leblanc, poète majeur de la modernité acadienne et auteur de Moncton Mantra (1997), roman auquel le titre du livre de Doyon-Gosselin fait un clin d’œil. Prends la mesure de la poésie et du cinéma de Paul Bossé. Regarde, absolument, le magnifique documentaire de Michel Brault et Pierre Perrault, L’Acadie, l’Acadie ?!? (1971) : ce film sur les grèves étudiantes de la fin des années 1960 à l’Université de Moncton est une autre façon de prendre le pouls d’une émotion, d’une indignation, d’un imaginaire. Grâce à ces auteurs, à ces créateurs, à bien d’autres encore, les balises topographiques de Moncton ont fait fi des limites. « Moncton était au départ une ville mineure où les tensions entre les anglophones et les francophones ont pendant longtemps été très présentes. Avec le temps, grâce aux mots des poètes, aux créations en arts visuels, aux chansons qui nous habitent, Moncton est tout simplement devenu un mythe majoritairement francophone dans l’imaginaire. La mythologie acadienne », écrit l’essayiste dans les dernières pages de son ouvrage.
Moncton un jour, Moncton toujours.
1. Benoit Doyon-Gosselin, Moncton mentor. Géocritique d’une ville, Perce-Neige, Moncton, 2022, 137 p.
EXTRAITS
Pourquoi cet insatiable désir envers Moncton ? Peut-être en raison de mes propres déplacements. De Trois-Rivières à Kingston, de Winnipeg à Moncton, de Moncton à Québec and back. Lieux de passage. Passage du temps. Où serai-je dans dix ans ? Que serai-je dans vingt ans ? Moncton aura été le lieu d’une émancipation intellectuelle, de la passion pour une littérature, des interactions entre les deux.
Benoit Doyon-Gosselin, Moncton mentor. Géocritique d’une ville, p. 137.
Moncton comprend également deux villes superposées. Il y a bien sûr des échanges entre les gens et entre les langues. Disons simplement qu’une ville est certainement plus indifférente au sort de l’autre parce que dans l’espace public, elle ne doute jamais de son existence. Elle a laissé à l’autre ville la fiction comme prix de consolation.
Benoit Doyon-Gosselin, Moncton mentor. Géocritique d’une ville, p. 60.
Le monument aux Thibaudot, aux Breau et aux Babinot, premiers colons de la Terre-Rouge, reposait déjà sur son socle, mais il était recouvert d’une toile. Les ouvriers achevaient l’aménagement paysager de la place. Terry Thibodeau se pencha au pied du monument et ramassa une poignée de terre.
— C’est supposé que la terre était vraiment plusse rouge dans ce coin-icitte. C’est pour ça qu’y’avont appelé ça Terre-Rouge. Y’en a qui disont qu’y’avait une autre rivière, la Scoudouc, qui venait rencontrer la Petitcodiac que’que part alentour pis que c’est cte rivière-là qui aurait amené la terre rouge de l’Île-du-Prince-Édouard jusqu’à icitte.
France Daigle, Pas pire, p. 136.
En fin d’après-midi, en sortant du bureau, je me promène souvent en ville. Je m’imprègne de son rythme, de ses rues, de son affichage unilingue et de ses langues oscillantes. L’effet me déroute souvent. J’ai l’impression que ma langue n’appartient pas à ce décor, tout en sachant qu’elle habite cette ville depuis toujours, subtile et séditieuse. Je remarque, après avoir décidé de ne plus parler anglais nulle part, que je l’entends moins. Ou plutôt le français passe au premier plan, entouré d’un bruit autre, comme celui d’une radio qui joue dans une pièce à côté. Ainsi, je circule dans ma langue en explorant ma ville.
Gérald Leblanc, Moncton Mantra, p. 54-55.











