Tout le monde sait à peu près qui est l’auteur, médecin urgentologue, ex-chef du Département de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal et professeur titulaire à l’Université de Montréal. Il est aussi chroniqueur au magazine L’actualité.
Il est souvent appelé à donner son avis dans différents médias. Il ne manque pas d’humour non plus, ce qui paraît, à l’occasion, dans ses deux livres portant directement sur le système de santé, parus à dix ans d’intervalle.
Qui voudrait en savoir plus sur le cheminement de l’individu aurait intérêt à lire d’abord l’ouvrage paru en 20121. En effet, une trentaine de pages sont consacrées à son choix de carrière, à ses hésitations, à son voyage de réflexion et à la reprise de ses études.
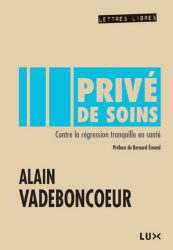 Il hésitait entre mathématiques et médecine, mais opta finalement pour celle-ci. Il opta pour la vie. Toutefois, en troisième année, il trouva ses cours tellement ennuyants qu’il abandonna et partit faire un long voyage qui le mena de l’Angleterre à l’Algérie. Et c’est au milieu du désert, à Timimoun, que son ami Mohammad le convainquit de la stupidité de son abandon. D’ailleurs, le vice-doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal lui avait laissé entendre qu’une pause pourrait lui être salutaire et qu’il serait le bienvenu s’il changeait d’idée. Heureusement pour nous, il revint terminer ses études, tout en exerçant tôt un regard critique sur le système qui le formait.
Il hésitait entre mathématiques et médecine, mais opta finalement pour celle-ci. Il opta pour la vie. Toutefois, en troisième année, il trouva ses cours tellement ennuyants qu’il abandonna et partit faire un long voyage qui le mena de l’Angleterre à l’Algérie. Et c’est au milieu du désert, à Timimoun, que son ami Mohammad le convainquit de la stupidité de son abandon. D’ailleurs, le vice-doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal lui avait laissé entendre qu’une pause pourrait lui être salutaire et qu’il serait le bienvenu s’il changeait d’idée. Heureusement pour nous, il revint terminer ses études, tout en exerçant tôt un regard critique sur le système qui le formait.
La première partie de Privé de soins est donc teintée d’autobiographie. Suivent deux autres parties dans lesquelles l’auteur prend la réalité du système de santé à bras le corps : « Éthique » et « Vital ».
« Éthique » est une attaque en règle contre les mirages du privé qui se présente comme une panacée séduisante. Vadeboncœur ne changera pas sa position d’un iota en 2022. Il demeure toujours un ardent défenseur du système public, et ce, malgré l’arrêt Chaoulli de 2005 qui a ouvert la voie du privé à des patients devant attendre plus de six mois pour certaines chirurgies.
Un des problèmes avec le privé est qu’il tend à ne choisir que des clients rentables : jeunes, à l’aise financièrement et pas trop malades. Dès que les cas deviennent trop compliqués, le public s’en charge, puisque les compagnies offrant une assurance médicale privée ne couvrent pas les problèmes trop aigus. On voit que la médecine privée, selon Vadeboncœur, est d’abord motivée par l’efficacité de sa production ; bref, c’est avant tout l’argent qui se trouve au cœur de cette médecine. Le médecin entrepreneur supplante le médecin soigneur. Et si de plus en plus de médecins de famille désertent pour le privé, plus de gens devront chercher un autre médecin, ce qui crée ce cercle vicieux d’un système public qui ne parvient pas à bien soigner. Le privé coûte cher en argent public, nous rappelle Vadeboncœur. L’auteur nous donne à lire une touchante lettre, « Nous sommes ensemble », qu’il a envoyée à un ami médecin parti au privé afin de travailler moins et de faire plus d’argent.
L’urgentologue sait que le système public est malmené, qu’il connaît des ratés ; Vadeboncœur ne joue pas à l’autruche. Mais pendant que l’on émet ces critiques, il ne faut pas non plus passer sous silence tout ce qui s’y fait de bien (le chroniqueur peut même en témoigner).
La dernière partie, « Vital », quitte le terrain de la critique négative. Au-delà du diagnostic et du pronostic de la maladie du système si rien n’est fait, le docteur y va de ses suggestions thérapeutiques. Il résume en un seul paragraphe d’une dizaine de lignes son programme (page 224) et reprend ensuite, une à une, chacune des parties de ce programme en soulignant ce qui lui semble le plus viable, efficace et humain possible.
Prendre soin
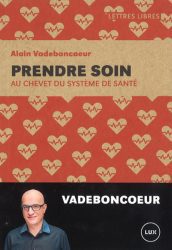 Dix ans plus tard2, Vadeboncœur reprend essentiellement les suggestions qu’il avait déjà proposées (le même projet, résumé en une douzaine de lignes, avec de légères modifications). Il les complète en tenant compte des intentions du ministre de la Santé d’alors, Christian Dubé, et en y introduisant des personnages fictifs perdus dans les méandres du système de santé.
Dix ans plus tard2, Vadeboncœur reprend essentiellement les suggestions qu’il avait déjà proposées (le même projet, résumé en une douzaine de lignes, avec de légères modifications). Il les complète en tenant compte des intentions du ministre de la Santé d’alors, Christian Dubé, et en y introduisant des personnages fictifs perdus dans les méandres du système de santé.
Il est impossible ici de reprendre toutes les idées exposées. Retenons-en quelques-unes.
À propos des ententes professionnelles, Vadeboncœur trouve injustes – et comment lui donner tort sur ce point ? – les gains financiers disproportionnés obtenus par certains spécialistes, gains dus uniquement aux avancées techniques (les scanneurs, notamment) et non à des qualités individuelles. Par exemple, les chirurgies de la cataracte s’effectuent maintenant bien plus rapidement, mais les patients des psychiatres, eux, ne se sont pas mis à parler plus vite avec le temps. Il aurait au moins fallu penser à une baisse des tarifs ou à une forme de répartition des gains avec d’autres professionnels, ce qui n’a pas été le cas. Quant au manque de médecins, l’auteur le dit on ne peut plus clairement : « [N]ous devrions disposer de plus de médecins et les payer moins, surtout en spécialités. Notre situation se rapprocherait alors de celle de l’Europe ». Et pourquoi ne pas réunir les deux fédérations de médecins, demande-t-il pertinemment ? Il n’y a qu’au Québec que l’on fait cette séparation entre omnipraticiens et spécialistes.
Dans « … il faut simplement soigner… », Vadeboncœur plaide en faveur d’une décentralisation. Le décideur d’en haut doit demeurer en contact avec ceux d’en bas, y compris les malades. L’auteur croit beaucoup au travail collectif. De plus, il désire que l’on se montre ouvert à ce qui se fait ailleurs, à commencer par le Canada. Dans la partie « … sans nuire… », qui fait allusion à la maxime « Avant tout, ne pas nuire », fondamentale en médecine, il demande à ces mêmes décideurs de faire attention aux remèdes de cheval, qui peuvent faire plus de mal que de bien. Il s’agit de trouver un juste milieu entre nécessité d’agir et prudence nécessaire. Dans la partie « … reçoive du bon soignant… », il déplore que trop de spécialistes s’occupent de cas pouvant être vus par des généralistes ou du personnel infirmier. Pourquoi un pédiatre devrait-il voir, par exemple, des enfants en bonne santé pour une simple visite de routine ?
Ces propositions émanant d’un acteur du milieu qui réfléchit à ces questions depuis plus de 30 ans sont les bienvenues. Elles intéresseront non seulement les professionnels de la santé, mais toute personne se préoccupant de ces questions.
Maintenant, faut-il avoir les deux ouvrages, celui de 2012 et celui de 2022 ? Embêtant. Se procurer uniquement le second reviendrait à se passer du récit autobiographique et de la critique du privé contenus dans le premier. Et n’avoir sous les yeux que le premier, ce serait se passer des mises à jour de 2022. Si un lecteur entreprend comme moi de lire à la suite Privé de soins et Prendre soin, il remarquera de nombreuses répétitions. Il ne s’agit pas que d’une vague impression, puisque de nombreux passages sont repris tels quels de l’édition de 2012. Vadeboncœur le reconnaît, tout en mentionnant qu’il s’agit d’un ouvrage « renouvelé en profondeur » dont il « a réécrit tous les chapitres ». Ce n’est, hélas, pas toujours le cas. L’espace manque ici pour en faire la démonstration, mais il suffit d’avoir sous les yeux les deux livres pour le constater. Il faut toutefois admettre que des mises à jour sont présentes, que la nomination du ministre Dubé a changé un peu la donne et qu’il y a introduction de personnages. À cela s’ajoute que la partie sur le financement est bien plus développée en 2022, puisqu’elle tient compte des propositions de Dubé.
Cette réédition « renouvelée » se termine avec une toute nouvelle partie : « … à penser globalement et agir localement… ». Vadeboncœur nous invite à nous engager tous, et à ne pas accepter quand ça fonctionne tout croche, comme ces insupportables et trop longues attentes.
À votre santé !
1. Alain Vadeboncœur, Privé de soins. Contre la régression tranquille en santé, Lux, Montréal, 2012, 304 p.
2. Alain Vadeboncœur, Prendre soin. Au chevet du système de santé, Lux, Montréal, 2022, 148 p.
EXTRAITS
On pourrait également imaginer des infirmières praticiennes de première ligne, formées et disponibles, offrant une alternative pour régler ce problème d’accès. Ces professionnelles sont d’ailleurs largement déployées ailleurs au Canada et aux États-Unis, mais pratiquement absentes chez nous en raison d’une résistance médicale historique.
Privé de soins, p. 151-152.
Alors continuons à réfléchir, mais en tenant bien compte de tous les faits pertinents et de toutes les expériences. Notre façon de faire n’est pas la seule possible et il y en a sûrement des meilleures, bien entendu, mais on en retrouve aussi de bien pires !
Prendre soin, p. 125.
[N]ous devrions disposer de plus de médecins et les payer moins, surtout en spécialités, pour nous retrouver ainsi dans une situation qui ressemblerait à celle de l’Europe. Voilà, c’est dit.
Prendre soin, p. 48.









