« Si vous ne souhaitez pas passer aux yeux des autres pour un raté, prévenait Simon Nadeau en guise d’avertissement dès son premier roman, jetez ce livre, passez votre chemin, ou mieux : campez-vous à l’abri devant votre écran de télévision. »
Le ton était donné, le propos bien cerné, l’image on ne peut plus claire. La littérature peut divertir, mais elle n’est pas que divertissement. Elle peut subitement, brusquement, secouer le lecteur, voire changer le cours d’une vie. D’où cet avertissement au lecteur, sous le signe de l’ironie, bien entendu.
Les Nord-Américains passent en moyenne 34 heures par semaine devant leur écran de télévision, découvre avec stupéfaction Mèche-au-Vent, le personnage principal de L’art de rater sa vie. Et c’est sans compter les heures figées devant les autres écrans : ordinateur, tablette, cellulaire. Connaissent-ils mieux le monde dans lequel ils vivent ? Ont-ils une meilleure compréhension des grands défis auxquels nous sommes confrontés ? Ont-ils une meilleure connaissance d’eux-mêmes ? Attitude relevant d’une véritable religion – au sens propre, puisque nous communions aujourd’hui davantage par écrans interposés que par rencontres et échanges véritables –, nous vénérons nos écrans qui, en retour, savent nous maintenir captifs et dociles, heureux en quelque sorte, en plus d’annihiler tout désir de résistance. Finis les sacrifices et génuflexions d’autrefois. Être aujourd’hui privés de notre cellulaire relève de l’amputation d’une partie de notre être et nous condamne à l’isolement social. S’affranchir d’un tel joug exige une prise de conscience afin de se faire violence, de se libérer d’une dépendance aussi forte que celle que peuvent entraîner l’alcool, la drogue ou quelque croyance dure (comme on dit une drogue dure). Mais n’est-ce pas le propre de toute religion que de nous garder bien serrés à l’intérieur de ses rangs, à l’abri de toute errance, de tout désir de liberté ?
Être soi-même un monde
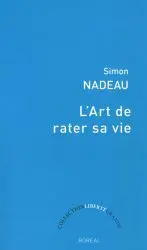 Dans ce premier roman, Simon Nadeau relate, dans une langue tout aussi imagée que soignée, l’apostasie télévisuelle de Mèche-au-Vent et sa découverte de la lecture, qui va lui permettre d’entrevoir l’immensité et la richesse d’un tout autre monde avec, comme guides, des auteurs de la trempe de Rimbaud, de Baudelaire, de Camus, de Vian. Les philosophes et les peintres – notamment Héraclite, Thoreau, Nietzsche, Shitao et Cézanne – seront également appelés à la rescousse « pour régénérer une civilisation gagnée par le nihilisme et la barbarie ».
Dans ce premier roman, Simon Nadeau relate, dans une langue tout aussi imagée que soignée, l’apostasie télévisuelle de Mèche-au-Vent et sa découverte de la lecture, qui va lui permettre d’entrevoir l’immensité et la richesse d’un tout autre monde avec, comme guides, des auteurs de la trempe de Rimbaud, de Baudelaire, de Camus, de Vian. Les philosophes et les peintres – notamment Héraclite, Thoreau, Nietzsche, Shitao et Cézanne – seront également appelés à la rescousse « pour régénérer une civilisation gagnée par le nihilisme et la barbarie ».
Empruntant à la fois à l’univers créatif de Boris Vian, à celui de Hermann Hesse, de Goethe, de Nietzsche, à la singularité des personnages d’Emmanuel Bove, Simon Nadeau procède à un renversement des valeurs, redonnant à la lecture et à l’apprentissage un rôle pouvant conduire à créer de véritables communautés d’esprit. Dans L’art de rater sa vie, qui a tout du roman d’initiation, Mèche-au-Vent comprend que la lecture est la seule vraie voie qui puisse lui permettre de naître à lui-même. Pour ce faire, il doit d’abord quitter son groupe d’amis, accepter sa solitude et chercher une nouvelle communauté de déserteurs qui, à son image, sont en quête d’un monde qui leur offre davantage que les mirages d’un bonheur aseptisé et formaté pour défiler sur les milliers d’écrans qui captent notre attention et font de nous des êtres passifs le plus souvent satisfaits du sort qu’on leur offre. Ce que veut justement combattre Mèche-au-Vent, qui craint un jour de se réveiller devant un écran en se disant que telle n’est pas la vraie vie, telle n’est pas celle qu’il souhaitait mener. « Les bien-portants s’adaptent bien au monde tel qu’il est : ce sont de braves gens, de bons vivants, mais leur puissance cache parfois une impuissance plus grande encore. La véritable puissance, pensait-il désormais, ne consiste pas tant à s’adapter au monde tel qu’il est pour devenir l’un des puissants de ce monde qu’à être soi-même un monde, un nouveau monde, et à avoir la force de l’exprimer et de le défendre. »
Se risquer à plonger dans un livre, semble nous dire Simon Nadeau par l’intermédiaire de ses personnages, c’est accepter de se mettre à son tour en danger, de ne pas anticiper les réponses aux questions que l’on se pose, de prendre conscience que le monde est plus vaste, plus complexe, plus riche que ce que l’on veut bien nous laisser (entre)voir et entendre. Les voies qu’il prend pour illustrer son point de vue, pour défendre les idées qu’il avance sont multiples. Le roman emprunte diverses formes, diverses trajectoires, dont l’ironie lorsque l’auteur pose un regard critique sur la formation universitaire qui, à ses yeux, s’est éloignée de sa vocation première. « Nous vivons dans un monde de ruines avec des gratte-ciel. Ce n’est pas contradictoire : les ruines de l’esprit peuvent prendre les formes les plus avant-gardistes ! »
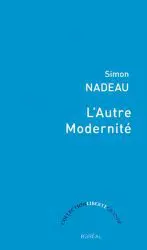 Un tel réquisitoire contre l’idée d’une certaine modernité (idée que Simon Nadeau déploiera dans L’autre modernité, recueil d’essais qui, justement, questionnent le passage à la modernité de la littérature et de la société québécoises sous divers angles), du confort matériel que nous avons érigé en barème de réussite sociale, et qui cache le plus souvent une certaine paresse morale et intellectuelle, vient aussi avec son lot de répétitions et de dérision, dont n’est pas exempt L’art de rater sa vie qui a par moments des élans pamphlétaires. La plupart des personnages agissent ici comme des avatars ayant pour fonction d’étayer le propos de l’auteur qui n’hésite pas, par moments, à avoir recours à l’autodérision pour éviter de verser dans les propres travers qu’il s’efforce de dénoncer.
Un tel réquisitoire contre l’idée d’une certaine modernité (idée que Simon Nadeau déploiera dans L’autre modernité, recueil d’essais qui, justement, questionnent le passage à la modernité de la littérature et de la société québécoises sous divers angles), du confort matériel que nous avons érigé en barème de réussite sociale, et qui cache le plus souvent une certaine paresse morale et intellectuelle, vient aussi avec son lot de répétitions et de dérision, dont n’est pas exempt L’art de rater sa vie qui a par moments des élans pamphlétaires. La plupart des personnages agissent ici comme des avatars ayant pour fonction d’étayer le propos de l’auteur qui n’hésite pas, par moments, à avoir recours à l’autodérision pour éviter de verser dans les propres travers qu’il s’efforce de dénoncer.
Le monastère buissonnier
Le second roman de Simon Nadeau, Le monastère buissonnier, se déploie, comme le précédent, en récits successifs, dans des lieux et des époques chaque fois différents. Certains des thèmes abordés dans L’art de rater sa vie, et dans les essais réunis dans L’autre modernité, sont ici repris et déployés sous d’autres angles. Le début du premier récit, en plus de marquer un lien fort avec le roman précédent, donne déjà le ton : « Chéris le désert où tu es seul avec ta soif. Et dis-toi bien que lorsque tu as soif tu vis ». Ainsi, c’est à l’enseigne de préoccupations philosophiques et métaphysiques que Simon Nadeau nous invite à poursuivre notre quête, à titre de lecteur, en compagnie cette fois de La-Mèche-Noire, double du narrateur que nous avons suivi dans le précédent roman. Le propos, la démarche, de même que le ton, adoptent par moments des attributs professoraux, et le roman n’est pas sans rappeler les enseignements de Joseph Valet dans le roman de Hermann Hesse, Le jeu des perles de verre : la découverte de soi, les voies parallèles pour y parvenir, la prise de risque, les formules métaphoriques comme autant d’énigmes à déchiffrer. Sans se présenter comme un roman à clés, Le monastère buissonnier, par la présence du désert, des étoiles, par l’importance accordée à la musique et par les histoires qui s’y succèdent, évoque par moments l’atmosphère des contes des Mille et une nuits. Chacun des récits est en quelque sorte mis en miroir avec les autres. Le côté initiatique se présente ici sous une autre forme, mais le but, avoué ou non, demeure le même, comme le laisse entendre l’histoire d’Atsumi, jeune fille demeurée trop longtemps docile pour se conformer aux attentes de ses parents : « Aujourd’hui, elle essayait de faire entendre sa petite musique intérieure, quelque chose de très personnel – comme une respiration, un battement de cils, un soupir ».
Chacun des récits livre une histoire qui vient illustrer un propos, par exemple Atsumi qui cherche à prendre son envol, à assumer les désirs qui couvent en elle. Dans le récit éponyme qui suit, La-Mèche-Noire s’interroge sur les bienfaits de la technologie, sur son pouvoir ambivalent : nous asservit-elle davantage qu’elle ne nous libère de diverses contraintes que nous nous sommes créées ? Le constat est livré sans aucune ambiguïté : « À l’aide de leur intelligence fabricatrice et en se servant des progrès accomplis par la science et la technique de leur temps, ils (les Steve Jobs et les Mark Zuckerberg de ce monde) ont inventé des objets et des programmes informatiques qui permettent à l’esprit de s’aliéner lui-même ». D’où le constat qui revient dans chacun des romans : la faillite de l’idée d’une certaine culture qui nous élèverait, nous transcenderait.
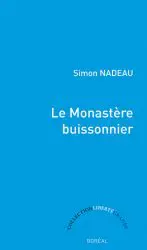 Des thèmes se répondent d’un récit à l’autre : l’appel d’une vie plus riche ; la nécessité de fuir la monotonie du quotidien, de s’affranchir des servitudes, des besoins matériels que l’on se crée ; la reconquête d’une vie spirituelle sacrifiée à l’autel du consumérisme ; l’importance de reconstituer des communautés d’esprit, de privilégier l’esprit critique à toute forme de soumission, d’assujettissement aux idées prétendument neuves et aux courants de pensée en mal d’adeptes. Le monastère représente ici le lieu idéalisé où l’on peut encore espérer trouver refuge, se sentir solidaires avec d’autres déserteurs et croire en l’avènement d’un monde meilleur. Cinq jeunes prennent ce risque en posant les bases d’une communauté appelée à défier les règles et les structures d’une société sclérosée, et ainsi parvenir à « enrayer la chute de l’esprit, l’enlisement de la conscience, le déclin de la liberté intérieure ». À nouveau, la critique faite à l’égard des universités est sévère.
Des thèmes se répondent d’un récit à l’autre : l’appel d’une vie plus riche ; la nécessité de fuir la monotonie du quotidien, de s’affranchir des servitudes, des besoins matériels que l’on se crée ; la reconquête d’une vie spirituelle sacrifiée à l’autel du consumérisme ; l’importance de reconstituer des communautés d’esprit, de privilégier l’esprit critique à toute forme de soumission, d’assujettissement aux idées prétendument neuves et aux courants de pensée en mal d’adeptes. Le monastère représente ici le lieu idéalisé où l’on peut encore espérer trouver refuge, se sentir solidaires avec d’autres déserteurs et croire en l’avènement d’un monde meilleur. Cinq jeunes prennent ce risque en posant les bases d’une communauté appelée à défier les règles et les structures d’une société sclérosée, et ainsi parvenir à « enrayer la chute de l’esprit, l’enlisement de la conscience, le déclin de la liberté intérieure ». À nouveau, la critique faite à l’égard des universités est sévère.
Dans l’univers qui se déploie dans les romans de Simon Nadeau, le mendiant est plus heureux, plus libre qu’un roi qui ne cherche qu’à accumuler davantage de richesse et à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour la préserver. Chacun des récits fait l’éloge non seulement du vagabondage pour échapper à l’enlisement, à la paralysie de mouvement et de pensée, mais aussi de la liberté de création pour parvenir à donner sa pleine mesure à l’îlot d’humanité que chacun de nous abrite en son for intérieur. À notre tour, il nous faut accepter d’être un lecteur modeste, et emprunter un parcours plus ou moins sinueux qui nous imposera parfois de faire une pause, de nous interroger sans pour autant trouver réponse à chacune de nos questions. Mais qu’est-ce au fond qu’un lecteur, sinon un véritable vagabond ?
Livres lus pour le présent article (tous parus dans la collection « Liberté grande », chez Boréal) :
L’art de rater sa vie, 2018, 280 p. ; L’autre modernité, prix Gabrielle-Roy 2013, 2013, 240 p. ; Lemonastère buissonnier, 2022, 304 p.
EXTRAITS
Le livre idéal, à tout âge de la vie, n’est-il pas celui qui ébranle la conscience du lecteur pour l’amener ailleurs, l’ouvrir et la dépayser ?
L’art de rater sa vie, p. 29.
Le téléphone portable avait pour vocation de rassurer chacun sur sa propre réalité en lui rappelant qu’il n’était au fond jamais seul, qu’il existait toujours pour les autres et que les autres existaient toujours pour lui…
L’art de rater sa vie, p. 94.
Il aimait l’art qui s’arrache à la lourdeur du monde pour nous affranchir et nous indiquer notre véritable destination. Le réel, selon lui, n’était pas le but de l’art, mais le réel transfiguré, incandescent, transpercé de part en part par l’esprit qui libère et le désir qui rassemble.
Le monastère buissonnier, p. 141.
Il faut vivre dans un monde où tout est à l’envers pour trouver qu’il est risqué d’adopter et d’éduquer quelques adolescents pour les rendre dignes de ce qu’ils portent en eux sans le savoir. Vous préféreriez qu’on les égorge dans la rue ? Ou qu’on les laisse devant les écrans se vider du peu d’esprit qu’ils ont ?
Le monastère buissonnier, p. 228.
Et lorsque l’écrivain, dans un moment de solitude, fera retour sur lui-même – quand bien même tous ses personnages l’abandonneraient –, il lui restera encore un ami fidèle, un peu incrédule : le lecteur inconnu.
Le monastère buissonnier, p. 252.











