L’attribution en 2022 du prix Nobel de littérature à l’écrivaine Annie Ernaux a donné à la littérature intimiste ses lettres de noblesse. Par « intimiste », on entend tout texte qui puise à l’expérience de vie des auteur(e)s, que cela prenne la forme du journal, du récit autobiographique ou autoréférentiel, ou de l’écrit autofictionnel.
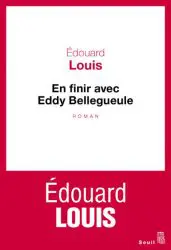 Outre Annie Ernaux, le genre littéraire dit « intimiste » est associé à plusieurs écrivains et écrivaines, dont nombre d’homosexuels. Hervé Guibert vient à l’esprit chez les Français, de même qu’Édouard Louis. Admirateur d’Ernaux, ce dernier s’est imposé sur le plan international grâce à son récit intitulé En finir avec Eddy Bellegueule (Seuil, 2014). Dans cet ouvrage et les suivants qu’il publia, Édouard Louis a narré le combat – non seulement physique, mais aussi intellectuel et social – qu’il a mené pour s’extirper du milieu défavorisé de ses origines. Milieu qui refusait son homosexualité.
Outre Annie Ernaux, le genre littéraire dit « intimiste » est associé à plusieurs écrivains et écrivaines, dont nombre d’homosexuels. Hervé Guibert vient à l’esprit chez les Français, de même qu’Édouard Louis. Admirateur d’Ernaux, ce dernier s’est imposé sur le plan international grâce à son récit intitulé En finir avec Eddy Bellegueule (Seuil, 2014). Dans cet ouvrage et les suivants qu’il publia, Édouard Louis a narré le combat – non seulement physique, mais aussi intellectuel et social – qu’il a mené pour s’extirper du milieu défavorisé de ses origines. Milieu qui refusait son homosexualité.
Au Québec, on relève dès 1960, au chapitre de la littérature à thématique gaie, une nouvelle publiée par Rossel Vien (1929-1992) dans les Écrits du Canada français et intitulée « Un homme de trente ans », que Vien signa Gilles Delaunière1. Qui plus est, l’éditeur y alla d’une mise en garde adressée aux lecteurs. Pourquoi ces précautions ? Rappelons qu’à l’époque, Pierre Elliott Trudeau n’avait pas encore fait adopter la loi omnibus qui allait décriminaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants. Avant 1969, ces relations étaient jugées immorales, illégales et relevant de la maladie mentale. Le remède ? Une lobotomie.
Le narrateur d’« Un homme de trente ans » admet, quasi à la fin du récit, que son malaise provient de son homosexualité. Mais ce sera encore sous mots couverts, en optant pour le mot anglais gay, plus détaché peut-être pour le lecteur francophone, et il enfoncera le clou: « Il est gai, vraiment gai, à quarante ans, de faire la ronde autour des pissoires [sic] publics ». Vien / le narrateur enchaîne : « Je sais, à New York, il y a des bars vraiment gais, des clubs tout à fait gais », gai rimant ici, dans la vision négative que l’auteur exprime de l’homosexualité, avec pissoir. On comprend qu’il n’y a là aucune joie.
Plus près de nous, de jeunes écrivains québécois se livrent à des récits autoréférentiels sur leur homosexualité qui ne sont guère plus réjouissants.
Luc Mercure a signé chez Québec Amérique trois romans qui soulèvent la question du danger implicite aux relations homosexuelles intergénérations. Dans un tel rapport inégal, qui abuse de qui ? Voilà la question.
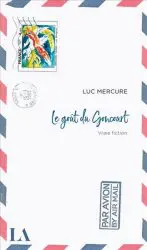
 Dans Port de mer (2014), le narrateur, jeune étudiant universitaire en littérature, est séduit par un homme plus âgé que lui. Ce dernier l’avait prévenu qu’il cherchait « un gars pour lui défoncer la gueule ». Contre toute attente, le jeune le suit, et le pire arrive. Dans Veiller Pascal (2016), le narrateur, âgé d’une quarantaine d’années, en voyage au Cambodge, est troublé par les avances d’un homme qui tente de lui faire rencontrer son fils de seize ans, prostitué. Le père souhaite en fait que le narrateur devienne le protecteur de son fils.
Dans Port de mer (2014), le narrateur, jeune étudiant universitaire en littérature, est séduit par un homme plus âgé que lui. Ce dernier l’avait prévenu qu’il cherchait « un gars pour lui défoncer la gueule ». Contre toute attente, le jeune le suit, et le pire arrive. Dans Veiller Pascal (2016), le narrateur, âgé d’une quarantaine d’années, en voyage au Cambodge, est troublé par les avances d’un homme qui tente de lui faire rencontrer son fils de seize ans, prostitué. Le père souhaite en fait que le narrateur devienne le protecteur de son fils.
Dans Le goût du Goncourt (2018), ouvrage sous-titré « Vraie fiction », le narrateur (Luc Mercure) raconte comment, à dix-neuf ans, il profita d’un séjour en France pour aller rencontrer l’écrivain Yves Navarre, prix Goncourt pour Le jardin d’acclimatation. Navarre, pour qui Mercure éprouvait une admiration sans bornes, l’accueillera, mais lui fera vivre un week-end d’une grande violence. Ce récit de Luc Mercure offre à voir une étrange coïncidence avec un personnage du Jardin d’acclimatation qui s’éprend éperdument d’un dramaturge plus âgé que lui. Le jeune homme sera lobotomisé.
En 2017 et 2018, Nicholas Giguère publia Queues et Quelqu’un chez Hamac. Quasi jumeaux, ces deux ouvrages hurlent en langage cru le désespoir du narrateur qui refuse la tolérance envers sa différence, qui évoque l’organe masculin marquant la quête parfois effrénée des rencontres gaies, qui clame haut et fort son besoin d’être reconnu comme étant quelqu’un, juste quelqu’un qui cherche quelqu’un, même au prix d’être agressé, car « j’aurais été quelqu’un / qui vient de s’en faire crisser une / mais j’aurais existé ».
Le désespoir atteint un sommet inégalé dans Un amour, de Louis-Michel Lemonde (Boréal, 2019). Le narrateur raconte la relation qu’il a eue avec John, un vieil amant, et qui avait commencé dans des bars gais, sous le signe de la prostitution. Le vieillard ayant négligé de faire du narrateur son légataire, ce dernier se retrouve ni plus ni moins déshérité au profit d’ayants droit indignes. Je « me sens trahi, bafoué, dévasté […] John m’a porté un coup bas fatal », s’exclame le plus jeune. Tout dans cet ouvrage est marqué au fer rouge du sadomasochisme, de telle sorte que l’on devine chez le défunt une volonté posthume d’humilier l’autre.
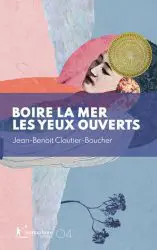
 Dans un tout autre registre est paru chez Sémaphore, en 2022, l’ouvrage de Jean-Benoit Cloutier-Boucher intitulé Boire la mer les yeux ouverts. Ce livre n’a rien de gai, sinon que l’auteur s’admet tel devant sa mère avec laquelle il connaît un amour fusionnel. Atteinte de la sclérose en plaques depuis la prime enfance de son fils, la mère n’aura connu de plus fidèle compagnon que lui. L’ouvrage est composé de textes tous brefs, en prose ou poétiques, semés de dialogues et de réflexions. Il s’en dégage une sensibilité extrême, fine, exacerbée parfois par les regrets de l’auteur de ne pas avoir pu se montrer toujours à la hauteur : « Ta voix est un lointain écho. Je m’en procurerais des échantillons pour ne pas que tu t’effaces ».
Dans un tout autre registre est paru chez Sémaphore, en 2022, l’ouvrage de Jean-Benoit Cloutier-Boucher intitulé Boire la mer les yeux ouverts. Ce livre n’a rien de gai, sinon que l’auteur s’admet tel devant sa mère avec laquelle il connaît un amour fusionnel. Atteinte de la sclérose en plaques depuis la prime enfance de son fils, la mère n’aura connu de plus fidèle compagnon que lui. L’ouvrage est composé de textes tous brefs, en prose ou poétiques, semés de dialogues et de réflexions. Il s’en dégage une sensibilité extrême, fine, exacerbée parfois par les regrets de l’auteur de ne pas avoir pu se montrer toujours à la hauteur : « Ta voix est un lointain écho. Je m’en procurerais des échantillons pour ne pas que tu t’effaces ».
La quête de l’autre refait surface dans Les garçons interludes de Victor Bégin (Hamac, 2022). L’auteur se souvient des garçons qui ont peuplé sa quête, ces « garçons fuyards pâles comme la brume », « qui cherchent un réconfort rapide et éphémère ». Rencontres fortuites, baises d’un soir, passionnées. Devant ce cumul, Bégin éprouve parfois une certaine tristesse, mais il ne regrette rien ; il apprend, dit-il, « la géographie du désir ». D’habiles illustrations de Cole Degenstein ponctuent le tout.
Précédemment, soit en 2021, chez Tryptique, Gabriel Cholette avait signé Les carnets de l’underground, ouvrage dans lequel il relate le déroulement de scènes dont il avait publié des photos sur sa page Instagram. S’ensuivent des évocations de virées nocturnes dans les bars et les clubs de l’underground gai, à Berlin notamment. Dans les darkrooms de ces endroits où n’existe aucune limite, les relations sexuelles sont magnifiées par des drogues – allant de la kétamine au GHB, en passant par le LSD –, abondantes et consommées jusqu’au blackout. Cholette ne porte aucun jugement, il rend compte sans gêne : « Je tombe par terre. M’endors dans mon vomi ». Il se réserve toutefois une pointe d’humour dans la dédicace : « N’envoyez pas ça à ma mère ». À cet ouvrage, Jacob Pyne joint des illustrations, souvent explicites, réalisées à partir de photographies.
Des pissoirs et des bars gais de New York aux darkrooms de Berlin, de la honte au constat, voilà le cheminement que la littérature québécoise à thématique gaie a parcouru.
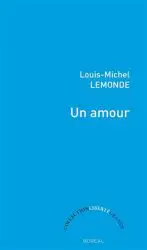
 Enfin, comment ne pas conclure par l’essai intitulé « Narcisse et Zéa », contribution de Gabriel Cholette à l’ouvrage collectif L’artiste et son œuvre (dirigé par Jérémie McEwen et publié chez XYZ en 2022) ? Le narrateur (soit « moi », Cholette) rappelle, dans une conversation avec sa copine Zéa (celle du titre), que Sigmund Freud associait l’homosexualité au narcissisme. Le mythique Narcisse, auquel le terme « narcissisme » renvoie, se serait suicidé parce qu’il ne pouvait pas se conformer à ce que son reflet représentait, soit les attentes de la société (hétérosexuelle).
Enfin, comment ne pas conclure par l’essai intitulé « Narcisse et Zéa », contribution de Gabriel Cholette à l’ouvrage collectif L’artiste et son œuvre (dirigé par Jérémie McEwen et publié chez XYZ en 2022) ? Le narrateur (soit « moi », Cholette) rappelle, dans une conversation avec sa copine Zéa (celle du titre), que Sigmund Freud associait l’homosexualité au narcissisme. Le mythique Narcisse, auquel le terme « narcissisme » renvoie, se serait suicidé parce qu’il ne pouvait pas se conformer à ce que son reflet représentait, soit les attentes de la société (hétérosexuelle).
Serait-ce pourquoi tant de gais cherchent à se comprendre par rapport à la société majoritaire et les écrivains gais, à en rendre compte par des récits intimistes ? Le narrateur (Cholette) en arrive à croire, en effet, que la difficulté à se conformer aux attentes de la société explique « qu’il y ait autant d’homosexuels qui soient devenus créateurs ; des experts du récit de soi, pis, des fois, du récit tout court ».
La boucle serait donc bouclée.
1. Voir J. R. Léveillé, « Rossel Vien, oublié au Québec, méconnu au Manitoba », Nuit blanche, no 157, p. 26-29.










