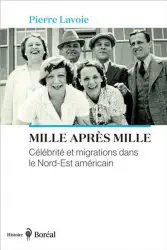Au lendemain de la crise économique de 1929 et jusque dans les années 1950, on pourraitpresque affirmer qu’il existait une forme réduite d’« impérialisme culturel québécois » (toutes proportions gardées) qui envahissait partiellement les zones semi-urbaines de certains États de la Nouvelle-Angleterre afin de rejoindre la « diaspora des Canadiens français » exilés au nord des États-Unis.
L’essai de Pierre Lavoie, Mille après mille. Célébrité et migrations dans le Nord-Est américain, reprend et prolonge une thèse de doctorat soutenue à l’Université de Montréal, en 2019. La première moitié explore une dimension originale autour du million de Canadiens français partis du Québec et de l’Ontario dans l’espoir de trouver la prospérité chez nos voisins du Sud. Si la plupart d’entre eux ont été assimilés en moins de deux générations dans le melting-pot anglo-saxon, il y subsistait néanmoins une vie culturelle en français et les parcours de trois pionniers du monde artistique sembleraient emblématiques des pratiques de la communauté des francophones qui s’était créée au New Hampshire, au Vermont, dans le Maine et au Massachusetts.
Fort à propos, l’auteur établit le pont entre ces communautés voulant conserver le contact avec la « mère-patrie » (c’est-à-dire le Québec), d’une part, et, d’autre part, il analyse les réseaux de ces promoteurs du folklore qui alimentaient une forme parallèle de vie culturelle aux États-Unis avant l’avènement de la télévision et en marge de la culture de masse typiquement américaine, à laquelle beaucoup de francophones n’adhéraient pas d’emblée en raison de la barrière linguistique. Les cinq chapitres de cet ouvrage se concentrent donc sur la mythique Mary « La Bolduc » Travers, le chanteur de charme vermontois Rudy Vallée et l’organisateur de tournées Jean Grimaldi. On en apprend beaucoup sur le rayonnement de ces trois célébrités au-delà des frontières québécoises. Mais surtout, Pierre Lavoie élabore un cadre théorique dérivé des recherches actuelles autour des études culturelles, des études sur la célébrité (Celebrity Culture) et sur les identités collectives. En scrutant cette hybridation de l’américanité, Pierre Lavoie rappelle par ailleurs le racisme ou l’ostracisme dont ces Canadiens français en exode étaient victimes, certains journaux américains les surnommant parfois « les Chinois de l’Est ».
Le choix du titre s’explique aisément : la chanson « Mille après mille » – composée en 1969 par Gerry Joly, puis reprise par le légendaire Willie Lamothe – exprime non seulement la solitude de ces artistes itinérants mais aussi, plus largement, le sentiment d’isolement de ces francophones minoritaires et discriminés par les États-Uniens, en particulier par les wasps. Bien qu’il s’agisse d’une recherche savante touchant l’histoire des migrations, l’ethnicité, la sociologie de la culture et les études québécoises, le lecteur non universitaire s’intéressant au sort collectif des premiers émigrants québécois établis dans le Nord-Est américain trouvera ici un récit clair, instructif et rigoureux.