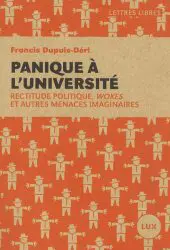Avec cet essai, l’auteur, professeur de science politique à l’UQAM, produit un ouvrage qui relève à la fois de la recherche et du militantisme.
De la recherche, puisque, par-delà les perceptions subjectives, il passe en revue ce qui se produit réellement dans les universités. Du militantisme, puisqu’il prend position politiquement et critique frontalement certains journalistes, essayistes et auteurs. Mais n’allons pas trop vite. De quoi est-il question ?
Dupuis-Déri veut nous persuader qu’il n’y a pas péril en cette demeure qu’est l’université. Il n’y a pas de réelle lame de fond woke qui changerait, de fond en comble, les assises de la vénérable institution.
L’auteur est d’avis que l’on transforme volontiers des anecdotes en événements nationaux. Des conservateurs (Bloom, Bock-Côté, Rioux, Facal, Finkielkraut, Bruckner…) critiquent les revendications progressistes et utilisent le mot woke comme une arme de dénonciation au lieu de s’ouvrir à de nouvelles réalités.
On serait ici en face de ce que le sociologue Stanley Cohen désignait, en 1972, comme de la « panique morale » et qui servirait avant tout la pensée dominante mise à mal. Selon Dupuis-Déri, il n’y a pas de preuves empiriques suffisantes pour appuyer ces inquiétudes que plusieurs expriment. Que de l’amplification de la part des grandes entreprises médiatiques.
D’ailleurs, souligne l’auteur, des conflits idéologiques entre professeurs et étudiants, il y en a toujours eu. Ils remontent même au Moyen Âge. Avec un recul historique, il conclut que la situation est plutôt calme aujourd’hui. Il suffit aussi de jeter un coup d’œil sur les milliers d’universités aux États-Unis pour constater que les choses se déroulent plutôt normalement dans la vaste majorité des cas. Si l’on remarque que, dans quelques-unes, le progressisme woke se fait davantage entendre, il ne faudrait pas oublier de noter du même coup la présence de nombreuses associations étudiantes chrétiennes et de droite, souvent bien plus actives que les associations de gauche.
Mais les menaces sont-elles imaginaires ? Ne s’agit-il que d’anecdotes ? Prenons, par exemple, le cas Verushka Lieutenant-Duval, que Dupuis-Déri désigne comme « l’incident survenu à l’Université d’Ottawa ». Il me semble qu’il expédie rapidement l’affaire en écrivant que l’« on ne connaîtra jamais tous les détails ». Pas un mot sur les réactions et les lettres écrites par de nombreux professeurs inquiets pour leur droit de parole. Pas un mot sur les deux rapports publiés à la suite des travaux des commission et comité portant sur la liberté académique, l’une présidée par Alexandre Cloutier et l’autre par Michel Bastarache. Rien non plus sur les politiques d’équité, de diversité et d’inclusion qui font parfois l’objet de certaines critiques. Même ce qui s’est passé à l’université américaine d’Evergreen et son fameux « Jour d’absence » est relativisé : on aurait affaire à des suppressions de données pertinentes. À aucun moment, l’auteur ne concède qu’il ait pu y avoir quelque dérapage du côté des sensibilités woke.
Cela dit, sa critique de certains commentateurs fait toutefois mouche. Il retourne les armes de la critique contre ceux-là même qui s’en prennent au wokisme, bien installés qu’ils sont « au sommet de la pyramide sociale ». Il épluche la liste des cours offerts dans les universités et il observe le peu de cours associés au progressisme actuel. Les œuvres classiques, toujours enseignées, ne sont pas menacées par les féministes et les antiracistes. Il en va de même pour les chaires de recherche et les sujets de mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat. Même les hommes blancs continuent d’être fortement embauchés. Pas d’invasion woke dans les universités, conclut-il.
Alors, la panique a-t-elle lieu d’être ou non ? À mon avis, de l’eau devra encore passer sous les ponts pour que nous le sachions.