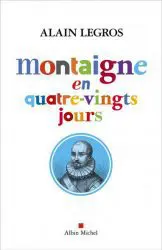L’intemporel.
« De ‘littéraire’ qu’il était naguère encore au lycée, Montaigne devient de plus en plus ‘philosophe’, un philosophe qu’on se doit d’avoir lu et que par conséquent on ne peut que ‘relire’… » On dirait d’ailleurs que tous les prétextes sont bons pour le ramener sur le tapis et le louer. Montaigne a écrit sur tous les sujets, et ses réflexions humanistes fascinent et séduisent encore aujourd’hui.
Alain Legros a consacré 30 ans de sa vie à l’auteur périgourdin. Lui ne se contente ni de lire ni de relire Montaigne : il « pratique Montaigne ». En effet, plus qu’intellectuel, son rapport au philosophe du XVIe siècle est devenu personnel, voire existentiel : « […] il m’aura permis plusieurs fois de garder la tête hors de l’eau en des temps qui m’étaient […] difficiles ».
Il l’a étudié sous toutes ses coutures, a examiné maintes et maintes fois les éditions originales annotées par l’écrivain et ses collaborateurs, n’hésitant pas à faire faire une analyse des encres pour pouvoir distinguer qui a écrit quoi, et à quel moment. Il a admiré de ses yeux et répertorié avec passion les dizaines de sentences que Montaigne avait fait peindre (et non graver comme on le dit parfois) sur les solives de sa « librairie » (bibliothèque). Il a même eu le plaisir d’en découvrir onze nouvelles, en palimpseste. Par exemple : « Vivre chichement, mais à l’abri du malheur » (Théognis) ou « Le mariage n’apporte pas plus de joies que de larmes » (Euripide).
Le lecteur ne saurait donc rêver d’un guide plus éclairé pour le mener à travers les centaines de pages éternelles des trois tomes des Essais tout en lui évitant les faux pas. Qui sont potentiellement nombreux, car on a voulu faire dire beaucoup de choses au seigneur de Montaigne. Par exemple, celui-ci est certes un humaniste qui sait prendre ses distances par rapport au fanatisme religieux en pleine guerre de religions, mais il est faux de prétendre qu’il s’opposait à la foi catholique. D’une part parce que les fondements de cette foi, après étude attentive, lui paraissent solides et féconds… et d’autre part parce qu’il considère plutôt sensé, pour un esprit pondéré comme le sien de conserver la foi de ses origines : « Puisque je ne suis pas capable de choisir, je prends le choix d’autrui, et me tiens en l’assiette où Dieu m’a mis ».
Le livre est composé de 80 chapitres courts qui nous font découvrir aussi bien la pensée de Montaigne que son rapport à son œuvre et diverses anecdotes de recherche. Avec cette mise en garde : « Les Essais sont un laboratoire, les sujets abordés ne sont que des cobayes. L’auteur n’y construit pas une pensée, encore moins une doctrine. Il expérimente, jauge, tâte, tâtonne […] ». C’est sans doute cette approche non doctrinaire qui le rend aussi universel.
Il faudra faire preuve de beaucoup de discipline pour se contenter d’un chapitre par jour comme le suggère le titre. Car c’est un plaisir de lire le chercheur nous présenter cet homme qu’il connaît si bien, sans cacher ni son érudition (humblement dévoilée) ni son amour pour lui. Et bien que la lecture de Montaigne dans le texte puisse s’avérer ardue à cause d’une langue qui a tellement évolué depuis (le philosophe lui-même doutait, conscient de la vitesse à laquelle évoluait le français à son époque, qu’on pût le comprendre après un demi-siècle), ses écrits recèlent une richesse et une poésie auxquelles on ne peut que succomber. Est-ce la langue de l’époque ? Est-ce le style de l’auteur ? Difficile à départager, mais les citations savoureuses – pour le fond comme pour la forme – ne manquent pas, surtout lorsqu’elles sont serties par les mains expertes de notre spécialiste. En quels termes, par exemple, avoue-t-il que ses propres écrits sont parfois décousus ? « Que sont-ce ici aussi à la vérité que grotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans figure déterminée, n’ayant ordre, suite ni proportion que fortuite? »
À la fin de l’ouvrage, presque en annexe, l’auteur propose une enfilade de citations prouvant bien que la pensée de Montaigne « peut encore intéresser notre temps » ou, plus exactement, est encore acceptable aujourd’hui. À notre époque, en effet, il faut montrer patte blanche lorsqu’on ose parler d’un auteur du passé sans le déconstruire ! Il faut admettre que Montaigne passe le test haut la main sur des dizaines de sujets. Contentons-nous d’une citation qui nous autorisera – imprimatur suprême – à qualifier l’auteur de féministe avant l’heure : « Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles refusent les règles qui régissent le monde, parce que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles ».