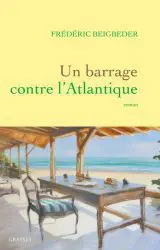Peut-on construire un roman à partir de phrases isolées puis juxtaposées ? On obtient ainsi une seule phrase par paragraphe. Ce sera au lecteur d’y trouver du sens. Et de tenter d’y déceler de l’authentique littérature.
Frédéric Beigbeder renouvelle son écriture et, par ricochet, notre conception même de la littérature, procédant par touches, un peu comme des aphorismes, mais sans la véhémence de Nietzsche, le grand maître du style aphoristique. Fragments, souvenirs épars, impressions fuyantes, écriture spontanée (mais pas automatique), premiers jets. En haut d’une page, le narrateur apostrophe le lecteur, comme s’il regardait directement dans l’objectif de la caméra : « Vous vous demandez peut-être pourquoi je saute deux lignes entre chaque phrase ». Pas de ponctuation. On poursuit, puis au haut de la page suivante, il explique : « Chaque phrase doit donner envie de lire la phrase suivante, mais exister aussi de façon autonome ». Et rendu à la page 43, l’auteur encourage son lecteur : « Si vous êtes arrivé jusque-là, c’est grâce à ce véhicule : de phrase en phrase, nous voyageons ensemble ». Il ajoute, afin de situer cette bifurcation de style : « Bienvenue dans l’ère post-romanesque ». Puis, Beigbeder introduit une dimension réflexive, c’est-à-dire que l’écrivain commente son processus de narration tout en rédigeant, faisant de son écriture même l’objet premier de son récit : « Je ressens une joie d’écrire au-delà du sens, un plaisir du jeté de la phrase sur le papier qui me semblait perdu, oublié à tout jamais ». Cet écart audacieux, on peut se le permettre quand on s’appelle Frédéric Beigbeder. Il aurait tort de s’en priver ; et le lecteur ne devrait pas le lui reprocher.
Dans Un barrage contre l’Atlantique, Beigbeder explore, expérimente de nouvelles formes d’écriture romanesque; on repense – comme au siècle dernier – au style discontinu et introspectif des romans de Claude Mauriac (1914-1996) (le fils de François), dans son magnifique cycle Le Temps immobile (à partir de 1974), ou encore aux premiers livres de Robbe-Grillet, aux romans du nobélisé Claude Simon, ou même à certains passages autocritiques dans ce curieux Vif du sujet d’Edgar Morin.
Au milieu du livre, le procédé s’estompe, se dilue progressivement, et certains souvenirs désagréables, quelquefois à la limite du scabreux (des confessions du narrateur ?), s’imposent, devenant difficilement supportables. La magie s’est dissipée. Le lecteur tombe de haut. Dans la dernière section, le procédé initial a complètement disparu, et au lieu de poursuivre sa lecture, on se demande ce que ça donnerait si on essayait à notre tour de renouveler l’écriture romanesque, de raconter autrement les choses. Et tout à coup, on constate que l’on perd momentanément la curiosité de terminer sa lecture de ce Barrage contre l’Atlantique. Pour paraphraser McLuhan : le style, c’est le message.