De 1953 à 1973, Hélène Bessette a publié treize romans chez Gallimard. Récompensée par le prix Cazes en 1954 pour Lili pleure, nommée sur la liste du prix Goncourt en 1955, puis en 1963, pour respectivement Vingt minutes de silence et N’avez-vous pas froid, soutenue par des écrivains et artistes renommés, elle ne rencontre pas son lectorat : les innovations et audaces de ses « romans poétiques » déconcertent.
Ses livres se vendant à très peu d’exemplaires, Gallimard refuse ses manuscrits après la publication d’Ida ou le délire en 1973. Cette décision la plonge dans la misère, le désespoir et la paranoïa. Elle disparaît du champ littéraire et sa mort, en 2000, passe totalement inaperçue.
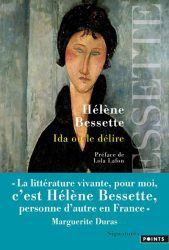 À partir du début du XXIe siècle, avec les republications de plusieurs de ses livres, s’observe un renouveau d’intérêt pour l’auteure et l’œuvre. Comment expliquer ce « barrage illégitime », la « mise au ban1 » du panorama littéraire contemporain de cette voix originale et brillante ? Après Alain Bosquet, Laure Limongi pose cette « question énorme : Mais comment est-ce possible qu’elle n’apparaisse pas dans les anthologies de littérature française ? Qu’elle ne fasse pas partie des classiques de la littérature moderne2 ? ». Comment analyser ce frémissement actuel autour de son œuvre ? La « revie » d’Hélène Bessette serait-elle en cours, anticipant sur ce qu’elle espérait : « être reconnue trente ou cinquante ans après sa mort3 » ?Les innovations de son écriture auraient-elles cessé d’effrayer chercheurs et lecteurs ? La réponse à ces questions se trouve à la fois dans le drame d’une vie, dans les choix narratifs et esthétiques de la romancière, dans l’acuité de son regard sur la société et la modernité de ses thématiques.
À partir du début du XXIe siècle, avec les republications de plusieurs de ses livres, s’observe un renouveau d’intérêt pour l’auteure et l’œuvre. Comment expliquer ce « barrage illégitime », la « mise au ban1 » du panorama littéraire contemporain de cette voix originale et brillante ? Après Alain Bosquet, Laure Limongi pose cette « question énorme : Mais comment est-ce possible qu’elle n’apparaisse pas dans les anthologies de littérature française ? Qu’elle ne fasse pas partie des classiques de la littérature moderne2 ? ». Comment analyser ce frémissement actuel autour de son œuvre ? La « revie » d’Hélène Bessette serait-elle en cours, anticipant sur ce qu’elle espérait : « être reconnue trente ou cinquante ans après sa mort3 » ?Les innovations de son écriture auraient-elles cessé d’effrayer chercheurs et lecteurs ? La réponse à ces questions se trouve à la fois dans le drame d’une vie, dans les choix narratifs et esthétiques de la romancière, dans l’acuité de son regard sur la société et la modernité de ses thématiques.
Les « deux vies » d’Hélène Bessette
Hélène Bessette, comme elle l’écrit dans une courte autobiographie littéraire posthume, a eu au moins « deux vies4 ». La première s’apparente à un cheminement vers le succès, la seconde à la descente aux enfers de « l’écrivaine maudite ».
« Née obscurément » à Levallois-Perret, dans un milieu modeste, et après des études à l’École Normale d’Institutrices d’Alençon qui la dotent d’une vaste culture littéraire, Hélène Bessette commence à écrire en Nouvelle-Calédonie où elle a rejoint son mari, le pasteur René Brabant. Son premier roman, Marie Désoublie, est publié en 1948 dans le journal de la mission, Évangile-Sud. De retour en France à la suite d’un douloureux divorce, Hélène Bessette signe, le 4 décembre 1952, après la publication de Lili pleure, un contrat pour dix livres avec « l’éminente Maison Gallimard », ce dont elle sera toujours fière, malgré les difficultés rencontrées au cours du temps.
Ses débuts sont brillants. « Enfin du nouveau ! » s’écrie Raymond Queneau. Simone de Beauvoir et Dominique Aury l’apprécient, Alain Bosquet appelle à « rendre justice » à « un écrivain de race qu’il faut découvrir sans tarder5 » et Jean Dubuffet, le promoteur de l’art brut, non seulement admire son œuvre, mais s’empresse de l’aider matériellement lorsque nécessaire. Marguerite Duras, surtout, exprime son admiration en termes hyperboliques : « La littérature vivante, pour moi, pour le moment, c’est Hélène Bessette, personne d’autre en France », et lance l’injonction : « Lisez Bessette66 ».
Cette reconnaissance de personnalités de premier plan ne suffit pas cependant à asseoir la notoriété de la romancière. Ses livres ne se vendent pas. Les critiques de presse lui font un accueil mitigé : si plusieurs soulignent la nouveauté de son style, sa voix singulière, d’autres, résolument hostiles, parlent d’une « écriture de borborygmes et d’onomatopées7 », de confusion, et assimilent ses recherches scripturales à de la négligence. Sa tentative d’élargir son lectorat avec Les petites Lecocq, un « roman-lecture » de facture plus conventionnelle, débouche sur un procès odieux, intenté par une lectrice nommée Lecoq qui prétendait se reconnaître dans le personnage principal. Le livre retiré des ventes et la condamnation à verser 40 000 francs de dommages et intérêts à la plaignante ouvrent pour Hélène Bessette sa « deuxième vie » d’« écrivain maudit8 ». « Il ne faut plus écrire » : ce message de l’éditeur transmis par Queneau la blesse profondément, car elle croit en son talent et éprouve surtout un immense besoin d’écrire. Victime d’une pétition diffamatoire dans le village d’Eure-et-Loir où elle enseigne, elle démissionne de l’Éducation nationale. Une certaine paranoïa la gagne, dont les effets sont sensibles dans sa trilogie : Si, Garance roseet Suite suisse. Quand, à partir de 1973, Gallimard cesse de la publier, que les négociations avec le Seuil et les éditions de Minuit échouent, sa vie est faite alors de difficultés économiques, de tâches humiliantes (serveuse, concierge, femme de ménage) pour survivre, et d’une grande solitude jusqu’en l’an 2000 où elle meurt sans jamais avoir cessé d’écrire.
L’aventure du « roman poétique »
Pour expliquer l’insuccès de ses livres auprès d’un large public, il faut considérer également ses choix esthétiques.
En 1954, elle rédige le « Manifeste » dans lequel elle expose sa conception de la littérature, de l’écriture romanesque en particulier : une conception qu’elle espérait défendre dans sa revue Le Gang du Roman Poétique. Le choix de ce nom donne la mesure d’un fort désir – et besoin – d’en découdre avec les codes du roman classique, les règles de la « langue majeure » et le poids des écrivains du passé. En cela, elle se rapproche des théoriciens du Nouveau Roman, sans adhérer cependant à toutes les prescriptions de ce courant et à une littérature intransitive. « La littérature est la Parole d’un Temps », profère-t-elle. Convaincue, après les deux guerres mondiales, que la littérature « a cinquante ans de retard sur les autres arts » et que le langage poétique est celui qui correspond le mieux à « ces temps difficiles », elle opte pour « le roman poétique » : « un roman redevenu vivant parce qu’il aura réussi à intégrer les conquêtes de la poésie, recueilli les fruits de la libération surréaliste », et qu’elle place dans « l’ombre de Valéry-Proust-Radiguet », mais aussi d’Alain-Fournier, Charles-Louis Philippe et Jean Giraudoux9.
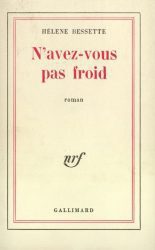 Ses innovations portent sur l’art du récit et la perspective narrative. L’intrigue linéaire est malmenée au profit de la répétition, qui renvoie davantage à l’écriture poétique. À ce que Le Clézio, dans sa Lettre-Préface au Procès-verbal, appelait ironiquement la « psychologie rancie » et que rejetaient également les Nouveaux Romanciers, elle préfère la « linguistique des visages10 » ou la puissance expressive des voix. Concernant le personnage, elle rejoint Alain Robbe-Grillet sur la mise en cause du héros, devenu obsolète, et le choix de personnages « réduits à leur plus simple expression ». Elle pratique le détournement des formes génériques ou leur hybridation, l’intermédialité : emprunts au théâtre, au cinéma, à la musique… Ses audaces touchent aussi, comme en poésie, la syntaxe, la ponctuation, le mot, avec des effets de phonétisation, d’échos, de rimes, voire l’utilisation de la lettre : ainsi le O, lettre du rêve dans La tour, est exclu de maternA où triomphe le A majuscule. Il s’agit de « donner un nouveau souffle à l’écriture par une désarticulation de la phrase, une scission. Sorte d’impressionnisme littéraire, de tachisme. De phonétisme11 ».
Ses innovations portent sur l’art du récit et la perspective narrative. L’intrigue linéaire est malmenée au profit de la répétition, qui renvoie davantage à l’écriture poétique. À ce que Le Clézio, dans sa Lettre-Préface au Procès-verbal, appelait ironiquement la « psychologie rancie » et que rejetaient également les Nouveaux Romanciers, elle préfère la « linguistique des visages10 » ou la puissance expressive des voix. Concernant le personnage, elle rejoint Alain Robbe-Grillet sur la mise en cause du héros, devenu obsolète, et le choix de personnages « réduits à leur plus simple expression ». Elle pratique le détournement des formes génériques ou leur hybridation, l’intermédialité : emprunts au théâtre, au cinéma, à la musique… Ses audaces touchent aussi, comme en poésie, la syntaxe, la ponctuation, le mot, avec des effets de phonétisation, d’échos, de rimes, voire l’utilisation de la lettre : ainsi le O, lettre du rêve dans La tour, est exclu de maternA où triomphe le A majuscule. Il s’agit de « donner un nouveau souffle à l’écriture par une désarticulation de la phrase, une scission. Sorte d’impressionnisme littéraire, de tachisme. De phonétisme11 ».
Pour enrichir la langue commune dont elle déplore l’insuffisance, Bessette propose des emprunts aux langues étrangères, régionales, et à la « langue démotique » chère à Queneau, mêlant écriture littéraire et formes d’oralité : solécismes, répétitions, figures de diction. À cela s’ajoute ce qu’elle appelle « le matériel accessoire » : mise en page du texte, blancs, marges, inventions graphiques, variations de police de caractères.
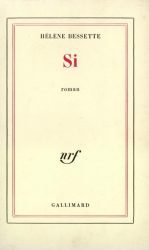 Si « Hélène Bessette accepte délibérément de sacrifier le fond à la forme pour permettre à la poésie de mieux s’intégrer au roman12 », elle rejette néanmoins avec vigueur une écriture qui privilégierait le code, « l’algorithme » au détriment de l’émotion. Ces expérimentations, ces licences poétiques appliquées à la prose romanesque ne sont en rien des jeux d’esthète dans l’œuvre d’Hélène Bessette, écrivaine blessée,« maudite » selon la formule de Raymond Queneau, mais les manifestations d’une insurrection contre le fonctionnement d’institutions de la société bourgeoise qui oppriment, aliènent, violentent, poussent au désespoir ou au bord de la folie. Toutes expériences dont elle a pu être témoin ou qu’elle a vécues douloureusement dans sa chair. Les romans publiés chez Gallimard entre 1953 et 1973, sans être pour autant des autobiographies tant ils transgressent les canons du genre, s’inspirent d’épisodes de sa vie à la fois tragique et romanesque auxquels son écriture exigeante, très éloignée de la pratique contemporaine de l’extimité, confère une résonance universelle : étouffement de l’enfance au sein de la famille et de l’école (Vingt minutes de silence, maternA), hypocrisie religieuse, turpitude du divorce (N’avez-vous pas froid), pesanteur et inhumanité kafkaïenne de l’administration (G6arance rose), frustrations affectives et sexuelles des femmes dans le couple, harcèlement de celles qui aspirent à l’autonomie (Si), aliénation à la société de consommation (maternA, La tour), souffrance et humiliation de la condition domestique (Suite suisse, Ida). Elle n’hésite pas, d’ailleurs, à aborder des sujets encore tabous à son époque, comme l’homosexualité (maternA, La route bleue, Lili pleure pour sa version incestueuse), l’avortement, le suicide (Si), le désordre sexuel, la folie (Le bonheur de la nuit).
Si « Hélène Bessette accepte délibérément de sacrifier le fond à la forme pour permettre à la poésie de mieux s’intégrer au roman12 », elle rejette néanmoins avec vigueur une écriture qui privilégierait le code, « l’algorithme » au détriment de l’émotion. Ces expérimentations, ces licences poétiques appliquées à la prose romanesque ne sont en rien des jeux d’esthète dans l’œuvre d’Hélène Bessette, écrivaine blessée,« maudite » selon la formule de Raymond Queneau, mais les manifestations d’une insurrection contre le fonctionnement d’institutions de la société bourgeoise qui oppriment, aliènent, violentent, poussent au désespoir ou au bord de la folie. Toutes expériences dont elle a pu être témoin ou qu’elle a vécues douloureusement dans sa chair. Les romans publiés chez Gallimard entre 1953 et 1973, sans être pour autant des autobiographies tant ils transgressent les canons du genre, s’inspirent d’épisodes de sa vie à la fois tragique et romanesque auxquels son écriture exigeante, très éloignée de la pratique contemporaine de l’extimité, confère une résonance universelle : étouffement de l’enfance au sein de la famille et de l’école (Vingt minutes de silence, maternA), hypocrisie religieuse, turpitude du divorce (N’avez-vous pas froid), pesanteur et inhumanité kafkaïenne de l’administration (G6arance rose), frustrations affectives et sexuelles des femmes dans le couple, harcèlement de celles qui aspirent à l’autonomie (Si), aliénation à la société de consommation (maternA, La tour), souffrance et humiliation de la condition domestique (Suite suisse, Ida). Elle n’hésite pas, d’ailleurs, à aborder des sujets encore tabous à son époque, comme l’homosexualité (maternA, La route bleue, Lili pleure pour sa version incestueuse), l’avortement, le suicide (Si), le désordre sexuel, la folie (Le bonheur de la nuit).
 Hélène Bessette a souffert en effet d’être en avance sur son temps. Sa dénonciation de la consommation dans La tour en 1959 arrive trop tôt. Le regard sans indulgence porté sur le mariage, la famille, l’Église, sur les ravages de l’école autoritaire, l’aspiration de certaines de ses héroïnes à la liberté de vivre seules et non dans la dépendance d’un homme, de choisir leur sexualité annoncent tout ce qui conduira justement à l’explosion de la jeunesse en mai 1968.
Hélène Bessette a souffert en effet d’être en avance sur son temps. Sa dénonciation de la consommation dans La tour en 1959 arrive trop tôt. Le regard sans indulgence porté sur le mariage, la famille, l’Église, sur les ravages de l’école autoritaire, l’aspiration de certaines de ses héroïnes à la liberté de vivre seules et non dans la dépendance d’un homme, de choisir leur sexualité annoncent tout ce qui conduira justement à l’explosion de la jeunesse en mai 1968.
Une troisième vie pour Hélène Bessette ?
Il ne faudra pas attendre 50 ans pour que ses romans, tombés dans l’oubli, reviennent dans une lumière certes encore discrète, mais bien réelle, grâce à une chaîne de transmission assurée par quelques lecteurs fidèles et passionnés. Des éditeurs : Laure Limongi chez Léo Scheer, Benoît Virot au Nouvel Attila ont entrepris depuis 2006 la republication de ses livres. Ces nouvelles éditions assorties de préfaces ou de postfaces d’éminent(e)s écrivain(e)s contemporain(e)s donnent lieu à des recensions favorables dans de grands quotidiens ou hebdomadaires. Comme pour les éditions originales, les « pairs » d’Hélène Bessette saluent la force, la créativité de cette écriture « si personnelle, si neuve, si extraordinairement en dehors des sentiers battus13 ». Des revues ouvrent leurs colonnes à des notes de lecture, voire à des dossiers conséquents : ainsi La Revue littéraire (automne 2006), la revue Frictions (2015) ou, plus récemment, le riche dossier du Matricule des Anges : « Hélène Bessette, l’injustice et l’insolence » (2020).
Des travaux universitaires, essais, articles de colloques voient le jour. L’acmé de cette renaissance a été le colloque de Cerisy-la-Salle organisé fin août 2018 pour le centenaire de la naissance de l’auteure par un nouveau « Gang du Roman Poétique » (GRP) beaucoup plus étoffé que celui d’origine, chargé désormais de veiller, via un site régulièrement mis à jour, à la diffusion des informations sur l’œuvre et sur les manifestations qui s’y rapportent. Et elles sont nombreuses : émissions de radio, lectures en librairies, conférences dans des bibliothèques ou des centres culturels14. L’œuvre dépasse les frontières de l’Hexagone par les traductions en espagnol, en italien, en allemand.
Par ailleurs, cette écriture de la voix, du rythme, de la scansion, voire du « cri », selon les mots mêmes d’Hélène Bessette dans Si, cette écriture qui « fait oralité15 » et que Jean Soublin définissait comme « du rap des années 5016 » inspire le monde du théâtre. Les adaptations d’Ida ou le délire, de Vingt minutes de silence, de La grande balade, les lectures-performances accompagnées de musique, et parfois de conférences introductives, essaiment dans divers lieux. De la Maison de la Poésie, à Paris, à La Chaux-de-Fonds en Suisse, en passant par Tanger, Nantes, Dieppe, Marseille…, la voix d’Hélène Bessette s’écoute à nouveau.
Se poser en romancière qui ose montrer sans fard les hypocrisies des institutions, des rapports humains dans la société bourgeoise et qui, pour ce faire, n’hésite pas à « désarticuler » la phrase, à bousculer la langue « admise17 », celle des écoles et des Académies, l’un des fondements de l’ordre social et patriarcal, était dans les années 1950-1970 un défi audacieux, voire une provocation d’autant moins recevable qu’Hélène Bessette n’est pas une « héritière » au sens de Pierre Bourdieu. Ce n’est plus le cas actuellement où le lecteur dispose des outils pour entrer dans son œuvre et ne peut que percevoir la pertinence, la force et l’actualité sociale et politique des sujets traités.
Certes, la résurrection reste fragile, le public n’est toujours pas massivement au rendez-vous, la critique journalistique se montre parcimonieuse et imprévisible. Hélène Bessette ne sera jamais une auteure grand public, et elle s’en réjouirait, mais on peut d’ores et déjà dire qu’elle a gagné. Elle a conquis une partie de ce public « ouvert, curieux », intéressé par les recherches du Nouveau Roman, mais qui était passé à côté de ses livres. Désormais, l’oubli n’est plus possible. Le GRP veille, le bouche-à-oreille continue son action bienfaisante, les études bessettiennes lancées à Cerisy se poursuivent, et il y a tant encore à découvrir avant d’offrir à Hélène Bessette le « petit livre18 » auquel, légitimement, elle aspirait et qui lui donnerait toute sa place dans le paysage de la littérature contemporaine.
Œuvres d’Hélène Bessette
Lili pleure, Gallimard, 1953 ; Le Nouvel Attila, « Othello », 2020.
maternA, Gallimard, 1954 ; Léo Scheer, « Laureli », 2007.
Vingt minutes de silence, Gallimard, 1955 ; Le Nouvel Attila, « Othello », 2017.
Les petites Lecocq, Gallimard, 1955.
La tour, Gallimard, 1959 ; Léo Scheer, « Laureli », 2010 ; Le Nouvel Attila,« Othello », 2021.
La route bleue, Gallimard, 1960.
La grande balade, Gallimard, 1961 ; Le Nouvel Attila, « Othello », 2019.
Si, Gallimard, 1964 ; Léo Scheer, « Laureli », 2012.
Suite suisse, Gallimard, 1965 ; Léo Scheer, « Laureli », 2008.
Garance rose, Gallimard, 1965 ; Le Nouvel Attila, « Othello », 2017.
Les petites Lilshart, Gallimard, 1967.
Le divorce interrompu, Gallimard, 1968.
Ida ou le délire, Gallimard, 1973 ; Ida ou le délire suivi de Le résumé, Léo Scheer, « Laureli », 2009 ; Ida, Le Nouvel Attila, « Othello », 2018 ; Points, « Signatures », 2020.
Le bonheur de la nuit, Léo Scheer, « Laureli », 2006.
On ne vit que deux fois, Le Nouvel Attila, « Othello », 2017.
Histoire du chien, Le Nouvel Attila, « Othello », 2018.
Élégie pour une jeune fille en noir, Nous, 2021.
Les résumés, Le Nouvel Attila, « Othello », 2022.
1. Éric Dussert, Cachées par la forêt, Paris, La Table Ronde, 2018, p. 14.
2. Laure Limongi, Indociles, essai littéraire sur Denis Roche, Hélène Bessette, Kathy Acker, B.S. Johnson, Paris, Léo Scheer, 2012, p. 67.
3. Cité dans Julien Doussinault, Hélène Bessette, Paris, Léo Scheer, 2008, p. 19.
4. Hélène Bessette, On ne vit que deux fois, Paris, Le Nouvel Attila, « Othello », 2018.
5. Alain Bosquet, « Découvrons Hélène Bessette », Le Monde, 26 janvier 1963. Recension de N’avez-vous pas froid.
6. Marguerite Duras, « Découverte : Lisez Hélène Bessette », L’Express, 2 janvier 1964, p. 24.
7. Claude Mauriac, « La mystérieuse Hélène Bessette », Le Figaro, 13 mai 1959.
8. Julien Doussinault, op. cit., p. 79.
9. Le résumé no 1 dans Ida ou le délire suivi de Le résumé, Paris, Léo Scheer, 2013, p. 153, 181, 190-191.
10. Hélène Bessette, Le bonheur de la nuit, Paris, Léo Scheer, 2006, p. 15.
11. Le résumé no 2, op. cit., p. 193.
12. Julien Doussinault, op. cit., p. 35.
13. Tels étaient les adjectifs employés par Alain Bosquet, dans son article « Le désespoir d’Hélène Bessette », recension de Si pour Le Monde du 15 août 1964 et qui se déclinent dans les préfaces et postfaces mentionnées.
14. Voir le site du Gang du Roman Poétique : http://grp.bessette.fr.
15. Noëlle Renaude, « Plus tard plus tard on dira qui je fus », dans « D’Hélène Bessette à Eugène Durif », Frictions, n° 25, 2015, p. 96.
16. Jean Soublin, « L’argent ne fait pas le bonheur », Le Monde, 25 juin 2010. Recension de La tourd’Hélène Bessette.
17. Le résumé no 2, op. cit., p. 205.
18. Dans On ne vit que deux fois, Hélène Bessette regrette de n’avoir pas eu droit au « petit livre » de type « Poètes d’aujourd’hui » (Seghers) ou « Écrivains de toujours » (Seuil).
EXTRAITS
Quant aux mères elles s’en retournent vers leurs petits ménages et leurs visages délabrés par la misère la maladie les émotions érotiques précoces et obsédantes, la mauvaise nourriture, les privations et le reste. Pas plus tard qu’hier elles étaient de jolies jeunes filles et aujourd’hui elles ressemblent à Dunkerque.
maternA, Léo Scheer, « Laureli », 2007, p. 209.
Doele Ida
Partagée arrachée divisée.
Le rôle qu’elle joue. Contre la personne qu’elle est.
Obéir-être docile-servile-silencieuse.
Répondre aux appels
Quand il fallait ne pas obéir ne pas être docile ne pas être servile
et
hurler
HURLER DE PEUR.
Ida, Points, « Signatures », 2020, p. 122.
Écrire.
Avec des phrases de papier de soie léger découpé.
Avec des volutes de fumée.
Avec l’écume des vagues aux crêtes déroulées.
Tête baissée. Enfoncer le mur de papier de la vie ordinaire.
Le mur fragile construit volontairement. De l’exiguïté.
L’apparence bête de la vie admise.
La grande balade, Le Nouvel Attila, « Othello », 2019, p. 17.
Les personnes intelligentes ont du mérite
Quand on pense qu’elles font
Tout ce qu’elles font
Malgré l’opposition des fous en liberté.
Suite suisse, Léo Scheer, « Laureli », 2008, p. 124.










