Chez Catherine Voyer-Léger, il y a d’abord Elle, sa mère toute-puissante, mais tellement démunie, puis Elle, sa fille tellement démunie, mais toute-puissante. Dans deux œuvres récentes, l’autrice raconte ces trois générations de femmes dont les relations se vivent autant dans l’interdépendance (Nouées1) que dans la mobilité (Mouvements2).
« Un appartement frappé par une tornade. Une tornade de 15 mois. Une tornade châtain avec un regard foncé comme ces ombres d’été creusées d’un trop-plein de lumière. » L’arrivée d’une jeune enfant dans la vie de cette femme célibataire et solitaire lui renvoie en miroir la qualité de sa relation avec sa propre mère. Dans ses deux récits hors norme, Catherine Voyer-Léger décrit avec la finesse qu’on lui connaît les aléas et les émotions de l’adoption au Québec, ainsi que les tribulations de sa jeunesse atypique. « Je n’avais pas de trouble psychiatrique, mais une blessure profonde qui portait le nom de ma mère, l’absence de ma mère. »
En 2017 commence la grande aventure de l’adoption d’une petite protégée de la DPJ, dans laquelle se lance l’écrivaine à corps perdu et à plein cœur. « Et si ce n’était pas elle, s’il y avait un autre bébé dans cette famille d’amour universel ? » Quelques secondes à la porte de la famille d’accueil et le terrible doute s’était envolé : « C’était elle. Sans flou et en pastel. Mon enfant ».
L’autrice devra faire l’apprentissage d’une maternité toute à inventer, en même temps qu’elle devra maîtriser les subtilités et les méandres administratifs du processus d’adoption. Sans se faire avaler ni par l’une ni par l’autre de ces deux initiations peu banales, essayant de garder la tête hors de l’eau, elle remontera – souvent à contre-courant – le fleuve de sa propre petite enfance.
« Nouées de mère en fille. Inextricables, tissées serrées. »
 Dans Nouées, Catherine Voyer-Léger livre trois moments intimes de sa vie, qu’elle a vécus parfois écorchée vive, parfois simplement heureuse. Enchevêtrées, mais aussi singulières, les expériences se répondent l’une l’autre. Il y a tout d’abord « 2017. Le commencement du monde », soit la rencontre avec son enfant. Suit « 1984. Chocolat », les souvenirs de sa petite enfance, déchirée entre son père et sa mère. Et pour terminer, « 2001. Passer proche », sa tentative de suicide.
Dans Nouées, Catherine Voyer-Léger livre trois moments intimes de sa vie, qu’elle a vécus parfois écorchée vive, parfois simplement heureuse. Enchevêtrées, mais aussi singulières, les expériences se répondent l’une l’autre. Il y a tout d’abord « 2017. Le commencement du monde », soit la rencontre avec son enfant. Suit « 1984. Chocolat », les souvenirs de sa petite enfance, déchirée entre son père et sa mère. Et pour terminer, « 2001. Passer proche », sa tentative de suicide.
« 2017. » L’autrice explique qu’en réalité, le processus d’adoption a duré deux ans. De 2015 à 2017. Deux ans à rencontrer des travailleurs sociaux, à acheter des jouets et des vêtements, à installer une chambrette, à plier des pyjamas, à chercher des noms d’enfant. À tenter de suivre les règles, un peu perdue dans les dédales et les règlements de la DPJ. Et puis, le jour J, l’enfant s’installe enfin chez elle. « Elle est assise sur le sol et elle ne sait pas qu’elle fera ses premiers pas ce soir-là. » C’est alors que revit en l’écrivaine la culpabilité, sentiment qu’elle connaît hélas trop bien, qu’elle connaît depuis toujours. Comment devenir la mère d’une enfant qui a déjà une mère ? Quand devient-on véritablement « sa » mère ?
« Certains croiront que j’ai voulu adopter un enfant de la DPJ pour réparer quelque chose de mon passé. […] Oui. Oui, mais non. »
L’expérience est beaucoup plus complexe. « Je ne crois pas que ce système est présentement capable d’aider les parents vraiment démunis, qui font face à des enjeux multiples, qui n’ont pas les ressources pour même imaginer leur vie autrement », analyse-t-elle. Elle conclut : « [C]e système fonctionne pour les gens qui ont des ressources, mais qui vivent des crises », et elle ajoute « quelqu’un comme ma mère ».
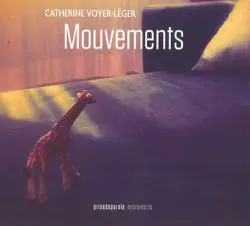 « 1984. » Dans son processus d’autoanalyse thérapeutique, l’écrivaine rembobine le fil de sa jeunesse pour mieux comprendre la relation difficile sinon malsaine longtemps entretenue avec sa mère, sa mère qui est soudainement disparue de sa vie pour aller en cure de désintoxication alors qu’elle n’avait que quatre ans. Revenue à la maison, cette mère monoparentale devient peu à peu moins disponible pour sa fille, alors que toutes deux avaient pourtant apprécié les beaux jours de retrouvailles, d’euphorie et de plaisirs partagés.
« 1984. » Dans son processus d’autoanalyse thérapeutique, l’écrivaine rembobine le fil de sa jeunesse pour mieux comprendre la relation difficile sinon malsaine longtemps entretenue avec sa mère, sa mère qui est soudainement disparue de sa vie pour aller en cure de désintoxication alors qu’elle n’avait que quatre ans. Revenue à la maison, cette mère monoparentale devient peu à peu moins disponible pour sa fille, alors que toutes deux avaient pourtant apprécié les beaux jours de retrouvailles, d’euphorie et de plaisirs partagés.
Bien qu’elle demeure attachée à son père et à sa deuxième famille, celui-ci est géographiquement bien loin. Catherine Voyer-Léger devient une de ces enfants qui vivent la clé au cou. « Je me suis beaucoup fait garder chez les uns et les autres. […] Je suppose que si j’ai, presque chaque nuit, rejoint ma mère au lit jusqu’à ma puberté, c’était aussi pour rattraper un peu ce temps que j’avais le sentiment de perdre loin d’elle. Mais je bougeais trop, et elle s’impatientait. »
Leur relation tiédit, la fille devenue adolescente se renferme, pendant que, réaliste, la mère essaie de joindre les deux bouts. Elles s’éloignent l’une de l’autre. Se succèdent pour la fille les années d’étude, cégep, baccalauréat, puis maîtrise, alors que la mère part vivre dans les Caraïbes. « Elle n’a pas d’adresse, mais elle n’est pas morte. Elle est partie, tout simplement. »
« 2001. » L’absence de sa mère, une peine d’amour, des déceptions, la tentative de suicide qui s’ensuivra, le séjour à l’urgence psychiatrique, l’autrice fait de durs apprentissages. « J’ai été longue, malgré les thérapies qui ont suivi, à vraiment comprendre jusqu’à quel point toute ma relation avec mes parents est tissée de culpabilité. » L’arrivée de sa petite fille lui ouvrira d’autres horizons, lui donnera d’autres assurances. « Elle dit : Je te confiance. J’en suis profondément émue. Si troublée. […] Elle me fait confiance. »

« Mon vrai pays, c’est l’autoroute des Laurentides. »
Enfant d’une autoroute
Prise entre son cœur et l’espace
Entre un amour déchiré
Et sa confiance envolée3
Dans Mouvements, récit de voyages illustré de ses propres photos, Catherine Voyer-Léger tente de comprendre son nomadisme, devenu son style de vie. D’où lui vient cet impérieux appel de la route ? Elle présente 40 de ses photographies, qu’accompagnent 40 moments de réflexion, comme autant d’endroits où son âme et son corps se sont déjà posés. Sudbury ou Montréal, Le Bic ou Genève, elle fouille dans ses souvenirs et parle de son besoin d’être ailleurs. « Entre deux valises, une brassée de linge en retard, dans le plaisir toujours (presque, dire presque) de bouger, mais la douleur (régulière, mais pas constante) de ne savoir m’enraciner. »
Tel était son passé, tel est maintenant son présent. Enfant de parents séparés, puis de familles reconstituées, Catherine Voyer-Léger se déplaçait selon les bons vouloirs de ses parents. Elle allait de Saint-Sauveur à Montréal, aller-retour, habituée de la « 15 » dès sa plus tendre enfance. Aujourd’hui, ses parents « sont encore perchés chacun à leur bout de l’autoroute ». Devenue adulte, ses ports d’attache se sont multipliés, selon les études, selon le travail, selon les représentations, les salons du livre et autres entrevues. Souffrirait-elle de dromomanie, cette impulsion à se déplacer, souvent caractéristique des personnages de Charlie Chaplin ?
Depuis quelques années, depuis qu’elle est mère, la situation familiale de l’autrice l’oblige à plus de sédentarité, mais quand même, de temps en temps, elle sent le besoin de sauter la barrière, de rompre avec la routine du quotidien. « Et je pars pourtant. Entravée, je pars. Monoparentale, je m’arrange et je pars. » Catherine Voyer-Léger connaît les problèmes d’attachement que peuvent avoir les enfants adoptés, ainsi que les difficultés d’être monoparentale qu’elle a remarquées chez sa propre mère, elle sait tout cela, mais elle fonce quand même.
Elle ne veut pas arrêter « ce mouvement de balancier nord-sud qui avait marqué toute [s]a vie ». Adulte responsable, elle est cependant plus sage. « À une époque, je bravais le temps, la fatigue ou la faim. Je roulais sans daigner m’arrêter. Et puis je n’ai plus été aussi téméraire. […] Devenue mère – chauffeuse privée d’une star de la chanson, d’une fée pirate, d’une marmotte autoroutière – je nous sais maintenant fragiles au pluriel. »
L’écrivaine conclut : « Je pourrais dire que je tourne moins en rond. Mais c’est faux. Je tourne sur un autre axe. On m’avait dit que je serais moins en mouvement. Mais c’est faux. Mon mouvement revient plus souvent ». Tout simplement s’assumer, sans culpabilité.
Catherine Voyer-Léger, femme de cœur et femme de tête

Née en 1979 dans la petite ville de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, précisément dans la MRC des Pays-d’en-Haut, Catherine Voyer-Léger est romancière, chroniqueuse, animatrice, critique culturelle et blogueuse. Après avoir occupé le poste de directrice du Regroupement des éditeurs canadiens-français, elle a été coordonnatrice des activités de l’Alliance culturelle de l’Ontario, puis présidente du Théâtre de la Vieille 17 et du Salon du livre de l’Outaouais. En 2020, elle prend la direction du Conseil québécois du théâtre.
Polyvalente et multitalentueuse, l’autrice a fait des études supérieures en science politique à l’Université du Québec à Montréal et en lettres françaises à l’Université d’Ottawa. En 2018, elle a reçu la bourse d’écriture Jean-Pierre-Guay – Caisse Desjardins de la Culture, et en 2019, le prix littéraire Jacques-Poirier – Outaouais. Elle a aussi été finaliste du Prix du livre d’Ottawa ainsi que du Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, œuvre de l’année en Outaouais.
Voir aussi la critique de Suzanne Jacob. La pensée comme espèce menacée, sous la dir. de Lucie Joubert et Catherine Voyer-Léger, p. 62.
* « Sur les autoroutes, le ciel est grand. Il m’arrive de m’imaginer que je fonce dans la beauté du temps. », Mouvements, p. 24-25.
** « J’ai dû admettre que, déjà bien grande fille, cet œil de plastique était quelque chose comme un ami. », Mouvements, p. 35.
1. Catherine Voyer-Léger, Nouées, Québec Amérique, Montréal, 2022, 168 p. ; 20,95 $.
2. Catherine Voyer-Léger, Mouvements, Prise de parole, Sudbury, 2022, 124 p. ; 22,95 $.
3. Catherine Voyer-Léger, vers 1995.
EXTRAITS
Quelqu’un me dit que tout le monde a la nostalgie de la maison de son enfance. Je ne crois pas. Il faut déjà avoir eu une maison de son enfance et tout le monde n’a pas eu ça. […] La maison de mon enfance était assez froide et sans lumière. Vide aussi.
Mouvements, p. 14.
Quand nous voyageons ensemble, je voyage lourd. Un parc. Une poussette. Des couches. Des vêtements de rechange. Des jouets. Une pharmacie. Une armée de toutous. Nous voyageons lentement. Six heures pour faire la route entre les Laurentides et Québec et je ne comprends toujours pas où toutes ces heures sont passées…
Mouvements, p. 86.
Je me suis présentée avec la petite au lieu dit. J’ai tout de suite constaté qu’elle ne reconnaissait pas l’endroit, et ça m’a un peu inquiétée. Son autre mère est arrivée, elle l’a prise dans ses bras. La petite rigolait, mais le malaise était palpable.
Elle m’a regardée dans les yeux et m’a demandé : Maman… c’est qui, ça ?
J’ai eu l’impression d’entendre l’air se déchirer autour de nous.
Nouées, p. 42.
Je n’étais pas la bonne petite fille au bon endroit. Il y a un folklore familial quant à ce passage, des souvenirs que les adultes de l’époque racontent encore en riant. Pour ma part, j’en garde seulement un sentiment d’hostilité. Une profonde solitude. […] Je ne comprenais pas vraiment ce que les gens me disaient : l’accent montréalais était comme une langue étrangère.
Nouées, p.87.











