Le titre du dernier ouvrage de Mathieu Bélisle est sans équivoque, comme l’était celui de l’un de ses essais précédents, Bienvenue au pays de la vie ordinaire. L’auteur pose ici un regard juste et sensible sur la pandémie que nous venons de traverser, nous invitant par le fait même à en faire autant.
À peine après avoir terminé la lecture de Ce qui meurt en nous1, je repense à une entrevue qu’avait accordée, il y a de cela quelques années, Fred Vargas à un animateur vedette qui régnait alors sur les plateaux de télévision français. Elle évoquait, déjà en 2006, ce qu’il adviendrait si une pandémie, en tout point comparable à celle que nous venons de traverser, s’abattait sur nos sociétés. L’animateur, prenant à témoin les autres invités présents sur son plateau, davantage porté à amuser son public qu’à l’informer et à l’inviter à réfléchir, à prendre conscience de ce que pourrait représenter une telle menace, la relançait sans cesse d’un ton railleur : Et l’on devrait alors porter un masque ? Se tenir à distance des autres ? Ne plus se donner l’accolade ? Demeurer confiné chez soi ? Revêtir une protection pour sortir à l’extérieur ? À chacune des réponses qu’elle formulait, Fred Vargas s’efforçait d’éviter le piège du ridicule que lui tendait l’animateur, ce dernier ne pouvant s’empêcher d’étaler son sourire niais le plus largement possible. Je me demande s’il n’a pas cherché, au cours des deux dernières années, à effacer toute trace de sa bêtise (l’entrevue se trouve toujours sur YouTube, soit dit en passant).
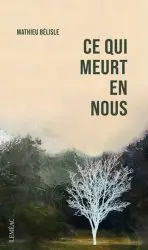 Mais revenons au livre de Mathieu Bélisle. Contrairement à Fred Vargas qui cherchait alors à nous mettre en garde contre notre inconscience et notre ignorance face à notre incurie collective au regard de la protection de l’environnement, et, conséquemment, des effets dévastateurs qu’une telle attitude pouvait entraîner sur la prolifération de virus, Bélisle s’attarde plutôt à analyser la crise planétaire que nous venons de traverser et les effets qu’elle aura eus, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Les trois premiers textes réunis ici analysent la pandémie sous différents angles ; ils sont suivis d’un quatrième qui se veut, comme le suggère le titre qui le coiffe, « Un peu de lumière », porteur d’espoir. Autant dans sa forme que par la posture critique et réflexive qu’adopte Mathieu Bélisle, Ce qui meurt en nous se veut un hommage à Pierre Vadeboncœur et à la démarche de ce dernier qui n’a eu de cesse, comme essayiste, de nous dessiller les yeux sur notre incapacité à assumer notre destin.
Mais revenons au livre de Mathieu Bélisle. Contrairement à Fred Vargas qui cherchait alors à nous mettre en garde contre notre inconscience et notre ignorance face à notre incurie collective au regard de la protection de l’environnement, et, conséquemment, des effets dévastateurs qu’une telle attitude pouvait entraîner sur la prolifération de virus, Bélisle s’attarde plutôt à analyser la crise planétaire que nous venons de traverser et les effets qu’elle aura eus, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Les trois premiers textes réunis ici analysent la pandémie sous différents angles ; ils sont suivis d’un quatrième qui se veut, comme le suggère le titre qui le coiffe, « Un peu de lumière », porteur d’espoir. Autant dans sa forme que par la posture critique et réflexive qu’adopte Mathieu Bélisle, Ce qui meurt en nous se veut un hommage à Pierre Vadeboncœur et à la démarche de ce dernier qui n’a eu de cesse, comme essayiste, de nous dessiller les yeux sur notre incapacité à assumer notre destin.
Le premier texte du présent essai, intitulé « Quelque chose s’est brisé », s’attarde à analyser notre rapport à la mort. Rapport difficile et le plus souvent occulté, confié à des tiers qui ont su en tirer parti pour s’enrichir, soulagés que nous sommes que d’autres prennent en charge la mort à notre place. Le titre révèle notre difficulté à envisager l’issue de toute existence, difficulté qui, faut-il le rappeler, s’est trouvée amplifiée durant la pandémie. Comment en sommes-nous arrivés à nous réfugier, collectivement, dans une forme de déni face à la mort, à faire le deuil d’un vrai deuil lorsqu’un proche, atteint de la COVID-19, mourait isolé de tous ? Il fallait vraiment que quelque chose se soit brisé en nous pour que l’on demeure paralysés, voire passifs, devant l’abondance de chiffres que l’on nous assénait, jour après jour, sur les gens emportés par le virus. Obnubilés par la peur d’être contaminés, nous retenions chaque jour notre souffle en écoutant le bilan des dirigeants de la santé publique. La recherche éperdue d’un vaccin a supplanté le devoir d’honorer la mémoire des gens que l’on a abandonnés, tels des pestiférés, parfois dans des conditions déplorables, à leur sort. Les constats qu’en tire Mathieu Bélisle sont sévères, mais il se garde de jeter la pierre aux dirigeants alors en place tant nos attentes pouvaient à certains moments paraître irréalistes devant notre exigence d’être à l’abri de tout risque, de pouvoir continuer à vivre comme si de rien n’était. « Ça va bien aller », répétait-on sans cesse. Tout autre discours ne ferait que favoriser la montée du complotisme, qui n’a besoin d’aucun encouragement extérieur pour se répandre.
Mathieu Bélisle nous invite à élargir notre réflexion à partir de cette expérience collective, certes douloureuse, mais qui n’en a pas moins révélé notre difficulté, voire notre déni, à accepter que toute vie soit indissociable de sa finalité. « Personne ne semblait prêt à admettre, écrit-il, que la vie était inconcevable sans le risque, que toute vie était – et est encore – un pari, un défi lancé à la mort, que si une mort était une mort de trop, eh bien, c’était nous, pauvres mortels, qui étions de trop. » Et la conclusion est ici sans appel : le déni de la mort conduit fatalement au mépris de la vie.
La pandémie n’a pas que ravivé notre peur viscérale de la mort, elle a aussi profondément modifié notre rapport aux autres. Lorsque chacun de nos contacts, chacune de nos connaissances sont devenus potentiellement susceptibles de nous transmettre le virus, la dynamique de nos rapports sociaux, voire familiaux, a été profondément modifiée. En un temps record qui défie l’entendement, nous sommes devenus les uns pour les autres des avatars de nous-mêmes, des fantômes évoluant dans un monde dématérialisé. Travail et cours à distance, rencontres familiales par le biais d’écrans, soupers Zoom et consultations médicales virtuelles, participation aux cérémonies funéraires sur sa tablette, les exemples de la rapide transformation de nos rapports sociaux ne manquent pas. Le monde idéalisé que l’on nous promettait, libéré de toute contrainte physique, se révélait enfin accessible, à notre portée. Nous n’avions omis qu’un seul détail : il entraînerait notre propre dématérialisation dans un monde libéré des contraintes physiques. Nous attendions tout de la technologie, qu’elle nous libère de nos servitudes, qu’elle fasse obstacle aux menaces qui nous guettent, jusqu’à ce que nous prenions conscience que le pacte, comme l’écrit Bélisle, entre l’humanité et la technologie reposait sur un malentendu. Les deux dernières années nous ont démontré à quel point nous étions dépendants de la technologie qui gère nos vies, sinon soumis à cette même technologie. À lui seul, le terme présentiel, produit de la novlangue technocratique, utilisé pour différencier le type de rapport que nous entretenons avec les autres, dénote le glissement qui s’est opéré à notre insu : notre propre matérialité se mesure aujourd’hui à l’aune de la réalité virtuelle. À cet égard, la capacité du virus à muter rapidement pouvait, de fait, nous faire craindre le pire.
Cette perte de sens, à laquelle s’attarde Mathieu Bélisle, se reflète dans la prolifération des sigles et des acronymes qui se répandent aussi rapidement que le virus. Cela a contribué autant à l’euphémisation du réel qu’à l’indétermination politique dans laquelle nous sommes plongés. Ironiquement, la pandémie a révélé l’état lamentable de nos établissements de santé et de nos établissements scolaires, sur lesquels nous exerçons déjà notre souveraineté. Il importe plus que jamais, souligne Bélisle, que nous nous réappropriions le pays réel, celui que nous avons relégué derrière des mots vides de sens et que nous avons fini par oublier.
Sommes-nous prêts à affronter le réel, à libérer les forces de vie qui ne demandent qu’à voir le jour ? Sommes-nous prêts à prendre le risque de vivre pleinement ? Voilà à la fois les questions que cet essai soulève et la voie que nous invite à suivre Mathieu Bélisle.
1. Mathieu Bélisle, Ce qui meurt en nous, Leméac, Montréal, 2022, 145 p. ; 15,95 $.
EXTRAITS
En somme, dans l’écriture de ce livre, j’ai décidé de prendre le parti du tragique, de voir le monde avec les yeux de ma mère.
p. 19
Peut-être que si nous savions mieux parler de la mort, nous saurions mieux mourir ; et que sachant mieux mourir, nous saurions mieux vivre.
p. 22
La pandémie, au fond, ce n’était peut-être rien d’autre que la réduction de la mort au rang de phénomène statistique.
p.36
La technologie ne pouvait rien faire d’autre que maintenir l’illusion de continuité avec le monde d’avant, avec une humanité qui en vérité n’était déjà plus ce qu’elle avait été, qui se trouvait soudain réduite à l’état de fantôme.
p. 72
C’est la plus grande découverte que j’ai faite au cours de cette pandémie : nous ne savons pas parler de la mort, nous sommes incapables de nous la représenter pour nous-mêmes, de comprendre ce qu’elle peut signifier, de saisir ce qui avec elle à la fois finit et commence. « Nous sommes d’une race qui ne sait pas mourir », peut-on lire dans Maria Chapdelaine de Louis Hémon. J’ai parfois le sentiment que cette phrase célèbre est moins un hommage à la résilience d’un peuple que l’expression d’un constat brutal et sans appel, qui signale une incapacité de nature métaphysique : non, en effet, nous ne savons pas mourir, et c’est là tout le problème.
p. 20-21
Nous assistions à la mise en œuvre d’une utopie discrète, dont l’attrait devenait de plus en plus irrésistible, celle de la société du risque zéro. Dans une telle société, c’est d’abord le corps qu’il fallait protéger, au mépris de (presque) tout le reste, des relations humaines, de la santé mentale, de l’activité sociale et économique, de la jeunesse aussi.
p. 49
Dans les faits, nous avons moins parlé de la mort que nous n’avons paniqué collectivement à la seule pensée de la mort, comme si son apparition subite, dans les pays dits avancés, relevait du scandale le plus complet. C’est comme si nous avions oublié qu’elle existait, qu’elle était notre lot commun, l’Épreuve qui nous attendait, hommes et femmes, riches et pauvres, « de souche » et immigrants, et cette étrange découverte, qui avait toutes les apparences d’une blessure narcissique (l’édifice de notre prospérité était-il donc si fragile ?), nous l’avons immédiatement recouverte d’un immense voile pudique.
p. 34
Nous vivions sans le savoir une révolution anthropologique, laquelle se préparait depuis quelque temps déjà et attendait sans doute qu’une crise survienne pour s’imposer tout à fait, sans même qu’il soit question pour nous d’y consentir ou de la refuser. Nous n’étions pas préparés à affronter la menace d’un virus aussi contagieux, et pourtant nous avons rapidement trouvé les moyens techniques de changer notre mode de vie, comme si la structure sociale était déjà prête à accepter l’ordre nouveau qui s’établissait, que l’ancienne structure avait été vidée de tout ce qui l’attachait au passé et pouvait encore résister.
p. 84











