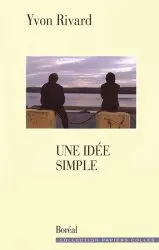Une idée simple regroupe douze essais d’Yvon Rivard, chacun explorant à sa façon les préoccupations de l’écrivain, sa quête de sens doublée du désir de partager avec son lecteur ses avancées autant que son questionnement. D’emblée, en avant-propos, l’intention qui s’avère le dénominateur commun du projet est énoncée : « […] j’ai essayé d’obéir à cette idée simple, énoncée par Hermann Broch, voulant que le premier devoir de l’intellectuel, dans l’exercice de son métier, soit de porter assistance à autrui ». Ainsi énoncé en termes de devoir et d’assistance, le métier d’écrivain, pour Rivard, s’inscrit résolument au cœur de la cité et des préoccupations de son époque.
Le premier texte explore les possibilités, mais peut-être davantage les limites du métier d’écrivain, de la posture de l’intellectuel devant ce constat. S’appuyant sur sa propre expérience, interrogeant sa condition d’intellectuel, Rivard cherche ici la voie qui lui permettra de soustraire sa vie, sa propre quête à quelque chose qui ne soit ni vain ni superficiel. Comment définir l’action dans une telle quête ? Et vers quoi devrait-elle tendre pour s’inscrire non dans le gain, mais dans une démarche de liberté ? C’est à cette question complexe qu’Yvon Rivard propose l’assistance à autrui, l’action inscrite dans la réalité, la prise de contact physique avec le monde réel. Rivard développe fort habilement sa pensée en s’appuyant tour à tour sur celle d’autres écrivains : Broch, Rilke, Handke, Blanchot, et bien d’autres.
Dans le texte intitulé « Le retour de l’enfant prodigue », Yvon Rivard renoue avec les premières lectures qui ont été marquantes dans son parcours d’écrivain. Qui a lu ses essais et romans précédents ne se surprendra pas qu’il revisite à nouveau l’œuvre de Virginia Woolf, de Peter Handke, de Rainer Maria Rilke, pour ne nommer que ces derniers. C’est en réfléchissant à cette filiation qu’il évoque la métaphore de l’enfant prodigue, le besoin de se libérer du regard de celui qui aime mais qui, dans le même mouvement, vous emprisonne dans l’image de l’être aimé, besoin qu’il concrétise dans l’écriture en ce qu’elle permet d’échapper à ce cadre en le recréant. Sa réflexion l’entraîne à repenser la légitimité de toute quête artistique, mouvement qui conduit le créateur à l’isolement et à la solitude (on revient ici à l’image de l’enfant prodigue), à la recherche incessante de l’équilibre entre la réalité et le rêve. Le texte se termine par une relecture des derniers ouvrages de Pierre Vadeboncœur qui explore, à sa façon, le passage de l’un à l’autre.
Dans un autre texte, « Le temps plus grand » (autre emprunt à Peter Handke), Rivard interroge notre relation au temps, celle de l’artiste qui doit composer avec une matière à la fois évanescente et dense, qui relie notre venue au monde à l’instant où nous devrons le quitter. « Sagesse : façon de vieillir, d’user le moi pour l’élargir, pour mieux percevoir le monde dont le moi s’est si souvent détourné, de sorte que mourir, loin d’être la perte de quoi que ce soit, sera peut-être le commencement de quelque chose. » Telle est, selon Yvon Rivard, la quête de Peter Handke, la voie qu’il explore inlassablement, autant dans son œuvre romanesque que dans ses essais. « Le travail de l’artiste, poursuit Rivard, c’est la conquête de ce temps, c’est d’arriver à se maintenir dans ce temps, en multipliant et en racontant les instants fugaces où l’on aperçoit sa propre éternité à travers tous les événements ou les sentiments qui nous enchaînent bêtement à la linéarité des causes et des effets. »
En toile de fond des essais réunis ici, Yvon Rivard cherche à établir un dialogue en vue, d’une part, de mieux comprendre les motifs qui guident sa démarche et sa pensée, et, d’autre part, d’éviter l’enlisement dans des justifications aussi vaines que stériles dans le seul but d’échapper au questionnement qui est le propre de tout esprit libre.