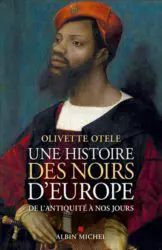On ne sait trop quoi penser du livre d’Olivette Otele quand on en a tourné la dernière page puisqu’il ne s’agit pas vraiment d’une histoire au sens où on l’entend habituellement, c’est-à-dire un récit chronologique qui retrace le parcours d’un individu, le destin d’une population ou le développement d’un courant de pensée.
Ici, plutôt que de brosser une histoire linéaire, l’essai d’Olivette Otele accumule des considérations et des digressions diverses (ethnologiques, sociales, culturelles, etc.) sur le thème de la présence des Noirs en Europe. Dans ce récit un peu sinueux, elle évoque ici et là la figure de quelques Noirs ou Métis célèbres (l’empereur Septime Sévère, saint Maurice, Alexandre de Médicis ou Pouchkine) et d’autres moins célèbres dans l’historiographie occidentale « blanche ». C’est la partie la plus intéressante du bouquin.
Fait étonnant, l’auteure consacre tout un chapitre au statut des signares, les femmes sénégalaises qui épousaient des colons européens, et au rang social auquel ce mariage leur permettait d’accéder dans leur communauté de même qu’aux privilèges qu’elles et leurs enfants en tiraient. On se demande bien ce que vient faire cette longue parenthèse « africaine » – par ailleurs intéressante – dans un travail qui se propose de raconter l’histoire des Noirs installés en Europe.
De même, les deux derniers chapitres sont abondamment consacrés à évoquer le travail réalisé ces dernières décennies par une poignée de militants – surtout des femmes – pour dénoncer les injustices et les vexations multiples imposées aux Noirs d’Europe au cours des siècles et pour réclamer plus d’égalité dans le futur.
Titulaire d’une chaire d’histoire à l’université de Bristol en Grande-Bretagne, Olivette Otele est donc une intellectuelle de haut calibre. Cela ne va pas sans marquer son écriture. Ainsi, soucieuse de bien étayer son argumentaire, elle noie parfois son texte dans tant de références que le lecteur qui n’est pas familier avec le sujet se sent un peu perdu, faute de posséder les connaissances que l’auteure lui suppose.
Pour toutes ces raisons, Une histoire des Noirs d’Europe. De l’Antiquité à nos jours tient parfois plus du manuel didactique que de l’ouvrage de vulgarisation. L’auteure aurait eu intérêt à se tenir plus près de son sujet, à éviter les digressions et le jargon propres aux universitaires et à un certain militantisme. Des oublis étonnants (par exemple, la participation des Noirs aux deux guerres mondiales) et de grosses coquilles dans l’édition française (erreurs de date ou de siècle) sont également à signaler.