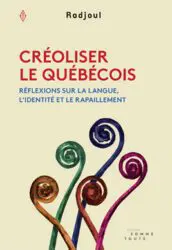Il faut reconnaître à l’auteur une certaine audace. Six ans seulement après son arrivée au Québec – il est né au Togo –, il nous propose sa vision de la langue parlée ici et de son avenir.
Ancien journaliste, détenant une formation en sociologie, Radjoul Mouhamadou est inscrit en études internationales à l’Université Laval. Il avoue son amour pour le Québec, il s’est imprégné des auteurs d’ici, il a fait ses classes, c’est indéniable. En exergue de son livre, on retrouve un extrait de la chanson « Un beau grand bateau », écrite par Denise Boucher pour Gerry Boulet, et, en épilogue, il mentionne qu’il a « tripé ben raide » sur « Un peu plus haut » de Ferland, interprétée par Ginette Reno.
Il veut convaincre les Québécois de faire la paix avec leur manière de parler que d’aucuns décriront comme une version abâtardie du français originel. C’est le destin des langues que de se diversifier. Vouloir s’accrocher à la nostalgie d’un passé dépassé revient à ramer contre le courant. Dans une habile formule inspirée de Ricœur, dans laquelle s’insère toute identité personnelle, il met à jour le devenir du Même et de l’Autre : « Le pari de la continuité dynamique d’un peuple québécois requiert de se considérer soi-même comme un autre pour se mettre en disposition d’accueillir l’Autre comme soi-même ». Mouhamadou préfère la notion de pays, plus ouverte et porteuse d’avenir, à la notion de nation qui demeure, selon lui, fermée, ce qui rappelle l’ancienne distinction établie par le sociologue allemand Ferdinand Tönnies (1855-1936) entre société et communauté.
Les Québécois devraient assumer leur langue en intégrant une « pluralité de voix narratives incluant l’altérité autochtone », sans oublier d’ajouter les voix migrantes. Les voix du Québec doivent apprendre à se libérer du « contrôle parental » de la France. Il n’y a pas plus d’accent ici qu’ailleurs dans la francophonie. Ou tout le monde a un accent, ou il n’y en a aucun.
Mouhamadou invite donc les Québécois à réussir leur créole. Rappelons que le créole est une langue en soi. L’auteur se réfère beaucoup à Édouard Glissant, écrivain, poète et philosophe martiniquais, à qui l’on doit l’idée de créolisation, cette manière de désigner de nouvelles identités nées des confluences de divers courants.
Mouhamadou ne s’inquiète pas de la préservation du français au Québec. Il affirme que « la bataille de Montréal est d’ores et déjà perdue ». La métropole ne reflète plus l’héritage atavique du nationalisme francophone. Le français et l’anglais s’enrichissent mutuellement. On assisterait à Montréal à ce qui se joue ailleurs dans les grandes métropoles. Je ne suis pas sûr, cependant, qu’à Rome, Berlin ou Paris l’anglais vienne éradiquer l’italien, l’allemand ou le français de la même manière qu’à Montréal. Même si le globishest un « anglais qui n’appartient plus aux Anglais », n’empêche, il demeure la matrice qui repousse dans l’ombre d’autres cultures. L’auteur n’est pas convaincu que la langue constitue l’essence d’un peuple. C’est vrai : des peuples de culture différente partagent parfois la même langue. Mais de quelle manière l’ancienne culture francophone survivrait-elle si jamais le français, créolisé ou non, disparaissait définitivement ? Mouhamadou écrit que « les langues ne sont que des simples outils permettant de communiquer ». Pourtant, elles ne leur sont pas comparables ; elles sont des manières de saisir et d’habiter le monde. Elles sont le creuset de l’identité des peuples. L’auteur, qui a tant à cœur les premiers peuples, a sûrement remarqué la revitalisation des langues autochtones.
On lira Créoliser le québécois pour son regard neuf et un brin provocateur sur les langues de chez nous.