Hasard troublant, synchronicité préoccupante, les voix d’autrices disparues, dont Etty Hillesum et Edith Bruck, toutes deux déportées avec leur famille vers les camps d’extermination, viennent nous rappeler que ce que l’on croyait à jamais éradiqué peut ressurgir à tout moment.
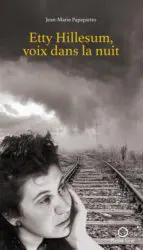 Extraite du Journal d’Etty Hillesum, jeune intellectuelle née dans une famille juive à Amsterdam, l’adaptation théâtrale, Etty Hillesum, voix dans la nuit1, comporte trois actes. Trois mouvements, comme il est précisé, ce dernier terme convenant mieux en ce qu’il nous transporte et nous remue dans l’univers des camps de concentration érigés au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Marie Papapietro, l’auteur de cette adaptation, réussit le tour de force de reproduire, en à peine 60 pages, le caractère d’intensité, d’intimité et d’humanité qui a prévalu au moment où la jeune femme écrivait son journal, de mars 1941 à octobre 1942. Ce dernier comporte plus de 800 pages, regroupées dans 11 cahiers, et a été écrit durant son internement à Auschwitz en compagnie de ses parents et de ses deux frères. Tous y trouveront la mort. Tout en interrogeant les racines du mal, la pièce laisse entrevoir une lueur d’espoir, ce qui n’est pas sans nous troubler lorsqu’on sait le sort réservé aux membres de sa famille. Le discours porté par Etty Hillesum rappelle le constat fait par Hannah Arendt dans son analyse des systèmes totalitaires. Les détenus ne sont donc plus que des matricules que l’on peut additionner en colonnes, soustraire, éliminer. Un simple travail de comptabilité, ce que dénonce la pièce : « En dépit de toutes les souffrances infligées… de toutes les injustices commises… haïr les hommes, je n’y suis jamais parvenue… (Un temps.) les systèmes… l’effrayant ce sont les systèmes ». Mais revenons à l’adaptation elle-même.
Extraite du Journal d’Etty Hillesum, jeune intellectuelle née dans une famille juive à Amsterdam, l’adaptation théâtrale, Etty Hillesum, voix dans la nuit1, comporte trois actes. Trois mouvements, comme il est précisé, ce dernier terme convenant mieux en ce qu’il nous transporte et nous remue dans l’univers des camps de concentration érigés au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Marie Papapietro, l’auteur de cette adaptation, réussit le tour de force de reproduire, en à peine 60 pages, le caractère d’intensité, d’intimité et d’humanité qui a prévalu au moment où la jeune femme écrivait son journal, de mars 1941 à octobre 1942. Ce dernier comporte plus de 800 pages, regroupées dans 11 cahiers, et a été écrit durant son internement à Auschwitz en compagnie de ses parents et de ses deux frères. Tous y trouveront la mort. Tout en interrogeant les racines du mal, la pièce laisse entrevoir une lueur d’espoir, ce qui n’est pas sans nous troubler lorsqu’on sait le sort réservé aux membres de sa famille. Le discours porté par Etty Hillesum rappelle le constat fait par Hannah Arendt dans son analyse des systèmes totalitaires. Les détenus ne sont donc plus que des matricules que l’on peut additionner en colonnes, soustraire, éliminer. Un simple travail de comptabilité, ce que dénonce la pièce : « En dépit de toutes les souffrances infligées… de toutes les injustices commises… haïr les hommes, je n’y suis jamais parvenue… (Un temps.) les systèmes… l’effrayant ce sont les systèmes ». Mais revenons à l’adaptation elle-même.
 Le premier mouvement montre deux personnages, dont celui d’Etty. Seule sur scène, elle engage un dialogue avec un second personnage, nommé l’Interrogateur, qui prend place derrière les spectateurs. Leur échange puise à même le journal d’Etty Hillesum, publié sous le titre Une vie bouleversée, et fait justement ressortir l’absurdité et l’inhumanité des systèmes totalitaires qui cherchent à écraser et à éradiquer toute voix discordante. L’accent est mis ici sur l’origine et l’essence de ce mal, qui, à tout moment, peut surgir et infester une société, comme nous le rappelle la guerre actuelle en Ukraine, et sur la foi de la jeune femme, inébranlable, et sa conviction que le bien, malgré les souffrances, vaincra le mal. Le deuxième mouvement est très court. Il introduit un nouveau personnage, l’amant d’Etty, à qui sera confiée la responsabilité de préserver les onze cahiers composant le Journal afin qu’il ne soit pas détruit. Le ton est cette fois plus intime et évoque autant le sort réservé aux détenus des camps que la responsabilité des artistes. « Être artiste aujourd’hui, c’est combattre pour la liberté », répond le personnage de Klaas à Etty lorsque cette dernière lui enjoint de faire ce qu’ils peuvent encore pour les autres. Le dernier mouvement, intitulé « Au-delà du temps », ramène les deux amants pour une ultime dénonciation de la barbarie, et un cri d’espoir que la vie sera toujours plus forte.
Le premier mouvement montre deux personnages, dont celui d’Etty. Seule sur scène, elle engage un dialogue avec un second personnage, nommé l’Interrogateur, qui prend place derrière les spectateurs. Leur échange puise à même le journal d’Etty Hillesum, publié sous le titre Une vie bouleversée, et fait justement ressortir l’absurdité et l’inhumanité des systèmes totalitaires qui cherchent à écraser et à éradiquer toute voix discordante. L’accent est mis ici sur l’origine et l’essence de ce mal, qui, à tout moment, peut surgir et infester une société, comme nous le rappelle la guerre actuelle en Ukraine, et sur la foi de la jeune femme, inébranlable, et sa conviction que le bien, malgré les souffrances, vaincra le mal. Le deuxième mouvement est très court. Il introduit un nouveau personnage, l’amant d’Etty, à qui sera confiée la responsabilité de préserver les onze cahiers composant le Journal afin qu’il ne soit pas détruit. Le ton est cette fois plus intime et évoque autant le sort réservé aux détenus des camps que la responsabilité des artistes. « Être artiste aujourd’hui, c’est combattre pour la liberté », répond le personnage de Klaas à Etty lorsque cette dernière lui enjoint de faire ce qu’ils peuvent encore pour les autres. Le dernier mouvement, intitulé « Au-delà du temps », ramène les deux amants pour une ultime dénonciation de la barbarie, et un cri d’espoir que la vie sera toujours plus forte.
La force de ce texte tient au choix effectué par Jean-Marie Papapietro d’en restituer à la fois la profondeur, la sensibilité et la très grande humanité en dépit des conditions et du contexte dans lesquels il a vu le jour. Comme l’écrit l’auteur dans la postface : « Par-dessus tout, le Journal reste le récit d’une conquête de soi-même, d’un souci constant d’autonomie et d’une volonté d’assumer ses responsabilités dans un monde qui vacille et sombre peu à peu dans l’innommable ». La lumière qui émane de ce texte est tout aussi troublante que rassurante.
1. Jean-Marie Papapietro, Etty Hillesum, voix dans la nuit, Pleine Lune, Lachine, 2022, 88 p. ; 19,95 $.
EXTRAITS
ETTY H. – Accepter de souffrir s’il le faut, mais ne jamais se résigner.
p. 33
ETTY H. – Un après-midi, je regarde des estampes japonaises. Longuement, attentivement. Et tout s’éclaire d’un coup : c’est ça que je cherche, c’est ainsi que je veux écrire. « Écrire, avec autant d’espace autour de peu de mots. »
p. 36
ETTY H. – Je t’écoute. J’ai beaucoup réfléchi, Klaas. La seule solution, mais vraiment la seule, et je ne vois pas d’autre issue, c’est que chacun fasse un retour sur lui-même, et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu’il doit anéantir chez les autres. Et pour commencer, la haine.
p. 51
ETTY H. – J’ai compris que ce monde de bureaucrates et de techniciens, d’ingénieurs, de technocrates et de planificateurs, toujours plus performants, toujours plus efficaces, ce monde concentrationnaire allait devenir le monde de demain. L’avenir de l’humanité.
p. 63











