Il est des livres qui marquent leur époque, traçant une ligne temporelle entre le passé et l’avenir. Des livres qui deviennent le symbole du changement qu’ils ont incarné. Cri de terre de Raymond Guy LeBlanc (24 janvier 1945 – 28 octobre 2021) est un de ceux-là pour l’Acadie.
En 1972, l’Acadie vit une effervescence culturelle, sociale et politique qu’elle n’avait jamais connue. Bien sûr, ce mouvement n’est pas né du jour au lendemain. Durant les années 1960, la société acadienne et néo-brunswickoise se transforme. Le gouvernement libéral de Louis J. Robichaud, au pouvoir de 1960 à 1970, a instauré une série de changements sous le thème « Chances égales pour tous », parmi lesquels la création de l’Université de Moncton, l’institution du bilinguisme dans la province, ainsi qu’une refonte complète du système d’éducation et des services de santé. Une révolution tranquille façon néo-brunswickoise que le progressiste-conservateur Richard Hatfield, qui succède à Robichaud, embrasse à son tour.
En littérature, le poète Ronald Després et la romancière Antonine Maillet publient leurs premières œuvres en 1958. Mais ils n’ont d’autre choix que de le faire au Québec puisqu’il n’existe pas d’éditeurs en Acadie. À l’été 1969, la revue Liberté consacre son soixante-cinquième numéro à l’Acadie : des essais et des textes de création par des écrivains parmi lesquels on retrouve Antonine Maillet, Herménégilde Chiasson, Léonard Forest et Raymond Guy LeBlanc : « C’est au risque des mots vérité / En rupture du langage prison / C’est au risque des jeunes visions / Que nous parlerons de liberté », écrit ce dernier dans « Poème pour révolutionnaires ».
À l’été de cette année 1969, LeBlanc revient transformé d’une année d’études en philosophie à l’Université d’Aix-en-Provence : il est passé de Bergson, son sujet d’études au départ, à Marx, il a les cheveux longs, il a découvert Claude Gauvreau et le lettrisme : « Une amie qui s’appelait Anna m’a introduit à Attila Josef, un poète hongrois qui parle du réveil du peuple à travers l’image du fleuve. Et là, j’ai pensé au Petitcodiac. J’ai commencé à écrire : ‘Brune vague pulsion à deux mouvements’. Tout a pris forme à partir de cette conjonction de la poésie hongroise révolutionnaire, de la poésie radicale de Gauvreau, du lettrisme et du son », affirme-t-il lors d’une entrevue qu’il accorde à Robert Viau1. Ainsi naît « Petitcodiac », que publie Liberté : « C’est à NOUS la pêcheuragriviente / de hachissifier les arbivorastres feuillages / pour que les panaches orgastiques / dégringolossent ».
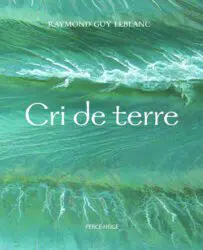 Trois ans plus tard, un groupe de professeurs réunis autour de Melvin Gallant fonde les Éditions d’Acadie et publie à la toute fin de l’année un premier livre, le recueil Cri de terre de Raymond Guy LeBlanc.
Trois ans plus tard, un groupe de professeurs réunis autour de Melvin Gallant fonde les Éditions d’Acadie et publie à la toute fin de l’année un premier livre, le recueil Cri de terre de Raymond Guy LeBlanc.
Le 30 janvier 1973, Cri de terre est lancé « d’une manière brillante et bruyante », de commenter L’Évangéline le lendemain. « On y retrouve, écrit Pierre L’Hérault dans L’Évangéline du 6 mars 1973, les angoisses, les révoltes, les aspirations, les attentes et le rêve de toute une génération qui espère et prépare ‘la marche vers l’avenir […] des hommes nouveaux et libres’. Tiraillés comme lui entre l’angoisse et l’espoir, la violence et la tendresse, les gens de cette génération se reconnaîtront sans doute dans l’itinéraire suivi par Raymond LeBlanc. Voilà pourquoi le livre est important : il permettra à beaucoup de se voir et de se trouver beaux (pourquoi pas ?) ; et de s’aimer, de retrouver une fierté longtemps bafouée et de s’unir dans un projet d’invention collective. »
Jean-Guy Rens, avec qui LeBlanc publiera en 1977 l’anthologie militante Acadie/Expérience chez Parti pris, écrit dans La Presse du 17 mars 1973 : « C’est par Raymond LeBlanc que commence la littérature en Acadie. Sans vouloir retirer le moindre crédit aux recherches de ses aînés, Léonard Forest, Ronald Després, ou à la merveilleuse explosion verbale d’Antonine Maillet, il faut souligner que Raymond LeBlanc est le premier écrivain qui soit resté en Acadie ; sa situation adopte une dimension inattendue qui est celle de l’enracinement. Refusant l’avenir qu’aurait pu lui réserver le Québec, voire la France où il a complété ses études, il a décidé de rester à Moncton. Un choix pas ordinaire. […] Cri de terre surgit comme le signe tangible du rapatriement d’une poésie et quand d’autres textes nous viendront d’Acadie, nous saurons qui les a rendu possibles ». Acadie Rock de Guy Arsenault, en 1973, et Mourir à Scoudouc d’Herménégilde Chiasson, en 1974, tous deux publiés aux Éditions d’Acadie, viendront confirmer l’intuition de Rens.
Dans Cri de terre, Raymond Guy LeBlanc nomme la réalité acadienne. Sa poésie prend forme dans sa lutte avec l’Histoire, et elle s’inscrit ainsi dans la lignée des poètes québécois du pays. D’un poème à l’autre, il définit le manque, l’absence, la difficulté d’être qui culmine une première fois avec l’émouvant poème qui donne son titre au recueil, dans lequel sa révolte se transforme en espoir par la simple force de sa prise de parole. Dans la suite de poèmes qui clôt le recueil, il lance son « cri ». D’abord inventer l’avenir, développer un pays dont le lecteur soupçonne qu’il se lie au destin du Québec – du moins c’est ce qu’évoque le titre du poème « Projet de pays (Acadie – Québec) », le texte en lui-même étant plus nuancé –, puis exprimer sa quête dans « Petitcodiac », le poème le plus novateur du recueil, dans lequel les mots se heurtent à leur inadéquation à décrire la réalité, ce qui conduit le poète à en créer de nouveaux de manière à franchir la barrière de l’impuissance, et, enfin, s’affirmer dans « Je suis Acadien », affirmation à la fois tragique et porteuse d’une rupture, d’une volonté de dépasser tout ce qui empêche cette Acadie qu’il espère d’être : « Je suis Acadien / ce qui signifie / multiplié fourré dispersé acheté aliéné vendu révolté / homme déchiré vers l’avenir ». Jamais on n’avait défini avec autant de force, de violence, le choix fondamental qui s’offrait à ce peuple.
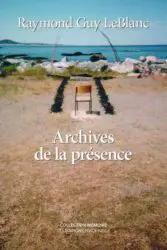 Le recueil atteindra les 4 000 exemplaires vendus dans sa première mouture et sera réédité sous d’autres formes à trois reprises : en 1992, en format de poche aux Éditions d’Acadie ; en 2005, dans Archives de la présence aux éditions Perce-Neige, qui comprend également des textes tirés de ses autres recueils et des inédits ; et enfin, en 2012, la très belle édition dans la collection Mémoire de Perce-Neige, dans laquelle on retrouve une riche iconographie en sus du texte.
Le recueil atteindra les 4 000 exemplaires vendus dans sa première mouture et sera réédité sous d’autres formes à trois reprises : en 1992, en format de poche aux Éditions d’Acadie ; en 2005, dans Archives de la présence aux éditions Perce-Neige, qui comprend également des textes tirés de ses autres recueils et des inédits ; et enfin, en 2012, la très belle édition dans la collection Mémoire de Perce-Neige, dans laquelle on retrouve une riche iconographie en sus du texte.
À l’occasion de la réédition de 1992, Jocelyne Felx écrit dans Lettres québécoises (été 1993) : « Le rôle déclencheur, exemplaire, emblématique du recueil de LeBlanc est comparable à L’homme rapaillé de Gaston Miron. Les vers de Miron : ‘je ne suis plus revenu pour revenir / je suis arrivé à ce qui commence’, Cri de terre les contient. LeBlanc et Miron ont été des initiateurs de la poésie contemporaine, le premier pour l’Acadie, le second pour le Québec, vingt ans plus tôt ».
Un long silence poétique suivra. Entre-temps, il écrit pour le théâtre, créant au Département d’art dramatique une pièce pour enfants, As-tu vu ma baloune ?, en 1974, animant la création collective de La Gang Asteur Tchissé qui mène icitte en 1976, et écrivant Fond de culottes, une pièce pour adolescentsque le théâtre l’Escaouette présente en 1981. Trois textes à portée sociale.
En 1981, il rencontre Lise Robichaud, qui sera l’amour de sa vie et avec qui il aura un garçon, Olivier. Ils passent un an à Montréal pour étudier. « Et c’est à ce moment-là que j’ai rencontré des bouddhistes zen, à Montréal […]. J’ai commencé à faire de la méditation. Cela m’a remis de nouveau sur une autre façon de m’affirmer, mais une façon d’affirmer aussi ce qu’il y a d’humain dans chacun de nous, ce qu’il y a d’universel dans chacun de nous. De dire, ben oui, on est des Acadiens. Oui, ça, c’est fait maintenant2. »
De sa relation avec Robichaud naît Chants d’amour et d’espoir, qui paraît en 1988. Le ton a changé : « Avant je criais aujourd’hui, je parle », avoue-t-il dans « Poème du mois de juillet 1982 », un long poème d’amour qui évoque son cheminement : « Ma vie était une taverne / et je n’avais plus le goût / de jouer du blues au piano », mais aujourd’hui « il n’y a pas de honte à aimer et à dire je t’aime ». La revendication identitaire et sociale cède la place à l’amour et à la recherche d’une spiritualité qui se fonde sur la méditation et le bouddhisme. La poésie se fait quotidienne.
La mer en feu. Poèmes 1964-1992 (1993) complète Cri de terre et apporte un nouveau regard sur Chants d’amour et d’espoir en présentant des poèmes qui avaient été exclus de ces recueils, dont plusieurs avaient été publiés en revue. Le recueil permet de saisir l’évolution de la pensée de LeBlanc, de la candeur de l’adolescence au regard attendri de la maturité, en passant par les poèmes militants de la vingtaine. Les derniers textes sont porteurs d’une paix intérieure qui s’exprime de façon presque naïve, alors que les premiers sont habités d’une colère suscitée par les multiples injustices qu’il dénonce, et qui font claquer les vers.
 Avec Empreintes (2011), LeBlanc nous invite à pénétrer dans son intimité en mettant l’accent sur la vie quotidienne. D’où des textes sur les petites choses, les petites manifestations de la vie, d’où aussi les poèmes minimalistes réunis sous le titre général de « Regards » ou encore les haïkus. Les poèmes sont dépouillés de tout ce qui pourrait être artifice et effet de style. LeBlanc recherche l’essentiel dans sa vie et il transcrit cette exigence dans ses textes. On sent la sagesse, le doux respect qu’il a de la vie, l’attention qu’il porte aux événements qui pourraient paraître insignifiants, mais qui pourtant donnent à la vie tout son sens.
Avec Empreintes (2011), LeBlanc nous invite à pénétrer dans son intimité en mettant l’accent sur la vie quotidienne. D’où des textes sur les petites choses, les petites manifestations de la vie, d’où aussi les poèmes minimalistes réunis sous le titre général de « Regards » ou encore les haïkus. Les poèmes sont dépouillés de tout ce qui pourrait être artifice et effet de style. LeBlanc recherche l’essentiel dans sa vie et il transcrit cette exigence dans ses textes. On sent la sagesse, le doux respect qu’il a de la vie, l’attention qu’il porte aux événements qui pourraient paraître insignifiants, mais qui pourtant donnent à la vie tout son sens.
Quelle que soit la qualité de ses autres écrits, Cri de terre demeure son œuvre phare : « Il y a un prix à payer pour être un poète fondateur. Je suis stock à Cri de terre, mais j’en ai écrit d’autres livres depuis, mais où sont les commentaires sur Chants d’amour et d’espoir et La mer en feu ? », précise-t-il à Sylvie Mousseau dans une entrevue qu’il lui accorde à l’occasion de la sortie d’Archives de la présence3.
Comme l’a souligné Benoit Doyon-Gosselin de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires, dans une entrevue à Radio-Canada à l’occasion du décès de LeBlanc, « [s]i Cri de terre a presque ‘fait de l’ombrage sur la suite de son œuvre’, c’est parce qu’il s’agit de ‘presque un recueil parfait4’ ».
Herménégilde Chiasson, qui avait signé l’illustration de la page couverture de Cri de terre, se souvient de l’impact de l’œuvre : « Moi ce qui m’avait frappé quand je l’ai lu pour la première fois c’est que les choses étaient nommées et qu’on savait vraiment que c’était à propos de l’Acadie, que c’était à propos d’ici. Avec un poème comme ‘Petitcodiac’, on sait que c’est une rivière qui coule à Moncton, il parle de Irving, de Pré-d’en-Haut, donc ç’a été une connexion très forte pour tous les gens même encore maintenant5 ».
1. Robert Viau, « Raymond Guy LeBlanc : Avant je criais aujourd’hui je parle », Études en littérature canadienne, vol. 25, no 2, automne 2000, p. 165.
2. Id., p. 170.
3. Sylvie Mousseau, « Un magicien des mots », L’Acadie Nouvelle, 18 février 2006, p. AA3.
4. ICI Radio-Canada – Nouveau-Brunswick (site Web), vendredi 29 octobre 2021.
5. Sylvie Mousseau, « Une figure marquante de la littérature acadienne s’éteint », L’Acadie Nouvelle, 30 octobre 2021, p. 13.
Né le 24 janvier 1945 à Saint-Anselme (maintenant Dieppe), Raymond Guy LeBlanc obtient un baccalauréat ès arts de l’Université de Moncton (1966), puis fait sa scolarité de maîtrise en philosophie (1966-1968). Durant l’année 1968-1969, il effectue une recherche en philosophie sur l’émotion esthétique chez Bergson à l’Université d’Aix-en-Provence, grâce à une bourse France-Acadie. En 1974, il soutient sa thèse de maîtrise qui traite de « La question nationale chez Karl Marx », dans laquelle il cherche à lier la démarche marxiste à la montée du nationalisme acadien. De 1984 à 1986 il fait sa scolarité de doctorat à l’Université de Moncton.
Musicien accompli, il participe à ou fonde divers groupes et accompagne comme pianiste différents chanteurs, dont la chanteuse de blues Theresa Malenfant. Il travaille tantôt dans le domaine social, tantôt culturel, tout en assumant à partir de 1974 des charges de cours en philosophie, en littérature et en création littéraire à l’Université de Moncton. Il a été durant plusieurs années agent de développement pour la Société des Acadiennes et Acadiens du Nouveau-Brunswick. Il meurt le 28 octobre 2021.
Bibliographie
Poésie
Cri de terre, 1969-1971, dessins d’Herménégilde Chiasson, D’Acadie, Moncton, 1972, 58 p.
Cri de terre, D’Acadie, Moncton, 1992, 91 p.
Cri de terre, édition du 40e anniversaire, Perce-Neige, Moncton, 2012, 102 p.
Chants d’amour et d’espoir, illustrations d’Herménégilde Chiasson, Michel Henry, Moncton, 1988, 63 p.
La mer en feu. Poèmes 1964-1992, Perce-Neige, Moncton/L’orange bleue, Amay (Belgique), 1993, 204 p.
Archives de la présence, Perce-Neige, Moncton, 2005, 87 p. Nouvelle édition de Cri de terre, choix de poèmes tirés de Chants d’amour et d’espoir et de La mer en feu, quelques inédits.
Empreintes, poésie, Perce-Neige, Moncton, 2011, 44 p.
Théâtre
As-tu vu ma baloune ?, théâtre, Département d’art dramatique, Université de Moncton, 1974.
Tchissé qui mène icitte ?, théâtre jeunesse, La Gang Asteur, 1976.
Fond de culottes, théâtre jeunesse, l’Escaouette, 1981.
Anthologie
Acadie/Expérience, choix de textes acadiens : complaintes, poèmes et chansons, avec Jean-Guy Rens, Parti pris, Montréal, 1977, 197 p.
EXTRAITS
J’habite un cri de terre aux racines de feu
Enfouies sous les rochers des solitudes
J’ai creusé lentement les varechs terribles
D’une amère saison de pluie
Comme au cœur du crabe la soif d’étreindre
Navire-fantôme je suis remonté à la surface des fleuves
Vers la plénitude des marées humaines
Et j’ai lancé la foule aux paroles d’avenir
Demain
Nous vivrons les secrètes planètes
D’une lente colère à la verticale sagesse des rêves
J’habite un cri de terre en amont des espérances
Larguées sur toutes les lèvres
Déjà mouillées aux soleils des chalutiers incandescents
Et toute parole abolit le dur mensonge
Des cavernes honteuses de notre silence
Cri de terre, p. 47.
***
La trace de la Cadie
Rétrécie
Élargie
Selon l’édit
Des puissants
L’Acadie effacée
Sur la carte du Nouveau-Brunswick
Le peuple est ailleurs
Sur son terrain
À bâtir sa demeure
De ses mains
Archives de la présence, p. 83.
***
Ça parle fort le dimanche matin Au Caraquette
En français sans gêne d’un ton assuré
Le ronronnement heureux d’une communauté fière
Qui n’a pas à s’excuser de parler sa langue
Empreintes, p. 17.
***
le soulèvement du vent avant l’orage
les fraises les tomates du jardin
la salade et le jus de canneberge
la lecture des textes bouddhistes
apprécier
le parfum de la clématite blanche
la symphonie des nuances d’automne
le rosé des cosmos
la texture des feuilles d’érable
apprécier
Empreintes, p. 36.











