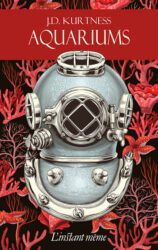Son premier roman, De vengeance (2017), racontait avec un humour grinçant la vie d’une traductrice qui prenait plaisir à punir ou même à tuer ceux qui, selon elle, le méritaient. Dans ce deuxième roman, l’autrice née à Chicoutimi imagine cette fois la fin du monde provoquée par une mutation du virus de la rage.
Émeraude Pic est une biologiste québécoise spécialisée dans les écosystèmes marins complexes. Elle s’est fait remarquer en reproduisant un récif corallien à son domicile. D’abord à l’emploi de l’aquarium du Parc nature de Saint-Félicien, elle participe ensuite à une mission scientifique internationale au cœur de l’Arctique. Au même moment, une pandémie de « rhabdovirus » éradique 99,999 % de la population mondiale. Les circonstances entourant cette catastrophe planétaire auraient pu susciter un récit détaillé. Kurtness n’en fait pourtant qu’un motif secondaire, un point de chute, multipliant les séquences et les arcs narratifs pendant huit chapitres. Elle se concentre ainsi sur divers aspects de l’histoire familiale de la narratrice : son enfance auprès d’un père endeuillé et souvent absent (il était représentant pour une compagnie de produits chimiques), les étés passés chez sa tante et ses cousins, les années de pensionnat, son amitié avec un garçon atteint de xérodermie pigmentaire (une maladie caractérisée par une extrême sensibilité au soleil et aux rayons UV). On trouve même un passage consacré à Onésime Pic, le grand-père de la narratrice. D’autres portions du récit ne la concernent même pas directement, puisqu’il y est question d’un combat épique entre un cachalot et un calmar géant, de la mort d’une baleine bicentenaire, de la préservation sur plusieurs siècles du cadavre d’un homme tatoué ou d’une mission sur Mars, ironiquement appelée « Fusée Caca », puisque les déjections des astronautes y sont transformées en engrais et en carburant. Bref, s’il n’a pas tout à fait le même mordant que De vengeance, ce deuxième roman de J.D. Kurtness plaira tout autant grâce à sa construction narrative originale et à son regard quasi vernien sur la science, notamment l’océanographie.