Du roman noir (De vengeance) au récit d’anticipation (Aquariums), J.D. Kurtness promène un œil acéré sur le monde. Nous l’avons rencontrée à Moncton dans le cadre de l’édition 2022 du Festival Frye1.
Patrick Bergeron : On a dit de vous que vous écriviez des « romans glauques2 ». Êtes-vous d’accord avec cette façon de présenter vos livres ?
J.D. Kurtness : C’est un peu réducteur. Oui, il y a des aspects glauques, mais ce n’est pas juste cela. J’essaie de mélanger le glauque avec l’humour, de trouver la beauté même dans le glauque. Il y a une certaine lumière qui traverse ce que je fais.
P. B.: Votre premier roman, De vengeance, a paru à L’instant même en 2017. La narratrice raconte avoir accidentellement provoqué la mort de Dave Fiset, un élève de sa classe de sixième année, quand elle avait douze ans. Elle décrit cet événement comme son « initiation au crime parfait ». Devenue adulte, elle s’adonne au meurtre, mais de façon sélective, ne tuant que ceux qui le méritent. D’où vous est venue l’idée de cette histoire ?
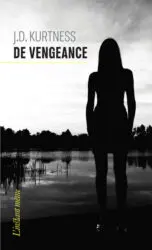 J.D. K. : C’est l’idée que commettre un crime, c’est vraiment beaucoup de travail. Je pense que beaucoup de gens ont le fantasme de tuer quelqu’un qu’ils n’aiment pas ou qui leur a fait quelque chose. On imagine se venger, mais on ne passe pas à l’acte, parce qu’on est conscient de toutes les conséquences. Et puis quand même, un meurtre, c’est difficile ! Il faut vraiment être en forme pour tuer quelqu’un. J’ai l’air complètement folle en disant ça, mais je me suis demandé : Qui est assez fou pour passer à l’acte ? Qu’est-ce qui fait que, dans la tête des gens, il y a un déclic qui se fait et qu’on se dit que cela vaut vraiment la peine de mettre de l’énergie pour éliminer une vie ? Pas seulement l’énergie physique, mais l’énergie mentale aussi parce que, à moins d’être extrêmement froid, tuer quelqu’un, c’est aussi se faire du mal à soi, c’est être à l’origine de la souffrance ou du mal. Ça doit forcément laisser des traces sur quelqu’un. Je voulais donc explorer ce qui pousse quelqu’un à faire ça. En même temps, mon roman est un peu un manuel de vengeance. Je me suis mise à penser au crime parfait parce que non seulement il est prémédité, mais il faut aussi que la personne ne se fasse pas prendre.
J.D. K. : C’est l’idée que commettre un crime, c’est vraiment beaucoup de travail. Je pense que beaucoup de gens ont le fantasme de tuer quelqu’un qu’ils n’aiment pas ou qui leur a fait quelque chose. On imagine se venger, mais on ne passe pas à l’acte, parce qu’on est conscient de toutes les conséquences. Et puis quand même, un meurtre, c’est difficile ! Il faut vraiment être en forme pour tuer quelqu’un. J’ai l’air complètement folle en disant ça, mais je me suis demandé : Qui est assez fou pour passer à l’acte ? Qu’est-ce qui fait que, dans la tête des gens, il y a un déclic qui se fait et qu’on se dit que cela vaut vraiment la peine de mettre de l’énergie pour éliminer une vie ? Pas seulement l’énergie physique, mais l’énergie mentale aussi parce que, à moins d’être extrêmement froid, tuer quelqu’un, c’est aussi se faire du mal à soi, c’est être à l’origine de la souffrance ou du mal. Ça doit forcément laisser des traces sur quelqu’un. Je voulais donc explorer ce qui pousse quelqu’un à faire ça. En même temps, mon roman est un peu un manuel de vengeance. Je me suis mise à penser au crime parfait parce que non seulement il est prémédité, mais il faut aussi que la personne ne se fasse pas prendre.
P. B.: Vous abordez le thème de la vengeance de deux façons. Il y a d’une part des vengeances malignes, celles dont nous venons de parler, les exécutions sélectives, et il y a d’autre part des vengeances bénignes, celles qui sont tournées contre les irritants du quotidien. Par exemple, votre narratrice se venge d’un chauffard en remplissant ses tuyaux d’échappement de mousse isolante. À un homme qui ne ramasse pas les déjections de son chien, elle envoie les crottes soigneusement emballées dans du papier rose. C’est une forme de défoulement, non ?
J.D. K. : Oui, c’est sûr. Je me suis dit que cela ferait du bien de lire une histoire où quelqu’un pourrait se venger pour nous. C’est drôle parce que tout le monde me parle de l’affaire du chien alors que je voulais l’enlever. Il faut croire que j’ai bien fait de la laisser.
P. B.: Il y a beaucoup d’humour dans ce que vous écrivez. Qu’est-ce qui vous fait rire dans la vie ?
J.D. K. : Beaucoup de choses me font rire. Je suis vraiment une rigoleuse. Des fois, je ris toute seule. Quand je fais une bonne blague, je trouve souvent le moyen de la mettre dans ce que j’écris. L’humour est important, car sans lui, on serait toujours en train de pleurer. Je suis vraiment une cynique avec des accents de misanthrope, donc le rire est la façon que j’ai trouvée pour dédramatiser les choses. On voit bien, surtout avec les médias, qu’on est constamment exposé aux pires atrocités dans le monde en temps réel, donc si on n’a pas le rire, il ne nous reste pas grand-chose à part se rouler en boule dans un coin et attendre la mort. L’humour fait du bien. Je pense que l’humour est profondément humain, qu’il nous rappelle notre humanité. Le temps où l’on peut rire de quelque chose, cela veut dire que cette chose ne nous domine pas. On peut prendre du recul et en faire des blagues. C’est comme les gens qui sont torturés à mort et qui chantent pendant qu’ils se font brûler.
P. B.: Votre narratrice observe qu’elle n’a pas le physique de l’emploi, parce qu’elle a des traits inoffensifs : « J’ai l’air d’une infirmière, d’une libraire, d’une joueuse de soccer. Mon visage est mon meilleur alibi3». En tant que tueuse, il lui faudrait « une allure de femme dangereuse et mystérieuse4 ». Trouvez-vous souvent que les gens n’ont pas le physique de l’emploi ? Les individus à tête de chérubin vous inquiètent-ils davantage que ceux qui ont l’air de gangsters au visage tatoué, pour reprendre l’une de vos images ?
J.D. K. : Les gens ne m’inquiètent pas en général, ça va. Mais dans la fiction, surtout dans les films, on sait tout de suite qui va se faire tuer. Ce sont toujours les gens un peu laids, les fumeurs, alors que les gens beaux, les gens qui réussissent, sont les bons. J’essaie de mélanger ça pour défaire le stéréotype du physique de l’emploi. Je pense que ça fait très XIXe siècle de penser que le physique a un lien avec le fait qu’une personne est bonne ou mauvaise. Je voulais qu’on puisse soupçonner à peu près n’importe qui. Mon personnage n’est jamais nommé. Je voulais que les gens regardent un peu plus derrière leurs épaules, qu’ils se demandent s’il y a vraiment un tueur ou une tueuse parmi nous. D’un point de vue plus personnel, je sais que j’ai l’air inoffensive : je suis toute petite, j’ai les traits ronds. Quand je sors, les gens m’arrêtent pour me demander l’heure ou une indication. Je trouve ça drôle que les gens n’aient pas peur de moi. Non pas que je sois particulièrement dangereuse, mais je pense à beaucoup de choses tordues. Je trouve ça drôle que les gens ne se doutent pas de ça.
P. B.: Vous faites d’ailleurs dire à votre narratrice : « Je n’ai plus peur du danger. Je suis le danger5». On croirait entendre Walter White, le protagoniste de la série télévisée Breaking Bad : Le chimiste, qui tenait les mêmes propos. Est-ce voulu ?
J.D. K. : C’est voulu, oui, c’est un clin d’œil direct à la scène où il dit à sa femme Skyler qu’elle n’a pas besoin d’avoir peur pour lui parce que c’est lui le danger.
P. B. : Voilà un autre personnage qui n’a pas la tête de l’emploi : Walter White est un professeur de chimie au secondaire qui se met à fabriquer et vendre du crystal meth(de la méthamphétamine en cristaux) d’une extrême pureté…
J.D. K. : En plus, il est cancéreux. C’est une excellente série. Il y a plein de références à Breaking Bad dans mon livre.
P. B.: Votre deuxième roman, Aquariums, a paru en 2019 à L’instant même. Il s’agit cette fois d’un récit d’anticipation dans lequel l’humanité est victime d’une épidémie sans précédent. C’était un an avant que la pandémie de COVID-19 ne soit déclarée. Plutôt prémonitoire, non ?
J.D. K. : Je fais tout le temps la blague que je vais maintenant écrire sur la paix dans le monde, espérant qu’elle advienne… Pour ce roman, j’avais besoin d’une trame de fond catastrophique plausible. Je me suis dit : « Pourquoi pas une épidémie ? » Parce que parmi toutes les catastrophes qui pourraient arriver, c’est quelque chose d’assez plausible. Mais je suis un peu déçue que ce soit arrivé si vite après que mon roman a été publié. Les gens, qui étaient en pandémie, n’avaient pas envie de lire là-dessus. Je pense que ça a nui au roman même si la pandémie n’est qu’une trame de fond, j’en parle vaguement. Le propos n’est pas là. Ce n’est pas un roman de survivalisme après l’apocalypse.
P. B.: Non, en effet. D’ailleurs, par rapport à De vengeance, votre deuxième roman a une forme plus complexe : narration mixte, focalisation multiple, assemblage de séquences temporelles. Olivier Boisvert a parlé à cet égard de « fiction poulpeuse », c’est-à-dire « une architecture ressemblant à celle du poulpe, au sein de laquelle ‘chaque bras forme un système nerveux autonome6’ ». Quelle portion de vos efforts de romancière consacrez-vous à l’élaboration du dispositif narratif ?
J.D. K. : C’est difficile de répondre à cette question parce que ce n’est pas si pensé que ça. C’est un roman que j’ai construit morceau par morceau. À la fin, ça prend un sens ; je faisais des liens d’écriture auxquels je n’avais même pas songé. Ça s’est donc placé tout seul. C’est clair que ça fait partie de mon style, si on veut, d’écrire par vignettes. J’aime vraiment me pencher sur un personnage, sur un moment intéressant de sa vie, mais je n’ai pas envie d’écrire toute la vie d’un même personnage parce que je trouve qu’il y aurait des temps morts. Nos vies, c’est juste un long temps mort. Je ne veux pas décevoir personne en disant ça. Donc, j’essaie d’écrire sur les brefs moments importants dans la vie des gens, qui peuvent sembler des moments anodins, mais qui, avec la trame, la toile narrative que j’utilise, deviennent importants ou significatifs par rapport au reste. Je n’ai pas de système de fiches avec des cartes, des punaises et des fils de laine… Ça ressemble plus à un petit fichier où il y a huit points. C’est ça mon roman, je pars de ça.
P. B.: Le mot que vous avez utilisé, « vignette », traduit bien l’esprit de composition du livre. Aquariums est l’histoire d’une épidémie issue d’une mutation du virus de la rage, une apocalypse causée par le Canada…
J.D. K. : Oui, à cause des ratons laveurs du Canada. On les a trop nourris sur le mont Royal !
P. B.: Une épidémie fatale pour 99,999 % de la population, mais qui est presque un motif secondaire. Il faut lire votre roman jusqu’à la fin, parce que tous les arcs narratifs que vous tendez se rejoignent au dernier chapitre. Auparavant, on a un assemblage de vignettes. Par exemple celle qui concerne le personnage d’Henri, un garçon qui souffre d’une grave intolérance au soleil, la xérodermie pigmentaire. Quand la narratrice fait sa connaissance, il a quatorze ans comme elle et doit revêtir une tenue de scaphandrier chaque fois qu’il veut sortir. On le retrouve plus tard à l’emploi de la NASA, où il collabore à la première mission sur Mars. Il vit dans un bunker. En fait, il est peut-être le seul être humain qui était vraiment prêt pour une épidémie de fin du monde.
J.D. K. : Pour lui, la fin du monde, c’est depuis toujours. Il est né et c’était déjà la fin du monde. J’avais vu un documentaire à Télé-Québec sur un enfant atteint de xérodermie pigmentaire. Ça m’avait marquée. J’ai pensé aux plaisirs simples de la vie qu’on a, comme se coucher dans des draps propres qui ont séché sur la corde, ou sortir au printemps, enlever son manteau pour la première fois et avoir le soleil sur la nuque ou les bras. Je me suis dit : « Cet enfant-là, il ne pourra jamais vivre ça ». En même temps, c’est un vrai héros. Ce sont des gens comme lui qui nous sauvent les fesses. Durant la pandémie, ce sont les geeks qui ont trouvé un vaccin, puis qui nous ont dit quoi faire. C’est la même chose. C’est grâce à ces gens-là que les avancées scientifiques se font, au prix de sacrifices énormes. Donc, Henri est un personnage que je trouve intéressant. Alors que tout le monde s’agite, essaie d’aller plus loin, plus haut, d’être plus tough, lui, il n’a pas d’autre choix que de s’isoler avec ses livres, ses ordinateurs et son intelligence. C’était le contraste que je voulais faire.
P. B. : Aquariums est un roman construit par vignettes, mais qui comporte une protagoniste : Émeraude Pic, biologiste québécoise spécialisée dans les écosystèmes marins complexes. Elle s’est distinguée en reproduisant le récif de corail du Bélize dans son salon et elle a l’ambition de sauver autant d’espèces aquatiques exotiques que possible. On l’invite à participer à une mission océanographique internationale dans l’Arctique. Il est d’ailleurs largement question d’océanographie dans votre livre, mais de façon vulgarisée. Avez-vous reçu une formation scientifique ?
 J.D. K. : J’ai fait deux ans en sciences de la nature au cégep, puis un an en microbiologie-immunologie à l’université, avant de bifurquer vers la littérature. Je n’ai jamais perdu mon intérêt pour les sciences. Quand il y a une émission scientifique à la télé, je vais la regarder. J’ai énormément de curiosité par rapport à comment les choses fonctionnent. La vie, pour moi, c’est presque de la magie. Que ce soit dans les grandes profondeurs ou dans les volcans, il y a toujours de quoi qui vit, qui fonctionne, qui réussit à se reproduire. Je trouve ça vraiment impressionnant. On n’a même pas besoin d’écrire un roman fantastique ou un roman dans lequel il y a de la magie parce que la science elle-même est magique. C’est par cette espèce d’émerveillement que je ressemble au personnage.
J.D. K. : J’ai fait deux ans en sciences de la nature au cégep, puis un an en microbiologie-immunologie à l’université, avant de bifurquer vers la littérature. Je n’ai jamais perdu mon intérêt pour les sciences. Quand il y a une émission scientifique à la télé, je vais la regarder. J’ai énormément de curiosité par rapport à comment les choses fonctionnent. La vie, pour moi, c’est presque de la magie. Que ce soit dans les grandes profondeurs ou dans les volcans, il y a toujours de quoi qui vit, qui fonctionne, qui réussit à se reproduire. Je trouve ça vraiment impressionnant. On n’a même pas besoin d’écrire un roman fantastique ou un roman dans lequel il y a de la magie parce que la science elle-même est magique. C’est par cette espèce d’émerveillement que je ressemble au personnage.
P. B.: La science comme voyage extraordinaire, comme émerveillement devant ce que la nature offre en matière de diversité. Vous faites un peu comme Jules Verne, mais un siècle et demi plus tard…
J.D. K. : C’est une grosse comparaison, mais oui.
P. B.: Notre connaissance des fonds marins n’a pas progressé tant que ça depuis l’époque de Verne. Il reste une énorme partie des profondeurs marines dont nous ne savons toujours rien.
J.D. K. : On connaît mieux la face de Mars que les fonds marins !
P. B.: Nous avons parlé de la nocivité du « rhabdovirus » que vous avez imaginé. Il y a quand même des survivants à votre apocalypse. La narratrice en fait partie. Elle se dit, en rentrant chez elle, qu’elle va s’inscrire à un site de rencontres. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous surviviez à la fin du monde ?
J.D. K. : Je me suis toujours dit que je ne survivrais pas à l’apocalypse ! Je serais dans les statistiques de mort parce que j’aime mon confort, je n’ai pas envie de manquer d’eau chaude. On est tellement bien chez soi avec un verre de vin ! Donc, je ne me pose pas la question. Je ne suis pas du genre à ramasser du cannage, à me creuser un bunker en cas de guerre nucléaire. Je serais plus du genre à aller me mettre sur la montagne, en disant : « Enlevez-moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là ». C’est peut-être parce que je n’ai pas d’enfant. Je ne ressens pas le besoin de survivre à tout prix et de sauver mes gènes.
P. B.: Nous avons parlé de vos deux romans, mais vous êtes aussi nouvellière. C’est d’ailleurs par des nouvelles que vous avez fait vos débuts d’autrice en 20057. Récemment, vous avez fait partie des quatorze auteurs autochtones réunis par Michel Jean pour le recueil de nouvelles d’anticipation Wapke(terme qui signifie « demain » en langue atikamekw). Votre nouvelle s’intitule « Les saucisses ». Vous y décrivez un avenir où des millions d’êtres humains vivent branchés à des électrodes, le corps trempé dans un lubrifiant antibiotique. Tout ce qui compose leur existence a été relégué à une réalité virtuelle. Les milliers d’humains qui restent sont à leur service. C’est le cas avec la narratrice, qui travaille pour une compagnie de ramassage de cadavres (qu’elle appelle « les saucisses »). On reconnaît bien votre regard acéré et cynique. Trouvez-vous, finalement, que nous sommes engagés dans un processus de déshumanisation ?
J.D. K. : C’est difficile à dire, j’espère me tromper, mais je n’ai pas beaucoup d’attentes envers l’humanité. J’ai l’impression qu’on fuit de plus en plus notre réalité. On veut se projeter dans un ailleurs, on veut de plus en plus être dans la réalité virtuelle des jeux vidéo, la réalité augmentée ou le métavers – on peut nommer ça comme on veut – pour fuir une vie qui ne nous comble plus. Quand tu préfères jouer à un jeu vidéo plutôt qu’aller prendre une marche, c’est qu’il y a un problème. Je ne sais pas quelle est la solution, mais je ne suis pas très optimiste. En même temps, l’humain a toujours le don de nous surprendre, donc peut-être que la catastrophe ne viendra pas ou que le monde sera tellement transformé qu’on ne peut même pas imaginer ce qu’il va être dans quarante ou même dans vingt ans.
P. B.: Est-ce que « Les saucisses » est un texte de commande ?
J.D. K. : Oui, c’est une commande. Michel Jean m’a demandé une dystopie – c’est le mot qu’il a utilisé. J’ai appris par après que les autres avaient plus reçu la consigne de l’anticipation, du futurisme, alors c’est pour ça que ma nouvelle est vraiment glauque, parce que j’ai respecté la consigne d’écrire quelque chose de dystopique.
P. B.: Wapke est un recueil autochtone. Votre père est un Ilnu de Mashteuiatsh. Vous avez gagné le prix Voix autochtones avec De vengeance. À quel point l’autochtonie est-elle constitutive de votre caractère, de votre identité ?
J.D. K. : J’utilise souvent la métaphore du smoothie identitaire. Côté paternel : on est autochtone ; côté maternel, on est Québécois de souche (je ne sais pas si on peut encore dire ça). C’est vraiment mélangé tout ça. Ce n’est pas comme le yin et le yang où il y a vraiment une séparation entre les deux, un côté noir et un côté blanc. Ce n’est pas ça du tout, c’est vraiment plus mélangé, ça fait partie de moi. Je ne m’assois pas devant mon ordinateur en me disant : « Moi, Ilnue, que vais-je écrire aujourd’hui ? » Ça ne fonctionne pas comme ça. C’est plus avoir des sensibilités qui sont différentes, une manière de réfléchir ou de concevoir le monde peut-être plus circulaire ; avoir plus de facilité à voir que les choses sont toutes liées entre elles. Je ne dis pas que c’est une prérogative autochtone. J’ai une sensibilité environnementale, mais ce n’est pas nécessairement parce que je suis autochtone : il y a plein d’autochtones qui ne l’ont pas et plein de non-autochtones qu’ils l’ont. J’ai vraiment de la difficulté à établir ce qui vient de mes racines autochtones et ce qui vient de ma sensibilité personnelle ou de mes racines québécoises.
P. B.: Vous avez écrit des nouvelles et des romans. Vous verriez-vous écrire autre chose que de la fiction ?
J.D. K. : Non. Je me perçois vraiment comme une romancière avant tout. Je suis quelqu’un qui raconte des histoires. La prose, c’est vraiment mon outil, donc je ne me vois pas bifurquer vers un autre médium. Peut-être qu’un jour j’écrirai un essai, mais je ne sais pas. Peut-être aussi que je vais arrêter d’écrire. Je suis quelqu’un qui se tanne de certaines choses. Quand je suis passionnée par quelque chose, je vais faire ça pendant un certain temps, puis je vais laisser tomber et peut-être y revenir dix ans plus tard. Je n’aime pas me restreindre à un seul champ de compétence.
J.D. Kurtness a publié :
Romans
De vengeance, L’instant même, Longueuil, 2017, 136 p. ; 19,95 $.
Aquariums, L’instant même, Longueuil, 2019, 162 p. ; 21,95 $.
Bienvenue, Alyson, « Solstice », Hannenorak, Wendake, 2022, 36 p. ; 7,95 $.
Nouvelles
« Mashteuiatsh, P.Q. », Moebius, no 104, hiver 2005, p. 83-92.
« Le stylo », Moebius, no 109, printemps 2006, p. 67-72.
« Le travailleur social », Lettres québécoises, no 179, hiver 2020, p. 32-34.
« La sphère », Le Sabord, no 116, novembre 2020, p. 14-17.
« Acheter la paix », XYZ. La revue de la nouvelle, no 147, automne 2021, p. 33-37.
« Les saucisses » dans Michel Jean (sous la dir. de), Wapke, Stanké, Montréal, 2021, p. 141-156.
1. Cet article reproduit des extraits d’un entretien de 90 minutes qui s’est déroulé le 27 avril 2022 dans le cadre du festival littéraire international Frye avec l’appui du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Transcription : Samantha Rousset.
2. Marie-France Bornais, « Des voix autochtones se projettent dans le futur », Le Journal de Québec, 25 avril 2021, https://www.journaldequebec.com/2021/04/25/des-voix-autochtones-se-projettent-dans-le-futur.
3. J.D. Kurtness, De vengeance, L’instant même, Longueuil, 2017, p. 11.
4. Ibid., p. 10.
5. Ibid., p. 90.
6. Olivier Boisvert, « Poulpe fiction », Lettres québécoises, no 176, hiver 2019, p. 49.
7. Dans la version complète de l’entretien, la discussion se tournait ici vers chacune des nouvelles de J.D. Kurtness.











