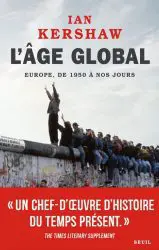« Des blessures physiques et morales durables de la guerre la plus horrible de tous les temps émergeait la possibilité d’une Europe stable et prospère. » Ainsi se terminait L’Europe en enfer – 1914-1949 (Seuil, 2015), le premier tome de l’immense fresque sur l’Europe du XXe siècle, proposée par le grand historien anglais Ian Kershaw. Le titre original du second tome, paru en anglais en 2018, Roller-Coaster : Europe, 1950-2017, dit assez bien que la seconde moitié du XXesiècle européen fut tout sauf stable. Rappelons quelques-uns des grands soubresauts qui l’ont secouée.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe devient le territoire d’un affrontement larvé entre les deux puissances qu’étaient les États-Unis et l’Union soviétique. C’est ce que l’on a appelé la guerre froide, nourrie par l’angoisse nucléaire, et qui allait se poursuivre avec ses points chauds (le blocus de Berlin, la crise des missiles de Cuba, le déploiement d’armes nucléaires par l’OTAN) et ses périodes de détente, jusqu’à la chute du rideau de fer en 1989.Alors même qu’ils vivaient sous tension, les pays européens, en particulier ceux de l’Ouest, connaissaient une période de prospérité économique inédite par son ampleur et sa durée. Ce furent les « Trente Glorieuses ». Celles-ci prirent fin lors du premier choc pétrolier en 1973, quand les pays producteurs de pétrole décidèrent de rationner l’Occident après la guerre des Six Jours entre Israël et les pays arabes. Les habitants des pays de l’Est profitèrent moins que leurs voisins de l’Ouest de cet essor, car la politique économique des états communistes était de développer l’industrie lourde plutôt que de fabriquer des produits de consommation.Au cours des années 1950 et surtout 1960, les mœurs et les valeurs sociales qui avaient prévalu jusque-là furent partout remises en question, ce qui provoqua, par effet d’entraînement, des demandes de changements politiques. Du côté de l’Est, la contestation a commencé tôt avec la révolte hongroise de 1956 – écrasée par les chars soviétiques –, puis s’est poursuivie sous forme larvée en Pologne, avant d’éclater à nouveau en Tchécoslovaquie en 1968. Du côté de l’Ouest, Mai 68 en France en fut le symbole, même si cette contestation n’apporta pas de grands changements directs et immédiats. Dans la décennie qui suivit, la contestation prit un tour plus violent en Italie avec les Brigades rouges, comme ce fut le cas en République fédérale allemande avec la bande à Baader.Les années 1980, une décennie charnièreGorbatchev fut le grand homme des années 1980, nous dit Kershaw. C’est lui qui, voulant renouveler le communisme, mit en place les mécanismes (glasnost, perestroïka) qui conduisirent paradoxalement à son effondrement en 1989, libérant les vieux nationalismes qui couvaient sous l’autoritarisme des régimes communistes. Ainsi en fut-il dans les Balkans où se déclara une guerre ethnique dont certains épisodes rappelèrent les pires horreurs de la Deuxième Guerre mondiale.La chute du communisme supposait une reconversion des économies nationales. Le passage d’une économie planifiée vers le libéralisme économique ne se fit pas avec le même bonheur partout. Si des pays comme la RDA (du fait de la réunification des deux Allemagne), la Pologne ou la Hongrie s’en tirèrent plutôt bien, ce ne fut pas le cas partout. En Russie, par exemple, ce changement eut pour effet de mettre entre les mains d’une petite oligarchie – souvent liée à l’ancien régime – tous les leviers de l’État. Encore aujourd’hui, les écarts de richesse demeurent très grands entre certains pays de l’Est et la plupart des pays d’Europe de l’Ouest.Bien sûr, l’Europe avait connu depuis des décennies des attentats terroristes sur son territoire, attentats souvent menés par des organisations sécessionnistes comme l’IRA en Irlande du Nord ou l’ETA au Pays basque. Rien ne la préparait pourtant à l’irruption du terrorisme islamiste, qui connut son apothéose avec l’attaque des tours jumelles du World Trade Center en 2001 et allait devenir une constante du paysage sociopolitique. La plupart des capitales européennes, du moins celles d’Europe occidentale, connurent leur lot d’attentats. À bien des égards, cette insécurité allait s’aggraver avec l’arrivée massive de migrants en territoire européen en 2014 et en 2015, renforçant ainsi la montée de la xénophobie et des extrêmes droites un peu partout sur le territoire.Sur le plan financier, la crise de 2008, qui a secoué toutes les économies occidentales, a mis au jour la fragilité de la zone euro, faute d’une intégration suffisante sur les plans tant politique qu’économique. Cette crise a également fait ressortir les dysfonctionnements de l’Union européenne et de ses institutions. Le Brexit et les tiraillements que connaît l’Union européenne avec la Pologne ou la Hongrie, qui souhaitent s’affranchir de certaines règles communes aux pays membres, en sont l’illustration la plus convaincante.Ian Kershaw ne s’en cache pas, il est inquiet pour l’avenir de l’Europe telle qu’il la souhaite. Les piliers qu’ont été l’OTAN et l’Union européenne pour son émergence ne semblent plus en mesure d’en assurer la cohésion. Dans un long épilogue, Kershaw décortique les résultats des élections du Parlement européen de 2019. Il s’y réjouit prudemment que le raz-de-marée anticipé des mouvements de droite ne se soit pas concrétisé, même si de profondes divisions persistent.Kershaw écrit dans sa préface que cet ouvrage a été particulièrement difficile à mener à terme. On le croit sans peine. En effet, comment embrasser d’un seul regard autant de réalités différentes, sous autant d’angles (économique, politique, social, culturel, etc.) ? À l’ampleur du sujet, il faut ajouter l’absence de recul de l’historien sur les événements qui ont marqué sa propre existence. En dépit de ces embûches, Ian Kershaw a fait de son entreprise une réussite magistrale. Fouillé, détaillé, exhaustif et toujours limpide, L’Âge global. Europe, de 1950 à nos jours est un incontournable pour tout amateur d’histoire.