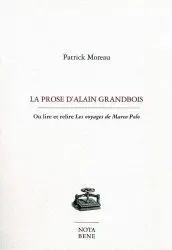Le professeur de littérature Patrick Moreau s’est résolument donné pour mission de faire reconnaître la valeur d’une œuvre qu’il juge comme particulièrement sous-estimée et méconnue, soit Les voyages de Marco Polo, publiée par Alain Grandbois en 1941. À cette fin, il a déjà fait paraître un premier ouvrage en 2012 intitulé Alain Grandbois est-il un écrivain québécois ?, dans lequel il étrille une institution littéraire qui tend à laisser dans l’ombre plusieurs œuvres du passé au nom d’une certaine forme de présentisme et de téléologie moderniste et nationaliste. Si on pouvait reprocher à ce premier essai de Patrick Moreau de parler des Voyages de Marco Polo sans en parler, de déplorer une non-lecture sans en proposer une, il en va tout autrement de sa plus récente étude sur la prose grandboisienne. En effet, l’essayiste entre cette fois pleinement dans l’œuvre pour se livrer à une analyse textuelle destinée à en révéler entre autres « les indéniables beautés », la paradoxale modernité et la grande originalité.
Moreau rappelle d’abord le statut particulier de cet hapax littéraire que constitue la réécriture par Grandbois du Livre des merveilles : « […] il est tout bonnement inclassable. Ou du moins, il n’entre pas dans un genre clairement défini ». L’hybridité qui caractérise le texte de Grandbois aurait considérablement contribué au « déficit de notoriété » dont il aurait hérité :« Il demeure dans la tradition littéraire québécoise comme une anomalie ». Moreau tente ensuite de transformer cette anomalie en originalité : « […]une telle confusion des genres est aussi ce qui serait susceptible de constituer une partie de son attrait aux yeux du lecteur d’aujourd’hui ». Outre son hybridité, poursuit Moreau, l’œuvre de Grandbois aurait plus d’un mérite pour un lectorat actuel. Impartiale, pluraliste, à contre-courant du racisme de l’époque, elle propose un regard décentré, une philosophie de l’altérité particulièrement avant-gardiste. Forme narrative, procédés stylistiques et sens du récit s’y conjoignent de façon à composer « un hymne jubilatoire à la diversité du monde ». L’imposante et significative dimension intertextuelle de l’œuvre, « qui n’est pas sans originalité pour l’époque », témoigne d’« une pratique scripturaire moderne ». À la limite, cet « inclassable » peut même se lire tantôt comme « une sorte de transposition romanesque », tantôt comme « un long poème hymnique dédié à cette infinie variété du monde ». Bref, il ne fait aucun doute que Moreau réussit à « lire autrement » l’œuvre de Grandbois, et a fortiori à faire valoir l’intérêt de la lire et de la relire. Cela dit, on pourrait reprocher à l’auteur de faire ce qu’il reproche lui-même à l’institution littéraire, c’est-à-dire d’orienter la lecture en fonction d’une certaine forme de « présentisme », de projeter sur l’œuvre des valeurs actuelles. On s’étonne en outre que ne soit pas davantage pris en considération le point de vue de Grandbois, qui présente son ouvrage dans sa préface comme un « simple récit des voyages du Vénitien ». Sous cet angle, apparaîtraient sans doute moins inusités une dimension hybride et densément intertextuelle ou encore un axe spatial et temporel structurant, que les spécialistes considèrent généralement comme des traits génériques séculaires de la pratique du récit de voyage. Du prix David obtenu à sa publication jusqu’à sa réédition critique dans la prestigieuse collection de la « Bibliothèque du Nouveau Monde » en 2001, Les voyages de Marco Polo n’est certainement pas, malgré sa qualité littéraire indéniable, l’œuvre québécoise la plus injustement traitée par l’institution littéraire. Et si elle l’a été, on peut se demander si ce n’est pas justement parce qu’elle s’apparente à un récit de voyage, un genre mineur qui n’obtient généralement que très peu de mentions dans les palmarès historiques de grandes œuvres et de grands auteurs. Il s’agit là toutefois d’une autre hypothèse. Pour lors, retenons que l’étude de Moreau illustre bien à quel point la signification d’une œuvre peut être renouvelée et actualisée selon la façon dont ses virtualités sont activées par le lecteur. Et terminons en saluant cette initiative ! On ne saurait trop en effet encourager ce genre de relecture d’une production littéraire du passé, quitte à en faire, pour la sortir de l’ombre, « une œuvre qui s’accorde si bien finalement avec notre temps ».