La disparition récente de Jacques Parizeau rend opportune la réédition de la biographie que lui consacrait Pierre Duchesne au début de la précédente décennie. Non seulement elle n’a pas vieilli, mais ses lignes de force semblent encore plus justes à mesure que passe le temps.
Deux traits caractérisent Jacques Parizeau : d’une part, l’ingénieuse diversité des gestes ; d’autre part, l’absolue domination de la conviction maîtresse. L’homme agira sur plusieurs fronts ; jamais ne variera son souci. Cette cohérence unifie les trois sous-titres : Le croisé1, Le baron2, Le régent3, autant de rôles assumés pour LA cause.
La formation

En soudant Jacques Parizeau à sa lignée familiale, Duchesne révèle les assises de l’homme. Il est le maillon d’une chaîne. Sans mépris pour le peuple dont elle provient, sa famille protégera le jeune homme des insuffisances du Québec de l’époque : ni religiosité ni aventurisme politique. Les études collégiales de son fils, sa mère les confiera au collège Stanislas plutôt qu’aux séminaires en quête de vocations ; la décision valut à Parizeau un recul critique précieux et une culture plus ouverte. Du côté paternel, on cultivait, explique Duchesne, la compétence financière et une méfiance alerte à l’égard de la politique partisane. Le maniement de l’économie avait rendu la famille prospère, l’activité politique l’avait presque ruinée.
Après les études collégiales, les hautes études commerciales (HEC). Parizeau y bénéficie de l’appui marquant de quelques professeurs de l’élite québécoise du secteur, de François-Albert Angers en particulier. Sans lui, montre le biographe, le jeune homme n’aurait pu accéder aux meilleures universités européennes. « Plus tard, les études supérieures qu’il poursuivra à Londres ou les travaux qu’il mènera à la Banque du Canada lui apparaîtront comme ‘l’élaboration pénible de ce que les cours d’Angers exprimaient clairement’ ». Au retour de l’Europe, Parizeau est bardé de diplômes et « incapable de s’identifier au courant nationaliste tel qu’il est véhiculé par le premier ministre du temps ». Il s’est préparé pour les HEC, mais le Québec l’absorbera bientôt.
Aux portes du pouvoir
 Sitôt réinséré dans le Québec vivifié par la Révolution tranquille, Parizeau est sollicité par les ténors du mouvement. Dans l’air, que de projets ! Espoir d’une sidérurgie québécoise, mythique assaut contre les trusts de l’électricité, nationalisation de l’amiante, l’école renouvelée… Des réseaux relient René Lévesque, Eric Kierans, Michel Bélanger, André Marier, Claude Morin… Gérard Filion, passé du Devoir au paragouvernemental, préfère l’extrême prudence de Lesage : « Lévesque et Parizeau étaient des gars qui jouaient dans le dos de tout le monde, déclare-t-il au biographe. […] Je suis pas toujours sûr de la loyauté de ces gars-là vis-à-vis de Lesage ». Tandis que Filion occulte sa mégalomanie, Parizeau, plus sobre, admet des torts : « On n’a pas fait que des bons coups tout au cours de cette Révolution tranquille ».
Sitôt réinséré dans le Québec vivifié par la Révolution tranquille, Parizeau est sollicité par les ténors du mouvement. Dans l’air, que de projets ! Espoir d’une sidérurgie québécoise, mythique assaut contre les trusts de l’électricité, nationalisation de l’amiante, l’école renouvelée… Des réseaux relient René Lévesque, Eric Kierans, Michel Bélanger, André Marier, Claude Morin… Gérard Filion, passé du Devoir au paragouvernemental, préfère l’extrême prudence de Lesage : « Lévesque et Parizeau étaient des gars qui jouaient dans le dos de tout le monde, déclare-t-il au biographe. […] Je suis pas toujours sûr de la loyauté de ces gars-là vis-à-vis de Lesage ». Tandis que Filion occulte sa mégalomanie, Parizeau, plus sobre, admet des torts : « On n’a pas fait que des bons coups tout au cours de cette Révolution tranquille ».
La nationalisation de l’hydro-électricité utilisera au mieux les ressources de Parizeau ; elle profitera, par exemple, de sa familiarité avec le courtage. Sur ce terrain, Parizeau possédait, à cause des activités de sa famille, plusieurs longueurs d’avance. Alors que Lesage, influencé par George Marler et le trio Ames-Bank of Montreal-First Boston, doutait de pouvoir racheter les onze compagnies privées, Parizeau, abouché à des courtiers indépendants, comme Roland Giroux, de L. G. Beaubien, songeait à contourner le cartel. Duchesne dévoile la stratégie avec verve et précision. Giroux y tient un rôle déterminant : « Giroux demande à Lévesque de lui passer deux de ses gars pour mener une opération aux États-Unis. Celui-ci lui envoie Michel Bélanger et Jacques Parizeau ». Le biographe évalue à dix minutes le temps requis pour convaincre la maison new-yorkaise Halsey Stuart : « All right ! […] Combien vous faut-il ? Dans combien de temps ? » Non seulement la nationalisation trouve son financement, mais le Québec s’affranchit du carcan humiliant d’un courtage usuraire.
La tourmente politique
 Irrésistiblement, les mandats gouvernementaux confiés à Parizeau l’attirent de l’autre côté du miroir : il participera aux décisions. Sans doute moins magique que le récit que Parizeau donne de son chemin de Damas (dans un train filant vers l’ouest), la conversion de l’économiste à la foi souverainiste accrut la crédibilité du Parti québécois (PQ). Pour Parizeau, c’était cependant le début de durables tensions entre ses préférences et les hommeries qui affligent tout parti politique, surtout s’il est idéologique. Le solitaire allergique aux tractations couleur de muraille allait affronter les vues des stratèges non élus, mais aussi les énormes ego de tel et tel collègue, et cela, autant pendant le règne de Lévesque que pendant le sien. L’image de Parizeau, celle d’un bourgeois fier de l’être et d’un professeur à l’index magistral, lui complique l’existence. Le biographe reconstitue à merveille le triangle formé de Parizeau, du PQ et de l’électorat. « L’attitude et les allures de grand seigneur que se donne Jacques Parizeau déplaisent à plusieurs. Sur cet aspect de sa personnalité, un grave conflit l’oppose d’ailleurs à Claude Charron. » D’autres confrères, plus puissants et moins tonitruants, jettent eux aussi leurs peaux de banane devant Parizeau.
Irrésistiblement, les mandats gouvernementaux confiés à Parizeau l’attirent de l’autre côté du miroir : il participera aux décisions. Sans doute moins magique que le récit que Parizeau donne de son chemin de Damas (dans un train filant vers l’ouest), la conversion de l’économiste à la foi souverainiste accrut la crédibilité du Parti québécois (PQ). Pour Parizeau, c’était cependant le début de durables tensions entre ses préférences et les hommeries qui affligent tout parti politique, surtout s’il est idéologique. Le solitaire allergique aux tractations couleur de muraille allait affronter les vues des stratèges non élus, mais aussi les énormes ego de tel et tel collègue, et cela, autant pendant le règne de Lévesque que pendant le sien. L’image de Parizeau, celle d’un bourgeois fier de l’être et d’un professeur à l’index magistral, lui complique l’existence. Le biographe reconstitue à merveille le triangle formé de Parizeau, du PQ et de l’électorat. « L’attitude et les allures de grand seigneur que se donne Jacques Parizeau déplaisent à plusieurs. Sur cet aspect de sa personnalité, un grave conflit l’oppose d’ailleurs à Claude Charron. » D’autres confrères, plus puissants et moins tonitruants, jettent eux aussi leurs peaux de banane devant Parizeau.
Au départ, toutefois, Parizeau jouit d’un tel prestige auprès de Lévesque qu’il peut couvrir de sa paume l’ensemble des responsabilités économiques du gouvernement péquiste : Finances, Conseil du trésor, Revenu. Le baron ne rend de compte qu’à son roi. Pour parvenir à ce résultat, Parizeau a évité le piège des super-ministères. Quand Louis Bernard lui propose d’en diriger un, Parizeau s’esquive. « Jacques Parizeau connaît les lois et il sait fort bien que le ministre des Finances jouit du pouvoir de chef […]. C’est ce ministère que Parizeau désire de même que le pouvoir qui s’y rattache. » fois, Parizeau fera de son discours du budget son spectacle personnel, tout en gérant son Conseil du trésor comme son fief.
Pareil cumul de charges exigeait son prix. Parizeau put combattre selon ses vues la frilosité des Québécois en instaurant le Régime d’épargne-actions (REA) ; en revanche, il dut, puisqu’on le présumait seul maître des thèses financières du PQ, défendre le budget de l’an I… pourtant construit sans contribution de sa part. Rançon du renom !
Concurrence et divergences
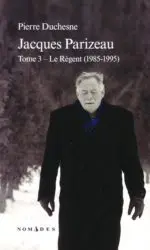 Duchesne souligne l’érosion : « Jacques Parizeau perd également de sa force sur un autre plan, celui de la stratégie parlementaire. Sur cet aspect, René Lévesque écoute Claude Morin plus que jamais ». Le baron n’est plus le seul au pied du trône, mais il obéit avec l’abnégation de la Garde jusqu’au beau risque auquel se résigne Lévesque.
Duchesne souligne l’érosion : « Jacques Parizeau perd également de sa force sur un autre plan, celui de la stratégie parlementaire. Sur cet aspect, René Lévesque écoute Claude Morin plus que jamais ». Le baron n’est plus le seul au pied du trône, mais il obéit avec l’abnégation de la Garde jusqu’au beau risque auquel se résigne Lévesque.
De fait, la vie de Parizeau ressemblera souvent à une chronique d’intrigues, de sape, de propos discrètement corrosifs. D’un côté, les ego ; de l’autre, selon Duchesne, les tendances monarchiques de Parizeau. Avec, toutefois, une fracture : autant le baron Parizeau obéissait en féal à son seigneur, autant le monarque Parizeau subit la déloyauté de plusieurs de ses barons. Duchesne n’éditorialise pas, il confesse, note, cite, transmet. Seul Lucien Bouchard refuse sa contribution ; il signera sa version des faits, d’ailleurs discutable. Pour leur part, les ministres, identifiés et enregistrés, rêvent de traits d’union entre souveraineté et association, d’étapes entre la question préalable et la déclaration d’indépendance, de référendums sectoriels, peut-être d’un changement de chef. Quant aux incontournables éminences grises, elles s’accommodent sereinement des nébulosités. Les lézardes s’élargiront quand, à l’approche du second référendum, la différence de charisme entre Parizeau et Lucien Bouchard s’amplifiera au profit du miraculé.
Cohérent et attentif, Duchesne ne dissimule rien du drame vécu par Jacques Parizeau pendant la campagne référendaire. Les leviers de commande tombent un à un des mains du chef péquiste. Contrôle-t-il la question ? Le calendrier ? L’objectif ? Cet homme qu’on dit orgueilleux se révèle alors si peu vaniteux qu’il cède l’avant-scène à son rival. Celui-ci rapprochera le OUI de la majorité, mais s’agissait-il encore de souveraineté ?
Bien peu de bémols
Le travail du biographe n’appelle guère de réserves. Les sources, multiples et presque toutes identifiées, fondent solidement ses conclusions. À peu d’exceptions près, les bourdes et le calvaire de Parizeau sont évoqués sans complaisance et sans hargne. Que les choix politiques de Duchesne soient patents depuis sa militance péquiste n’infirme pas le professionnalisme de sa recherche : admirable recul critique.
À peine deux minuscules réserves. D’une part, certains témoins, pensons ici à quelques militants de l’Union nationale, tel Jean Loiselle, n’ont pas leur place parmi les témoins neutres. D’autre part, certaines décisions de Parizeau correspondent si peu à son respect féroce des institutions qu’on doit s’interroger sur les influences qui ont infléchi son jugement. Par exemple, son occupation d’une résidence payée par la Chambre de commerce de Québec. Ou encore sa décision de ne pas nommer Serge Ménard au ministère de la Justice, alors que tout militait en faveur de ce choix. Dans les deux cas, le lecteur a toute latitude d’y voir l’intervention de la deuxième épouse de Parizeau. Duchesne a choisi de laisser dormir le questionnement ; peut-être a-t-il eu raison. Quand même en possession des faits, le lecteur peut tirer son verdict personnel. Donc, merci !
* Jacques Parizeau (1930-2015), caricature d’André-Philippe Côté, 4 juin 2015.
1. Pierre Duchesne, Jacques Parizeau, T. I, Le croisé (1930-1970), Québec Amérique, Montréal, 2015, 624 p. ; 19,95 $.
2. Pierre Duchesne, Jacques Parizeau, T. II, Le baron (1970-1985), Québec Amérique, Montréal, 2015, 535 p. ; 19,95 $.
3. Pierre Duchesne, Jacques Parizeau, T. III, Le régent (1985-1995), Québec Amérique, Montréal, 2015, 604 p. ; 19,95 $.
EXTRAITS
Si j’avais dit je reste en Angleterre, affirme Jacques Parizeau, personne n’aurait pu faire quoi que ce soit contre moi, mais moi j’aurais pu avoir de la difficulté à me regarder dans le miroir. C’est là que j’ai compris qu’une dette morale est bien plus exigeante qu’une dette écrite.
T.I, p. 165.
La veille, Jean Lesage a informé son Conseil des ministres qu’un groupe financier l’a menacé de ne pas réaliser un emprunt de soixante-quinze millions du gouvernement du Québec, tant que la possibilité de nationaliser la Shawinigan Water & Power sera dans l’air.
T.I, p. 276.
Coincé entre un Parizeau qui ne se reconnaît aucun supérieur, à l’exception de René Lévesque, et un Rodrigue Tremblay dont l’arrogance atteint des sommets inégalés, Bernard Landry dispose d’une très mince marge de manœuvre. Des années plus tard, il admet que Jacques Parizeau a eu la sagesse de refuser un ministère d’État privé de pouvoir réel.
T.II, p. 148.
En plus de Jean-Roch Boivin, bien d’autres membres de l’entourage de René Lévesque souhaitent restreindre l’énorme influence de Jacques Parizeau. C’est aussi l’avis de Louis Bernard. Pour le secrétaire général du gouvernement, malgré le rôle joué par Lucien Bouchard, c’est bien Jacques Parizeau qui est le grand responsable du résultat des négociations avec le secteur public. Or, l’entente conclue avec les employés de l’État est trop généreuse…
T.II, p. 305.
Contrairement à ce que Lucien Bouchard affirme dans ses mémoires, c’est donc bien avant le dépôt du rapport rédigé par Jean Charest qu’il prend la décision d’envoyer un message des plus compromettants au Conseil national du Parti québécois. […] Le dépôt du rapport Charest, le 17 mai, ne constitue donc qu’un prétexte de plus qui permet à Lucien Bouchard de rompre avec Brian Mulroney.
T.III, p. 148.
Bernard Landry rappelle que cinq ans auparavant, Serge Ménard, alors avocat, a représenté le maire de Saint-Sulpice, Paul Landreville, accusé de négligence criminelle pour avoir conduit sa moissonneuse-batteuse en état d’ébriété le 26 août 1989. L’immense véhicule a happé Hugo, le fils de Lisette Lapointe, alors âgé de 14 ans. « En droit criminel, c’est normal, les gens doivent être défendus, même les plus salauds, insiste Bernard Landry. Or, cela lui coûte son poste de ministre de la Justice ».
T.IiI, p. 300.
1. Présentation : un peuple et son rêve
2. Andrée Ferretti : une voix dérangeante et nécessaire
4. Monsieur Parizeau de Victor-Lévy Beaulieu
5. Le Bloc et le PQ : partis frères et/ou rivaux
6. Années de ferveur, 1987-1995 d’Éric Bédard
7. Chroniques référendaires : Les leçons du référendum de 1980 et 1995
8. Le référendum volé, 20 ans plus tard de Robin Philpot
9. Octobre 1995 : Tous les espoirs, tous les chagrins de Jean-François Lisée











