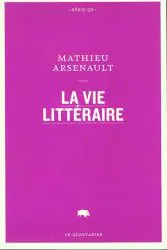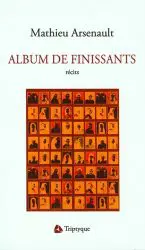Dans En vivant, en écrivant, Annie Dillard disait que tout auteur devrait écrire comme s’il était à l’article de la mort, à des lecteurs qui seraient en phase terminale. C’est dans cet esprit d’urgence que Mathieu Arsenault semble avoir rédigé La vie littéraire1.
Pas à la manière de sa défunte amie Vickie Gendreau, bien que les similitudes dans l’écriture et le ton soient nombreuses. On ne s’y confesse pas. On dit seulement son ras-le-bol, avec tout le venin, toute la verve et toute la liberté possibles.
La question centrale de ce livre qui tient à la fois de l’essai et, dans une moindre mesure, du roman, est celle-ci : quelle place réservons-nous aujourd’hui à la littérature, « quand je m’aperçois que la section plaisir de la table a avalé la section poésie et les gens qui vivaient dedans pour faire place à la magie et aux mystères objectifs de l’huile d’olive concrète et du bok choy automatique » ? On se doute de la réponse : pas grand-chose. Arsenault a raison de décrier la commercialisation de la culture. Le Salon du livre en est la quintessence. On y trouve plus que de la « littératante ». On coupe dans les programmes d’aide aux écrivains pendant que les librairies indépendantes ferment leurs portes les unes après les autres, ne manque-t-il pas de nous rappeler.
Cette question de la place de la « vraie » littérature nous amène à une autre, plus fondamentale : pourquoi alors écrire ? Dans la société qui est la nôtre, où l’on est submergés par les médias de masse qui nous gavent tous de la même chose, où tout le monde twitte son opinion, se raconte sur des blogues, des forums, la parole du poète finit noyée. Il y a trop de mémoire, trop de pages. Voilà l’auteur « entre les allées du plus grand entrepôt mondial de la totalité de l’écrit jamais construit qui erre dans cette bâtisse où on peut encore avancer s’écrire à perte d’âme et changer le monde et dire son essence et errer à perte de vue dans le battement du sensible sans que ça fasse le moindre pli sur la moindre poche du moindre snubbull ». Dans cette multitude infinie de reflets d’ego, tout se vaut. Et l’auteur de s’époumoner, insultes et grossièretés à la bouche, alors que cela, finalement, « est tellement banal qu’on peut même pas en faire un poème trash ».
L’auteur a 39 ans. Le « personnage », une jeune femme, en a 24. Le même âge que Vickie Gendreau avait à sa mort, souligne d’ailleurs la narratrice de La vie littéraire. De la défunte écrivaine, elle a l’intensité, le désir de vérité, mais aussi celui d’écrire, coûte que coûte. Dans son second livre, Drama Queen, Gendreau, qui se savait atteinte d’un cancer au cerveau, disait vouloir écrire un livre par année. Elle en aura publié deux. « [I]l y avait cette fille elle était là elle savait qu’elle n’avait pas d’avenir son seul espoir c’était continuer de taper sa phrase infinie parce que c’était tout ce qui la raccrochait au monde », écrit Mathieu Arsenault. Cette absence d’avenir est surtout due, ici, à l’impossibilité d’embrasser le vaste présent. Car il faut bien commencer par ici pour arriver ailleurs. Mais le présent, aujourd’hui, se métamorphose sans arrêt. Plus que cela, c’est qu’entre la jeune femme et lui, les interférences sont nombreuses.
Ainsi, une « princesse dans [s]on château de béesse » essaie d’écrire quelque chose de valable, mais elle est trop obnubilée par un monde faux et artificiel. Comme des milliers d’autres jeunes, sa page Facebook l’occupe beaucoup, et il y a les jeux vidéo, la bonne bouffe, les cups cakes, les macarons, le magasinage d’« ustensiles de cuisine design vert pomme ».
Avant, du temps des cassettes VHS, on pouvait croire « qu’il existait encore une intériorité tout un univers d’émotions à explorer ». Mais finalement, « nous ne serons jamais qu’à loyer », écrit l’auteur. Ce que nous disons ne nous appartient plus. Même notre corps. Nous sommes embarrés en nous-mêmes, et en nous, il n’y a plus qu’un désir illogique d’être connu pour ce que nous sommes à travers l’écran, les bidules technologiques, de ne plus être « l’oubliée de plus, l’oubliée de loin, l’oubliée de trop ». Et la narratrice d’ajouter : « [J]e fais semblant de crier comme une salope cochonne pour faire croire aux hommes que le sexe et les pulsions sont encore la porte secrète vers la dernière forme d’intensité qui soit restée debout ».
Outre sa charge sociale, la valeur de ce livre tient aussi dans l’écriture étonnante et savoureuse d’ironie de Mathieu Arsenault. Comme dans Album de finissants2, il fait plus que reprendre le langage de la jeunesse. Son écriture en est parasitée. Dans Album de finissants, il évoquait la vie d’élèves du secondaire à travers le prisme langagier de l’école et des matières qui y sont enseignées. Il reprend la même technique dans son dernier livre, en parlant par exemple des relations amoureuses comme des jeux vidéo avec leurs niveaux, leurs pointages, etc. : « [J]e te plante encore et encore et encore à street fighter 2 ». Le langage technologique s’amalgame presque naturellement à n’importe quel discours, comme si on ne savait plus voir la réalité qu’à travers ce filtre. Triste réalité, marquée par la désillusion, la perte de repères, le vide existentiel, la stupidité. C’est sans doute un peu extrême comme vision. Mais aujourd’hui, on dirait qu’il faut parfois crier très fort pour être entendu.
Qui portera attention à ce cri ? Certainement pas ceux qui achèteront au Salon du livre « le dernier navet de la rentrée que tout la monde va s’arracher ». Cette écriture exigeante plaira aux lecteurs qui n’ont pas peur de vivre une expérience un peu dérangeante. Ceux-là, malheureusement, auront sans doute la même opinion que l’auteur. Les autres n’en sauront rien. Ils s’en balancent.
1. Mathieu Arsenault, La vie littéraire, Le Quartanier, Montréal, 2014, 112 p. ; 17,95 $.
2. Mathieu Arsenault, Album de finissants, Triptyque, Montréal, 2014, 143 p. ; 13 $.
EXTRAITS
Le party de fin de session. Ostie que j’avais vingt ans bohème et coquette comme toutes les passionnées d’art et de culture je colligeais mes œuvres complètes dans des moleskines odorants je magasinais une vieille dactylo dans les marchés aux puces et je prenais des photos de tout ce qui est grand et beau que j’effaçais après pour faire de la place sur mon disque dur externe locaux à louer faillites fermetures magazines journaux en papier je serai brûlée depuis tellement d’années lorsque le dernier lien actif de mon profil facebook mourra et que les enfants des enfants des enfants se diront mais quelle époque conne ça devait être […].
La vie littéraire, p. 36.
[…] nous nous retrouvons tous les soirs sur notre téléphone désœuvrés en sale à niaiser avec un jeu où nous lançons des oiseaux sur des cochons sans arriver à taper une seule phrase sensée une seule ligne et toute cette jeunesse qui verra trop tard les trous qui se creusent partout s’envoie des messages textes où elle raconte qu’elle continue de marcher de parler de manger de dormir de chier sans savoir à quoi ça peut bien rimer la poésie il paraît que ça rime pas la poésie il paraît que ça te creuse et que ça te laisse en miettes c’est une cochonnerie terrible et pourtant je serais prête à tout abandonner pour elle mais j’aimerais savoir si c’est possible de continuer tout de même à pitcher de petits oiseaux fâchés qui explosent parce que j’aimerais bien unlocker l’achievement king of the caves avant que tout ce blanc de page ait fini de tapisser l’intérieur de ma vie.
La vie littéraire, p. 51-52.
[…] imagine ça toute une vie passée à construire une sculpture en calcium qui ne peut éclore qu’une fois qu’on est mort et je vis peut-être uniquement pour les phrases d’os que je vais laisser […]
La vie littéraire, p. 93.