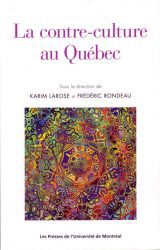Pour les repères essentiels qu’il propose, le collectif La contre-culture au Québec1 offre un complément incontournable à Pratiques et discours de la contreculture au Québec de Jean-Philippe Warren et Andrée Fortin. Les études rassemblées par Karim Larose et Frédéric Rondeau, codirecteurs de la publication, sont pour la plupart inédites et permettent d’approfondir des sujets ayant trait à la poésie, à la musique, au cinéma, au roman, au théâtre et aux revues de la contre-culture. C’est donc sous le signe de l’interdisciplinarité que sont réunis les quinze textes du recueil, avalisant le mantra seriné par Raôul Duguay, qui deviendra celui de toute une génération de créateurs : « Toutt est dans toutt ». Les analyses pointues privilégiant les œuvres particulières côtoient ainsi les survols historiques de courants artistiques, musicaux notamment.
Les trois premiers chapitres regroupés dans la section « Improvisation : jazz, rock et musique actuelle » offrent une entrée en matière foisonnante destinée aux mélomanes. Après qu’Eric Fillion s’est attardé aux moments forts des huit années d’existence de Jazz libre, groupe de free jazz né en 1967, Jean-Pierre Sirois-Trahan enchaîne avec une étude historique sur la musique rock contestataire où il conjugue avec finesse écriture gaillarde et savoir encyclopédique. Bien qu’il délaisse rapidement le concept de « devenir » emprunté à Gilles Deleuze et Félix Guattari, Sirois-Trahan circule avec une aisance manifeste entre le ti-pop des Sinners, les groupes de rock garage et de rock psychédélique, les chanteurs yé-yé et les chansonniers qui se partagent la scène musicale des années 1966-1976.
La contribution de Frédéric Rondeau apporte quant à elle un éclairage nouveau sur la littérature de la contre-culture. L’auteur émet en effet l’hypothèse que l’euphorie, les sentiments de renouveau et de liberté que l’on attribue souvent aux œuvres phares de cette période masquent en fait une profonde anxiété causée par la table rase du passé et l’avenir vacillant auquel le sujet se voit confronté. Les motifs de la disparition, de la primitivité, du dévoilement et du quotidien guident sa relecture de Victor-Lévy Beaulieu, Paul Chamberland, Patrick Straram et Denis Vanier. La typographie – entendue ici en un sens plus large que le veut son usage courant – des recueils de ce même Vanier retient d’ailleurs l’attention de Sébastien Dulude, qui souligne le rôle des dispositifs iconographiques comme discours d’accompagnement contre-culturels.
Mentionnons également l’importance accordée à Mainmise, le « Reader’s Digest de la pensée turned-on » qui, soit dit en passant, est désormais entièrement numérisée et accessible en ligne sur le site de la BAnQ. Outre l’étude de contenu menée par Jean-Philippe Warren, assez fidèle à celle livrée dans son Pratiques et discours, les textes de Marie-Andrée Bergeron et de Camille St-Cerny Gosselin s’attachent respectivement aux errements du discours pseudo-féministe véhiculé par la revue et à son mode d’intégration de la bande dessinée. On voit bien par ce bref aperçu que les approches sont variées et qu’il est d’autant plus difficile de rendre justice à un collectif riche d’expertises qui sauront rejoindre les intérêts les plus divers.
Cette hétérogénéité donne aussi droit à quelques flottements et contradictions mineurs d’une contribution à l’autre, conséquence directe d’une volonté de cerner l’objet analysé et de soumettre une voie de réponse, tout à fait justifiée dans le contexte, à la question « qu’est-ce que la contre-culture ? » D’autres, plus sages, s’abstiennent simplement d’offrir une définition qui ne peut que simplifier une réalité autrement plus complexe. N’empêche que parmi tout ce maelström d’étiquettes contestataires, la terminologie fluctue et le lecteur peut facilement s’égarer dans les subtilités qui distinguent les marginalités artistiques de l’avant-garde, la « néo-avant-garde artistique politisée » décrite par Anithe de Carvalho de l’underground proprement dit.
Si les pratiques de création contre-culturelles s’opposent à la culture officielle et légitimée, qu’est-ce donc qui les singularise par rapport à celles d’une avant-garde ? Enfin, comme le laisse entendre Jean-Marc Larrue dans son article sur le théâtre, à défaut d’une périodisation ne serait-ce qu’imparfaite, comment attribuer certaines démarches à la contre-culture plutôt, par exemple, qu’à la modernité artistique de la Révolution tranquille ? Tel est bien le paradoxe ou la zone d’ombre d’un objet d’étude défini par le multiple, déterminé par l’indétermination. Répondre à ces questions, ce que tentent les cosignataires de La contre-culture au Québec, permet de mieux voir les continuités souterraines oblitérées par de très concrètes volontés de rupture.
1. Sous la dir. de Karim Larose et Frédéric Rondeau, La contre-culture au Québec, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2016, 524 p. ; 49,95 $.
EXTRAITS
Toutefois, chez les auteurs de la contre-culture, c’est moins la destruction qui est présente qu’un profond désenchantement. Car l’espérance de l’avènement d’un temps nouveau s’accompagne aussi de visions inquiètes et pessimistes. Le sentiment de ne pas appartenir au monde qui les entoure se double de l’impossibilité de voir advenir le monde qu’ils appellent de leurs vœux.
Frédéric Rondeau, « Ne plus appartenir au présent : la contre-culture littéraire », La contre-culture au Québec, p. 200.
En somme, le mouvement contre-culturel était monté à bord d’un train en marche, celui de la Révolution tranquille, dont la locomotive était l’État, garant de l’ordre établi, soutenu par la majorité. Dans bien des domaines, le mouvement contre-culturel québécois n’a fait qu’accélérer des changements déjà en cours.
Jean-Marc Larrue, « La contre-culture et le théâtre francophone », La contre-culture au Québec, p. 294.