Qu’ils aiment ou pas écrire, les aspirants au pouvoir politique éprouvent presque tous l’obligation de confier au papier leurs convictions les plus intimes. Comme si, malgré l’omniprésence de l’image, l’écrit était le véhicule privilégié des plus sérieux engagements.
La France ne fait donc que payer tribut à ce souci lorsque quatre de ses figures politiques majeures publient des textes imprégnés de solennité. Manuel Valls est le plus pressé par l’urgence, Christiane Taubira la plus poétiquement inspirée, Nicolas Sarkozy le plus ondoyant, Jean-Luc Mélenchon le plus englobant. L’électorat français, plus familier de ses icônes politiques, évaluera leurs réflexions avec une compétence que ne peut revendiquer l’observateur étranger.
Comme un assiégé
 La justification du petit livre que signe le premier ministre de France, Manuel Valls (L’exigence1), l’auteur la formule lui-même : des mots ont été prononcés devant les élus et sur toutes les tribunes, mais ils ne sauraient suffire : « Qu’en restera-t-il dans cinq ans, dans dix ans ? Voilà ma hantise. Alors, il faut recommencer, encore et encore. Voilà pourquoi ce livre ». Façon succincte de cerner le défi. Autant dire, en effet, que le combat sera long, peut-être même permanent. Façon aussi d’affirmer, contre la fugacité de l’image et de la parole, la durabilité de l’écrit.
La justification du petit livre que signe le premier ministre de France, Manuel Valls (L’exigence1), l’auteur la formule lui-même : des mots ont été prononcés devant les élus et sur toutes les tribunes, mais ils ne sauraient suffire : « Qu’en restera-t-il dans cinq ans, dans dix ans ? Voilà ma hantise. Alors, il faut recommencer, encore et encore. Voilà pourquoi ce livre ». Façon succincte de cerner le défi. Autant dire, en effet, que le combat sera long, peut-être même permanent. Façon aussi d’affirmer, contre la fugacité de l’image et de la parole, la durabilité de l’écrit.
Valls parle et écrit en homme assiégé. Il n’a pas, contrairement à ceux qui l’écoutent ou le lisent, le contestent ou l’applaudissent, la latitude de se répandre en propos éthérés et longuement pensés : gérer et protéger la collectivité, tels sont ses soucis concrets et immédiats. Un peuple attend de lui qu’il assure la sécurité de tous, qu’il débusque les complots et les fanatismes, qu’il demande à la législation, si nécessaire, des recours supplémentaires. Rien de surprenant jusque-là.
Les propos de Valls frappent néanmoins par l’accent mis sur la dimension proprement française, j’allais écrire hexagonale, des récents attentats. « Ne nous y trompons pas, écrit-il : le terrorisme a frappé la France, pas pour ce qu’elle fait – en Irak, en Syrie, ou au Sahel –, mais pour ce qu’elle est. » Peut-être en est-il ainsi, mais l’admiration que mérite la France pour son histoire et ses principes oblige-t-elle à sous-estimer les deuils et les mérites des autres sociétés ?
Une indélébile citoyenneté
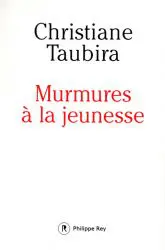 Si Christiane Taubira a rompu avec François Hollande, c’est, dit-elle dans Murmures à la jeunesse2, qu’elle n’admet pas qu’on dépouille de leur citoyenneté les Français coupables de terrorisme. Le réflexe est sain : au nom de quoi un pays peut-il prétendre à la sainteté de chacun de ses enfants et chasser de sa fratrie le criminel ? Par quel privilège divin un État peut-il prétendre que le Mal sévit sous toutes les latitudes étrangères et jamais en son sein ? Il est rassurant qu’une ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice perçoive quel raffinement du racisme et du pharisaïsme se dissimule sous la lubie de retirer à tout terroriste la nationalité française.
Si Christiane Taubira a rompu avec François Hollande, c’est, dit-elle dans Murmures à la jeunesse2, qu’elle n’admet pas qu’on dépouille de leur citoyenneté les Français coupables de terrorisme. Le réflexe est sain : au nom de quoi un pays peut-il prétendre à la sainteté de chacun de ses enfants et chasser de sa fratrie le criminel ? Par quel privilège divin un État peut-il prétendre que le Mal sévit sous toutes les latitudes étrangères et jamais en son sein ? Il est rassurant qu’une ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice perçoive quel raffinement du racisme et du pharisaïsme se dissimule sous la lubie de retirer à tout terroriste la nationalité française.
Christiane Taubira va au-delà du simple rejet de cette esquive. Elle ose regarder le terrorisme sans, d’avance, le sataniser : « Barbares ? Civilisation ? Civilisations ? Vrai, mais un peu court pour saisir cette intelligence en mouvement et en métamorphose. Oui, une intelligence. Démoniaque, démente, ayant rompu avec tout ce qui nous est commun en humanité, mais une intelligence, créatrice et réactive, cyniquement ingénieuse, furieusement audacieuse ». Démarche audacieuse qui suscitera la protestation. Christiane Taubira insiste pourtant : « Oui, il faut comprendre pour anticiper et aussi pour ramener du sens au monde ». Déferle alors, dans une langue superbe, une série d’appels aux gloires de la République : « Oui, au pays de Descartes, convoquons la raison. […] Oui, au pays de Montaigne, posons la question, que sais-je ? […] Oui, au pays de La Boétie, cherchons de quel limon se nourrit ce consentement à la suprématie d’un seul, lointain, sans vertu, à quoi tient cette obéissance aveugle… […] Oui, au pays de Simone Weil, refusons de voguer à la surface des choses, il faut fendre les flots et s’aventurer dans les eaux tumultueuses jusqu’au cœur du tourbillon ».
L’ex-ministre entretenait-elle d’autres griefs à l’égard du régime Hollande ? Je l’ignore. Qu’elle tienne à comprendre suffit.
Le pied à l’étrier
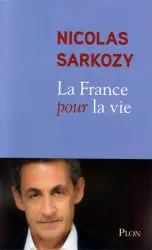 Battu par François Hollande lors de l’élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy prépare sans l’avouer sa candidature de 2017. Qu’il ne veuille pas en convenir démontre simplement qu’il n’a pas changé au point de toujours dire la vérité. La dénégation qu’il loge au début de son plaidoyer La France pour la vie3 convaincra d’autant moins qu’il la démolit lui-même dès le paragraphe suivant. D’abord, la dénégation : « Ce livre n’est pas une déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle. Il est trop tôt. Il n’a pas davantage vocation à traiter toutes les thématiques de la campagne de 2017 ». Puis, l’aveu qui est tout sauf candide : « Il y avait trois raisons à mon retour en politique ». Sarkozy aura beau distinguer benoîtement entre candidature à la présidentielle et figuration politique dans la nébuleuse droitière, aucun lecteur ne sera dupe : l’ex-président français rêve de l’Élysée.
Battu par François Hollande lors de l’élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy prépare sans l’avouer sa candidature de 2017. Qu’il ne veuille pas en convenir démontre simplement qu’il n’a pas changé au point de toujours dire la vérité. La dénégation qu’il loge au début de son plaidoyer La France pour la vie3 convaincra d’autant moins qu’il la démolit lui-même dès le paragraphe suivant. D’abord, la dénégation : « Ce livre n’est pas une déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle. Il est trop tôt. Il n’a pas davantage vocation à traiter toutes les thématiques de la campagne de 2017 ». Puis, l’aveu qui est tout sauf candide : « Il y avait trois raisons à mon retour en politique ». Sarkozy aura beau distinguer benoîtement entre candidature à la présidentielle et figuration politique dans la nébuleuse droitière, aucun lecteur ne sera dupe : l’ex-président français rêve de l’Élysée.
A-t-il changé ? Réévalué ses méthodes ? Jugulé ses exubérances ? Civilisé son vocabulaire ? Sarkozy l’affirme en multipliant les regrets et les aveux. Oui, il admet avoir usé d’expressions excessives. Oui, il a parfois succombé hier à l’attrait de l’improvisation et de l’ostentatoire. Ses repentirs ne portent cependant que sur des détails et ne prouvent surtout pas un changement en profondeur. Le tempérament demeure fougueux, volcanique, cassant, même si le converti se prétend désormais pudique, raffiné, nuancé. Il n’hésite d’ailleurs pas à affirmer le peu crédible. Le voici, par exemple, devenu soucieux de l’intimité de la famille et des proches : « C’est la raison qui m’a fait le plus hésiter quant à la pertinence de mon retour. Avais-je le droit de leur imposer cela une nouvelle fois ? Je n’ai toujours pas de réponse définitive ». Il attaque sans peur des thèses qui ont la consistance des moulins à vent de Don Quichotte : il s’oppose à « la démagogie du mandat unique », il affirme « qu’il est sain qu’un homme politique puisse gagner de l’argent par lui-même une fois sa carrière terminée ou interrompue »…
Le Sarkozy punitif refait néanmoins surface : « Si les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants, il convient de les traiter comme tels en supprimant l’excuse de minorité ». Il défend encore les peines plancher : « Quelle légèreté que de les avoir supprimées alors que le principe était juste et les modalités d’application simples ». Il faciliterait les mises à pied aux patrons d’entreprises : « Il n’est pas raisonnable de lui substituer le juge pour une décision qui doit relever de sa gestion et de sa responsabilité ». Plutôt que d’une mue, c’est d’une redoutable persistance qu’il faut parler.
Une Sixième République ?
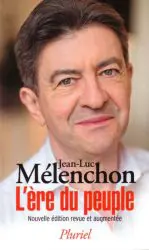 Jean-Luc Mélenchon (4e rang et 11 % du suffrage à la présidentielle de 2012) adopte dans L’ère du peuple4 un ton presque absent chez les trois auteurs précédents : « Existe-t-il un comportement que l’on peut qualifier de socialement moral et quelle est sa légitimité à se dire tel ? Est-il nécessaire de se doter d’une morale ? Peut-on s’en passer et vivre au fil de l’eau ? »
Jean-Luc Mélenchon (4e rang et 11 % du suffrage à la présidentielle de 2012) adopte dans L’ère du peuple4 un ton presque absent chez les trois auteurs précédents : « Existe-t-il un comportement que l’on peut qualifier de socialement moral et quelle est sa légitimité à se dire tel ? Est-il nécessaire de se doter d’une morale ? Peut-on s’en passer et vivre au fil de l’eau ? »
À chacune de ces questions, Mélenchon répond par l’affirmative. Avec lui, les électeurs français ne sont plus réduits au primat de l’omniprésence policière, ni au gonflement des peines carcérales, ni même au culte des beautés culturelles. Ils sont invités à apprivoiser la condition humaine et la mort qui la couronne, à prendre en compte la « dette écologique » qui se creuse à un rythme accéléré, à déterminer si l’école a vocation « d’instruire ou de dresser », à renouer avec la pensée de Jaurès : « La démocratie politique s’exprime en une idée centrale ou mieux encore en une idée unique : la souveraineté politique du peuple ». Au total, rien de moins qu’une mue constitutionnelle. Vaste programme !
Est-il essentiel de se demander si ces intervenants politiques ont eux-mêmes rédigé ces textes ? Peut-être pas, puisqu’ils les signent et donc les prennent à leur compte. Malgré l’absence du Front national dans ce prélude au débat électoral, les Français ont à leur portée un choix plus net que beaucoup d’autres sociétés : à eux d’en profiter !
1. Manuel Valls, L’exigence, Grasset, Paris, 2016, 92 p. ; 8,95 $.
2. Christiane Taubira, Murmures à la jeunesse, Philippe Rey, Paris, 2016, 93 p. ; 13,95 $.
3. Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, Plon, Paris, 2016, 259 p. ; 34,95 $.
4. Jean-Luc Mélenchon, L’ère du peuple, Pluriel, Paris, 2016, 117 p. ; 4,95 $.
EXTRAITS
Enfin, avant la fin de l’année, sur la base de l’expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques, créés au sein d’établissements pénitentiaires.
Manuel Valls, L’exigence, p. 41.
La déchéance de nationalité. Déchoir des terroristes, qui songerait à s’y opposer ? Binationaux ou non ! Mais quel effet sur les mêmes ? Ils ne meurent ni Français ni binationaux, ils meurent en morceaux. D’ailleurs, étaient-ils binationaux, les neuf qui ont semé la mort et la désolation dans Paris ce soir du 13 novembre ?
Christiane Taubira, Murmures à la jeunesse, p. 33.
Le Président qui choisit lui-même le patron de France Télévisions est rapidement devenu « le fait du Prince », en quelque sorte un dévoiement de la démocratie. Sur la forme, j’ai eu incontestablement tort. Mais, sur le fond, c’est peut-être une autre histoire… En effet, je voulais tourner le dos aux faux-semblants et à l’hypocrisie qui masquent si souvent les prétendues « autorités indépendantes ».
Nicolas Sarkozy, La France pour la vie, p. 132.
Les ouvriers et les employés forment la classe sociale la plus nombreuse en France. Mais ils ne représentent que 2 % des personnages visibles à la télévision. Les pauvres et les précaires y existent encore moins. Mais par contre les cadres y occupent 60 % des rôles visibles sur la scène. Ce n’est pas là seulement une réalité déformée. On voit une vision du monde se diffuser dans les esprits.
Jean-Luc Mélenchon, L’ère du peuple, p. 90.










