Ils sont arrivés par la porte dérobée d’un chapitre. Chacun trouvant naturellement sa place sur la pelouse grise qui s’enfonce dans le sol mouillé de la petite maison de la rue des Figuiers. À ne pas les compter, on aurait dit qu’ils étaient tous là.
Ils ne se connaissent les uns les autres que de nom, comme de vagues cousins dont on a toujours plus ou moins entendu parler, à demi-mot. Certains, plus curieux, cherchent dans l’attitude de leur voisin un trait de ressemblance, un geste qui s’échappe, une consanguinité d’encre. Mais le point le plus commun entre tous ces personnages est cette sévérité qui les habite tous, une allégeance au drame auquel personne n’a pu échapper.
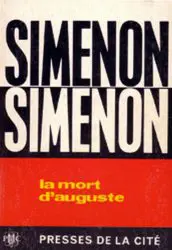 Si les hauts immeubles qui bordent la petite propriété confisquent tout espoir d’intimité, le vieux cèdre au fond du jardin ne se laisse pas impressionner par cette effusion de béton. Teresa, la dernière compagne de Simenon, a installé tout près de l’arbre une petite table que le sol condamne à être bancale. Un meuble inclassable, se situant entre le guéridon et la table de chevet. Sur l’autel à trois pattes repose l’urne du défunt. L’homme à la pipe, coiffé d’un chapeau mou, n’est plus que cendres dans un vase en porcelaine de Tournai. Ses dernières volontés étaient d’être répandu en une poussière grise autour de cet arbre qui a déjà accueilli les cendres de Marie-Jo, sa fille, morte onze années auparavant. Teresa, la cajolante la consolante, Teresa, le baume aux douces rides. Teresa, la femme de toutes les femmes, est la seule personne de chair. Alors que les enfants du romancier ont été tendrement tenus à l’écart, des ombres de papier évadées de ses multiples livres planent dans l’épaisseur nocturne. Teresa se moque bien de leur présence, elles ont la translucidité des fantômes et puis de toute manière, Teresa n’aime que Simenon.
Si les hauts immeubles qui bordent la petite propriété confisquent tout espoir d’intimité, le vieux cèdre au fond du jardin ne se laisse pas impressionner par cette effusion de béton. Teresa, la dernière compagne de Simenon, a installé tout près de l’arbre une petite table que le sol condamne à être bancale. Un meuble inclassable, se situant entre le guéridon et la table de chevet. Sur l’autel à trois pattes repose l’urne du défunt. L’homme à la pipe, coiffé d’un chapeau mou, n’est plus que cendres dans un vase en porcelaine de Tournai. Ses dernières volontés étaient d’être répandu en une poussière grise autour de cet arbre qui a déjà accueilli les cendres de Marie-Jo, sa fille, morte onze années auparavant. Teresa, la cajolante la consolante, Teresa, le baume aux douces rides. Teresa, la femme de toutes les femmes, est la seule personne de chair. Alors que les enfants du romancier ont été tendrement tenus à l’écart, des ombres de papier évadées de ses multiples livres planent dans l’épaisseur nocturne. Teresa se moque bien de leur présence, elles ont la translucidité des fantômes et puis de toute manière, Teresa n’aime que Simenon.
Hector Loursat (Les inconnus dans la maison), avocat à Moulins, ce même Loursat qui pratique l’art du bourgogne et celui du mépris vis-à-vis de sa fille, avance de quelques pas sous le regard de Jules Malétras, havané à souhait (Le bilan Malétras). Que peut bien vouloir faire cet homme par trop usé qui ne plaide désormais plus que dans sa cave ? se demande-t-il.
Antoine (La mort d’Auguste) a fermé le bistrot des Halles, Chez l’Auvergnat, il est accompagné de ses deux frères, Ferdinand et Bernard. L’un est juge d’instruction et l’autre vit aux crochets de gens trop crédules qui lui confient leurs économies. Bernard porte un col de loutre de Sibérie et scrute dans l’assistance des candidats pour agrandir son pigeonnier. Mais a-t-il oublié que chacun, ici présent, n’est déjà que trop accaparé par sa propre histoire ? D’ailleurs, il gesticule et se plaint à mots couverts d’avoir été injustement décrit par l’écrivain aux quatre cents livres.
— Vous n’êtes pas moins bien Lotti que moi, lui rétorque le gardien de la gare (Le nègre) dont le bagage narratif n’a jamais dépassé le bistrot, juste de l’autre côté de la voie ferrée où il écluse sa rancœur.
Il semble que Teresa ait puisé dans la garde-robe d’Édith Piaf pour y dégotter un rien de chiffon ; un tissu noir lui gomme les hanches en tombant abruptement. Elle se moque bien d’être belle, elle se moque bien de ces créatures de papier qui gesticulent derrière elle, qui cherchent sans doute une légitimité plus importante que celle de leur voisin. Elle est la seule personne véritablement incarnée dans ce jardin, à part l’arbre bien entendu qui ne parle plus qu’en siècles.
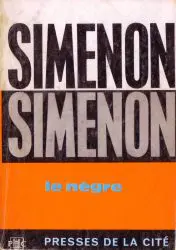 Bib explore chaque coin du jardin en levant la patte, Allard son maître n’est certainement pas très loin (L’homme au petit chien). Une tapineuse, de celles qui racolent les fonds de chapitre et dont le petit nom a été oublié par tous les lecteurs, prend l’animal dans ses bras pour l’embrasser. Les hommes la défrisent tant qu’elle en est venue à aimer les caniches. Une de ses collègues de la rue, dont les talons s’enfoncent dans la terre humide, avance en titubant. Elle n’est pas vraiment ivre, c’est plutôt la vie qui n’a jamais été une ligne droite pour elle. Elle est bien décidée à rendre à Simenon ce qu’il lui a prêté de plus intime : son rouge à lèvres. Pour ce faire, elle se penche vers l’urne et l’embrasse du plus copieux baiser. La porcelaine de Tournai, vieille fille toujours triste à mourir, habituellement assignée aux services à thé, aux soupières et aux vases mélancoliques, se rehausse d’une empreinte qui ferait rougir une coupe à champagne.
Bib explore chaque coin du jardin en levant la patte, Allard son maître n’est certainement pas très loin (L’homme au petit chien). Une tapineuse, de celles qui racolent les fonds de chapitre et dont le petit nom a été oublié par tous les lecteurs, prend l’animal dans ses bras pour l’embrasser. Les hommes la défrisent tant qu’elle en est venue à aimer les caniches. Une de ses collègues de la rue, dont les talons s’enfoncent dans la terre humide, avance en titubant. Elle n’est pas vraiment ivre, c’est plutôt la vie qui n’a jamais été une ligne droite pour elle. Elle est bien décidée à rendre à Simenon ce qu’il lui a prêté de plus intime : son rouge à lèvres. Pour ce faire, elle se penche vers l’urne et l’embrasse du plus copieux baiser. La porcelaine de Tournai, vieille fille toujours triste à mourir, habituellement assignée aux services à thé, aux soupières et aux vases mélancoliques, se rehausse d’une empreinte qui ferait rougir une coupe à champagne.
Le volet américain de Simenon est représenté notamment par Justin Ward (Un nouveau dans la ville), Ward ou Kennedy, on ne sait plus. On le reconnaît surtout à son manteau trois quarts plutôt court qui hésite entre la canadienne et l’imperméable d’un inspecteur de police. De tous les romans de Simenon, c’est probablement celui qui offre la plus belle introduction.
Mais c’est la fin qui compte, se défend Maudet, dont l’histoire s’est égarée à Panama (L’aîné des Ferchaux) tandis qu’Émile, hexagonal et parisien à tout rompre (Le chat), lui, regarde l’urne de ce père qui l’a affublé de tant de silences.
La jeune Maude Leroy (Strip-tease) se moque bien de ces comparaisons sans importance. Sa place à elle, elle ne la connaît que trop bien, elle l’a d’ailleurs gagnée de haute lutte en se déshabillant au Monico. Son talent se mesurant en bouteilles de champagne, à la fin de chaque soirée, Simenon ne lui dessinait que de sublimes robes de bulles. Tati (La veuve Couderc), qui verse plutôt dans la laine bien épaisse, un châle fait au crochet couvrant ses solides épaules, trouve que la gamine est bien maigre pour tenir un rôle aussi exigeant. C’est pourtant ce bout de femme avec de timides éclosions de fesses qui allume une pipe bourrée de Dunhill mélange spécial. Teresa tient absolument à ne pas céder aux débordements de ces présences sourdes dont les froissements ont fait fuir la vieille chouette. L’odeur très subtile du tabac rappelle à chacun ses origines ; Teresa s’approche du cèdre, elle prend le vase sous son bras comme une amphore de Carthage et jette de délicates poignées de cendres en l’air. Maude Leroy tire sur la pipe et amorce des nuages épais de fumée ronde dont le bleuté traverse les cendres qui retombent tout doucement sous la bienveillance d’un clair de lune.
Et chacun de se demander lors de cette cérémonie, du plus humble figurant au personnage le plus torturé : Mais où donc est passé le commissaire Maigret ?
* Photographie de Georges Simenon tirée de Simenon, Album de famille : Les années Tigy, Libre Expression, 1988.











