Une quinzaine de siècles après sa naissance au creux d’une lagune rébarbative, Venise résiste encore. Non plus seulement contre la mer, partenaire et marâtre, mais aussi désormais contre le meurtrier déferlement touristique et les complaisances politiques et financières.
Deux entreprises littéraires d’envergure fournissent des repères : Le Moyen Âge de Venise1 d’Élisabeth Crouzet-Pavan revient sur deux siècles d’une crise subie par la Sérénissime, tandis que Venise2, dirigé par Delphine Gachet et Alessandro Scarsella, raconte l’histoire de Venise et écoute ses amants.
Le Moyen Âge de Venise
Siècles difficiles
Rien comme sa résistance aux années cruelles pour donner la mesure d’une culture. Venise, née de la fuite devant les hordes lancées du nord, affronte, au cours des XIVe et XVe siècles, une série d’épidémies de peste, une meurtrière rivalité avec Gênes, la guerre avec les Ottomans, et quoi encore ! À cela s’ajoute, facteur proprement vénitien, l’impossibilité de s’abriter derrière des murailles. Le mérite d’Élisabeth Crouzet-Pavan grandit quand, contre l’avis alors courant dans sa confrérie, elle rechercha le caractère unique de Venise au lieu de le tenir pour acquis. Sa recherche, patiente, méthodique, prudente et diversifiée, la conduisit à une ferme conclusion : Venise dut sa survie à ce que les modernes appelleraient le sens de l’État. « Des incitations modestes du XIIIe siècle à la maîtrise réalisée à la fin du XVe siècle, l’histoire politique et sociale des assèchements semble donc se confondre avec celle de l’affermissement du pouvoir politique. » Pour survivre, Venise devait promouvoir « une amplification du poids de l’État dans la cité ».
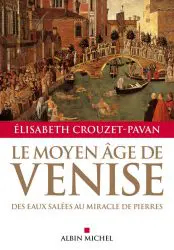 À ce choix s’ajoutent des influences puissantes et diverses qu’on ne retrouve pas au même degré ailleurs en Italie. Venise se rattache plus à Byzance qu’à Rome. Elle ne se fait pas scrupule de pratiquer un césaro-papisme qui retarde la séparation de l’Église et de l’État : monastères et couvents partagent les vues de l’État jusqu’à la conquête du sol contre la mer. Quand, de surcroît, les reliques de saint Marc sont acquises par Venise, les rivales de la Sérénissime subissent un recul et la préséance remplace la concurrence.
À ce choix s’ajoutent des influences puissantes et diverses qu’on ne retrouve pas au même degré ailleurs en Italie. Venise se rattache plus à Byzance qu’à Rome. Elle ne se fait pas scrupule de pratiquer un césaro-papisme qui retarde la séparation de l’Église et de l’État : monastères et couvents partagent les vues de l’État jusqu’à la conquête du sol contre la mer. Quand, de surcroît, les reliques de saint Marc sont acquises par Venise, les rivales de la Sérénissime subissent un recul et la préséance remplace la concurrence.
À potasser les archives de Venise, Élisabeth Crouzet-Pavan parvient même à mesurer l’efficacité des règlements édictés par les pouvoirs publics. Entre ses mains d’intelligente interprète, les statuts répondent à la question vitale : se contentait-on de légiférer en ignorant la pratique ? Réponse : « […] à mesure que le temps passe et que les statuts grossissent, tandis que s’étend le domaine de l’intervention publique, la forme urbaine se dessine avec une netteté croissante. […] Et la ville de la sorte est produite et inventée, c’est-à-dire qu’elle est aménagée, ordonnée, chargée de sens ».
Venise en mouvement
L’auteure se penche avec une admirable minutie sur « la dynamique de territorialisation », autrement dit sur l’emprise de Venise sur les territoires adjacents, mais aussi sur la coloration de chaque quartier (sestier). Où se regroupent les nobles ? Comment chasse-t-on les métiers polluants (tanneries, abattage…) vers la périphérie ? « Il n’était plus tolérable que flottent dans les canaux de Venise les carcasses et les viscères. » Peu à peu se forge l’image que visiteurs et touristes conserveront et répandront de Venise : « Un centre se dégage, plus symbolique encore que géographique, et autour de lui le souvenir gravite et s’ordonne. La ville est en effet approchée, saisie, décrite et restituée à partir de la rive sud, celle de San Marco, comme si ce lieu suffisait à exprimer toute l’identité vénitienne ».
Sans anachronisme, Élisabeth Crouzet-Pavan aide le lecteur à entrevoir ce qui, au fil des ans, confrontera Venise : un mythe naîtra que le sens de l’État ne tempérera plus et qui gonflera démesurément l’attrait de la ville lacustre. Les ingrédients qui ont préservé la ville pendant deux siècles cruels peuvent-ils encore intervenir ? À voir.
Mission magnifiquement accomplie.
Venise
Un lieu enchanté et exigeant
Sobrement ou avec flamme, mais toujours avec amour, au ras du quotidien ou à l’écoute des poussées centenaires, mais toujours en accord avec l’histoire et ses certitudes, en contact avec le passé combatif comme avec le futur redoutable, les témoignages réunis dans ce persuasif plaidoyer collectif décrivent une Venise menacée. Qu’ils aillent parfois (presque) jusqu’au reproche, tous n’en livrent pas moins la preuve qu’on n’approche pas Venise sans investir quelque chose de soi. S’il était pensable qu’on en arrive un jour à tout dire de la Sérénissime, peut-être trouverait-on ce dossier plantureux parmi les ultimes prétendants à cette réussite.
L’historique, première facette de ce chantier, remonte jusqu’au début ; il ne se referme qu’après avoir fourni les statistiques les plus à jour, dénoncé les magouilles encore visqueuses, évoqué les propositions salvatrices les plus avant-gardistes. À peine peut-on reprocher à l’un des auteurs de ce préalable son maniement de la ponctuation : à croire que la virgule s’est enrichie des fonctions normalement confiées au point-virgule, aux deux-points, au point. Les corollaires et les coexistences s’en trouvent dépaysés.
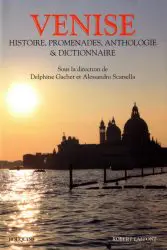 Quant aux promenades, il était prévisible et heureux que chacun privilégie la sienne. Un dénominateur commun rapproche néanmoins les musardeurs : ils se sont presque tous égarés au cours de leurs déambulations… Ils s’en glorifient à juste titre, puisque c’est ainsi qu’on apprivoise une ville. Il était moins attendu et moins heureux, cependant, que la promenade perde soudain son sens premier et devienne la présentation méthodique des caractéristiques culturelles, architecturales ou musicales de Venise. Les excellents textes sur l’architecture contemporaine de Venise, sur la Biennale, sur la Mostra méritaient non un coin parmi les promenades, mais une vitrine bien à eux. Quand une ville a été filmée 3000 fois, pourquoi maquillerait-elle cet exploit en prétexte à promenade ? La très pertinente question de notre collègue Patrick Bergeron (« Venise, une lecture décadente ? »), se fonde non sur un parcours pédestre, mais sur une analyse littéraire de haut vol.
Quant aux promenades, il était prévisible et heureux que chacun privilégie la sienne. Un dénominateur commun rapproche néanmoins les musardeurs : ils se sont presque tous égarés au cours de leurs déambulations… Ils s’en glorifient à juste titre, puisque c’est ainsi qu’on apprivoise une ville. Il était moins attendu et moins heureux, cependant, que la promenade perde soudain son sens premier et devienne la présentation méthodique des caractéristiques culturelles, architecturales ou musicales de Venise. Les excellents textes sur l’architecture contemporaine de Venise, sur la Biennale, sur la Mostra méritaient non un coin parmi les promenades, mais une vitrine bien à eux. Quand une ville a été filmée 3000 fois, pourquoi maquillerait-elle cet exploit en prétexte à promenade ? La très pertinente question de notre collègue Patrick Bergeron (« Venise, une lecture décadente ? »), se fonde non sur un parcours pédestre, mais sur une analyse littéraire de haut vol.
Quant à la copieuse anthologie, elle présente les charmes et les risques de ce genre littéraire. Les grands noms y abondent, mais de quel contexte émerge le morceau choisi ? Que Giono tienne à ne pas fréquenter les trappes à touristes, on s’en réjouit, mais à quoi rime la schizophrénie d’un touriste qui exècre le touriste tout en l’imitant ? On se doute bien que, pour Sartre, Aragon ou Sagan, Venise est prétexte à écrire ce qu’ils tenaient à dire tôt ou tard, mais Venise y gagne bien peu. Je ferais exception pour quelques auteurs qui, plutôt qu’un morceau découpé à même un ensemble qui nous échappe, ont formulé à l’occasion de Venise une réflexion isolable.
Horizon chargé
Venise a connu sa part de déboires. Elle n’est d’ailleurs pas au bout de ses peines et ce bouquin l’admet honnêtement.
C’est de Bonaparte qu’est venu l’assaut le plus paradoxal contre Venise. L’homme qui visait le statut impérial estima nécessaire d’imposer à la cité lacustre un gouvernement plus proche de la démocratie. Étrange professeur de légitimité sociale que celui-là ! Comme si ce coup de canif dans les particularités de Venise ne suffisait pas, Bonaparte jugea bon de céder à l’Autriche l’autorité sur la ville. La chronologie historique note les faits : « 1797. […] Le 16 mai, les troupes françaises entrent à Venise et répriment dans le sang toute résistance. La ‘République démocratique de Venise’ est proclamée, s’ensuit le pillage de la part des Français des objets précieux et des œuvres d’art, qui seront transportées en France ». La suite arrive au galop : « 1798. Avec le traité de Campoformio, Napoléon cède Venise aux Autrichiens, qui entrent avec leurs troupes dans la ville ». Il faudra attendre 1866 pour que Venise soit « cédée au nouveau royaume d’Italie, sous Victor-Emmanuel II ».
 De nos jours, Venise se heurte à divers défis tout aussi lourds de conséquences. D’une part, un regroupement territorial fait de Venise un élément minoritaire : l’ancienne cité compte aujourd’hui à peine 60 000 citoyens et les décisions semblent prises par et pour la population majoritaire de Mestre plutôt qu’en fonction de Venise. D’autre part, le tourisme tel qu’on le pratique aujourd’hui fait courir d’énormes risques à la Sérénissime : les énormes bateaux de croisière ébranlent les canaux de la ville et vomissent par millions des touristes qui noient la population locale et imposent leurs mœurs. Par exemple, ce concert de Pink Floyd : « […] une foule immense – quelque deux cent mille personnes arrivées pour l’occasion à Venise – se massa sur la place Saint-Marc et sur la fondamenta degli Schiavoni. Les conséquences furent catastrophiques : le palais des Doges eut ses marbres fissurés par la puissance du son ».
De nos jours, Venise se heurte à divers défis tout aussi lourds de conséquences. D’une part, un regroupement territorial fait de Venise un élément minoritaire : l’ancienne cité compte aujourd’hui à peine 60 000 citoyens et les décisions semblent prises par et pour la population majoritaire de Mestre plutôt qu’en fonction de Venise. D’autre part, le tourisme tel qu’on le pratique aujourd’hui fait courir d’énormes risques à la Sérénissime : les énormes bateaux de croisière ébranlent les canaux de la ville et vomissent par millions des touristes qui noient la population locale et imposent leurs mœurs. Par exemple, ce concert de Pink Floyd : « […] une foule immense – quelque deux cent mille personnes arrivées pour l’occasion à Venise – se massa sur la place Saint-Marc et sur la fondamenta degli Schiavoni. Les conséquences furent catastrophiques : le palais des Doges eut ses marbres fissurés par la puissance du son ».
Plusieurs collaborateurs espèrent ouvertement le retour de Venise à son antique respect des pouvoirs publics et des priorités collectives. L’ampleur et le nombre des magouilles récemment révélées font redouter qu’on poursuive dans le sens opposé. Alors que certains observateurs croient le redressement possible, d’autres, tel Dominique Fernandez, évoquent plutôt la fin : « Nos arrière-petits-enfants ne verront plus Venise : c’est un fait presque acquis ». Il ajoute pourtant : « Mais, pour le moment, quelle ville encore prodigieusement vivante ! » Retenons les deux phrases.
* Miracle de la croix au pont de San Lorenzo (Gentile Bellini, vers 1500).
1. Élisabeth Crouzet-Pavan, Le Moyen Âge de Venise, Des eaux salées au miracle de pierres, Albin Michel, Paris, 2015, 1114 p. ; 60,95 $.
2. Delphine Gachet et Alessandro Scarsella, Venise, Histoire, promenades, anthologie & dictionnaire, Robert Laffont, Paris, 2016, 1182 p. ; 66,95 $.
EXTRAITS
L’histoire de l’expansion urbaine fournit donc, à qui veut examiner les relations sociales au sein de la contrada, des éléments d’appréciation qui ont été curieusement ignorés. Certaines opérations d’assèchement furent collectives ; la plupart supposèrent réunions, discussions et ententes, toute une vie de relations sociales.
Le Moyen Âge de Venise, p. 55.
Venise, ancienne possession byzantine qui s’est émancipée, n’appartient pas, qu’on me pardonne ce rappel, au royaume d’Italie. Pas besoin d’attendre ici la paix de Constance et la consolidation des institutions communales pour que soit bâti un siège du pouvoir.
Le Moyen Âge de Venise, p. 119.
Un fait demeure. Par ses fonctions et son immersion dans les usages et les trajets des Vénitiens, la place [Saint-Marc] demeurait très concrètement à la fin du XVe siècle pour beaucoup un espace communautaire, un espace familier. Autrement dit, la place est aujourd’hui sans doute plus étrangère aux Vénitiens qu’elle ne l’était il y a près de six siècles.
Le Moyen Âge de Venise, p. 674.
Fièvre, langueur, mélancolie, sursauts d’énergie – Venise dispense tout cela. La volupté menace toutefois de tourner la tête du visiteur délicat qui, pour s’être aventuré aux pointes extrêmes de la sensibilité, risque de se laisser enliser à son insu. Venise rend séduisante l’idée même de disparaître. Elle est, en cela, pernicieusement ambiguë.
Venise, Patrick Bergeron, p. 570.
La tradition byzantine fut vraiment fondamentale et décisive pour le futur de la Sérénissime République, surtout du point de vue politique car elle inculqua aux Vénitiens un haut sens de l’État.
Venise, Stefano Trovato, p. 8.
Il faut environ deux mois pour construire une gondole. Elle mesure 11,10 m de long, fer compris, 1,42 de large et, depuis le XIXe siècle, elle présente une asymétrie de 24 cm sur le côté droit qui compense en partie la tendance qu’a la poussée de la rame sur la forcola à faire tourner le bateau.
Venise, Andrea Bonifacio, p. 404.











