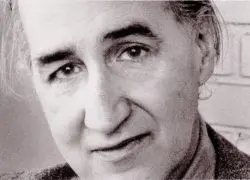Du fond de mon arrière-cuisine1, recueil d’historiettes, de contes et d’essais publié aux éditions du Jour en 1973, refaisait récemment surface à la Bibliothèque québécoise. Les ferroniens se réjouiront de la remise en circulation de l’ouvrage et les néophytes, quant à eux, jeunes ou moins jeunes, débutants ou nouveaux adeptes, pourront à travers sa lecture comprendre un peu mieux le grand intérêt de l’œuvre, protéiforme, du médecin-écrivain.
« Tout l’art du roman repose sur la crédulité du lecteur, écrit Jacques Ferron, ce que le conteur populaire sait très bien : il ne ment pas, il trompe, et il trompe pour s’adresser, à mots couverts, à des non-initiés, c’est-à-dire, en des termes qui voilent sa pensée, car il est, lui, un initié qui ne doit pas divulguer son secret sous peine de le perdre. » Donc Ferron médecin, Ferron écrivain, Ferron littérateur, Ferron conteur et Ferron trompeur : Du fond de mon arrière-cuisine réunit les multiples moi schizoïdes de l’auteur. « Quand je parle ou j’écris, affirme-t-il, je ne dispose que d’un seul acteur. Ce visage nu, il se nomme JE, mais il s’affuble aussi de personnages […]. Je reste unique et pourtant je me multiplie pour me rendre compte de la diversité du monde. » Ferron continue : « Je n’y parviendrai jamais. Je pense, donc je suis, mais je pense avec des mots. […] Comment est-il possible d’atteindre à la réalité par la fabulation ? Je m’en approche peut-être, mais plus je m’en approche, plus elle me fuit. Comment un faiseur de contes peut-il dire la vérité ? » La question est intéressante, puisque le recueil semble, d’une certaine manière, démontrer par l’exemple cette poétique de l’affabulation aspirant à la vérité.
Qu’il parle de Molière ou de « La chasse-galerie », qu’il écrive à propos du chanvre ou de Gabrielle Roy, qu’il discoure sur ce que l’on pourrait qualifier de « géopolitique à saveur sociologique » de la paroisse pensée comme république, qu’il parle d’une énigmatique thèse de doctorat en « Lettres moulées » sur Camus – ou porte-t-elle plutôt sur l’identité québécoise ? – qu’il n’aurait en fait jamais pu soutenir, ne recevant pas l’aval du jury, Ferron mêle le vrai et le faux, le sérieux et le badin, l’austère et l’ironique, d’une manière qui ne peut qu’égarer le lecteur, tout en le rapprochant aussi d’une certaine vérité, moins assise sur l’empirique et le pragmatique que sur quelque chose de mystérieux qu’on pourrait penser comme le propre de la littérature et de la pensée essayistique.
 Cela séduit. La prose de Jacques Ferron est dense, parfois lourde, toujours belle, souvent polémique. Mais il semble qu’il faille connaître les gens, leurs relations avec le bon docteur, les dynamiques du champ de l’époque, pour bien apprécier certains des propos et certaines des charges de Ferron, notamment celles, caustiques, à l’égard de Marshall McLuhan, de Denis Szabo ou de Monique Bosco, qui ne sont pas immédiatement accessibles, même au plus curieux des lecteurs qui prendrait au moins quelques minutes pour fouiller les archives de l’auteur. Les notes de Pierre Cantin, réalisées avec la collaboration de Luc Gauvreau (tous les deux spécialistes de l’œuvre), viennent parfois clarifier certains propos, mais sont trop peu nombreuses pour éclairer suffisamment le lecteur peu familier des débats de l’époque, par exemple. On en aurait voulu plus – une véritable édition critique, donc, en mesure d’initier un nouveau lectorat aux textes recueillis ici.
Cela séduit. La prose de Jacques Ferron est dense, parfois lourde, toujours belle, souvent polémique. Mais il semble qu’il faille connaître les gens, leurs relations avec le bon docteur, les dynamiques du champ de l’époque, pour bien apprécier certains des propos et certaines des charges de Ferron, notamment celles, caustiques, à l’égard de Marshall McLuhan, de Denis Szabo ou de Monique Bosco, qui ne sont pas immédiatement accessibles, même au plus curieux des lecteurs qui prendrait au moins quelques minutes pour fouiller les archives de l’auteur. Les notes de Pierre Cantin, réalisées avec la collaboration de Luc Gauvreau (tous les deux spécialistes de l’œuvre), viennent parfois clarifier certains propos, mais sont trop peu nombreuses pour éclairer suffisamment le lecteur peu familier des débats de l’époque, par exemple. On en aurait voulu plus – une véritable édition critique, donc, en mesure d’initier un nouveau lectorat aux textes recueillis ici.
L’érudition de Ferron est à l’œuvre dans tous les textes du recueil. C’est avec un grand plaisir qu’on lit la vingtaine de pages consacrées à « La chasse-galerie », par exemple, qui dénote une connaissance intime des mécanismes du conte et de l’histoire de ce morceau de folklore québécois. Ferron en analyse le déplacement géographique, depuis la France médiévale jusqu’au Québec des chantiers forestiers, en plus d’en décrire les variantes et de tenter d’en expliquer le titre, énigmatique s’il en faut, tout en se permettant quelques commentaires sur la grammaire de Port-Royal, ayant fixé d’une certaine manière la langue française en 1660 en s’imposant comme grammaire universelle. Cela permet à Ferron de gloser sur le rapport du Québec à la langue française, exposant ainsi certaines thèses sur l’insécurité linguistique des Québécois et des Québécoises des années 1960-1970. « Le chanvre », autre texte du recueil, offre avec humour une histoire de cette plante. C’est un Ferron rieur qui raconte cette histoire d’une manière fort amusante, pédagogique et légèrement insolente. Les textes se suivent et ne se ressemblent pas tellement, dans Du fond de mon arrière-cuisine. Parfois Ferron s’intéresse à Memmi et à son Portrait du colonisé ; parfois il consacre à Gabrielle Roy un très beau passage dans lequel on décèle malheureusement, 40 ans plus tard, un brin de condescendance sexiste ; à d’autres moments, Ferron parle de Céline et de son désir jamais réalisé de s’établir au Canada ; enfin, un peu partout dans le livre, le médecin-écrivain s’interroge : pourquoi écrire ? Pourquoi faire des contes ? Pourquoi convoiter la littérature alors qu’il a une carrière assez prenante à mener ? Il n’y a évidemment pas de réponse définitive à ces questions, mais les mots de Ferron n’en sont pas moins troublants, parfois désarmants : « On écrit par révolte contre soi-même, pour libérer le monstre, le mégalomane, pour être soi-même et tout ce qu’on n’est pas et qu’on pourrait être. C’est permis, c’est faisable, car on écrit à un niveau qui n’est pas sujet aux lois de la société, pour la bonne raison qu’on écrit en dehors de la société ».
Les deux textes les plus puissants du recueil sont assurément les derniers, qui à eux seuls justifient amplement la réédition : d’abord, le long morceau sur Claude Gauvreau, puis « Les salicaires », considéré par de nombreux commentateurs comme l’un des plus beaux textes de la littérature québécoise. Commençons par Gauvreau. « Les fous, écrit Ferron, sont, avec les enfants, les gens les plus logiques du monde. » Médecin à Saint-Jean-de-Dieu, Ferron discute avec l’auteur des Oranges sont vertes et de La charge de l’orignal épormyable ; il regarde son ami se débattre contre lui-même en « homme tragique et émouvant » ; il lit ses poèmes exploréens au chevet de sa mère mourante ; il analyse les dynamiques internes chez les automatistes, compare Borduas à Riopelle et à sa sœur Marcelle ; il parle de ses premiers efforts littéraires à lui, de sa pièce L’ogre que Gauvreau n’avait pas aimée ; il réfléchit aux raisons qui l’ont mené à s’engager dans une carrière de polémiste, puis tente de comprendre, à partir de sa propre expérience de l’écriture et à partir du Refus global et du mythe de Nelligan, entre autres choses, les liens qu’il y aurait à faire entre la folie et la résignation chez le peuple du Québec. Ferron analyse, discourt, théorise, mais finalement, c’est de lui qu’il parle le plus, notamment lorsqu’il décrit la dernière image qu’il garde de Claude Gauvreau avant son suicide, c’est-à-dire celle de la folie comme une forme de « révolte contre ce qui offense l’humanité ».
Du fond de mon arrière-cuisine s’achève avec « Les salicaires ». Jean-Marcel Paquette « a écrit que ‘ce texte est un sommet du lyrisme ferronien et constitue sans aucun doute l’un des plus forts de toute la littérature québécoise’ », nous rappelle la maison d’édition BQ. Michel Lapierre, dans Le Devoir, à l’occasion de la réédition du recueil, confirme que « Les salicaires » est « [l’]un des plus beaux passages de la littérature québécoise2 ». Patrick Poirier parle quant à lui d’une « lecture éblouissante », d’un des textes « les plus achevés et [les] plus beaux de Ferron, […] théâtre d’un désastre, celui de notre époque3 ». Il semble y avoir consensus sur l’importance de ce texte, consensus auquel on ne peut s’opposer tant l’œuvre est puissante. Dans « Les salicaires », Ferron s’adresse à lui-même à la troisième personne du pluriel, comme pour instaurer une distance froide entre lui et lui-même, mais il s’agit tout de même de l’un de ses textes les plus personnels. Au lendemain de la mort de Gauvreau, à l’aube de ses 50 ans, Ferron s’interroge sur la fatigue de vivre qui l’accable. Se rappelant qu’il est possible de mourir à même la vie, il s’analyse et se critique tandis qu’il tente de comprendre ce que la littérature et la médecine lui auraient apporté. Observant les salicaires qui poussent et fleurissent à l’orée d’un bois derrière chez lui, dans le no man’s land d’un espace en friche qui sera bientôt envahi par des banlieues toutes identiques, Ferron se rappelle enfin qu’« [o]n se guérit de mourir par des résidus de vie qui restent vivaces et bénéfiques comme des remèdes que l’âge aurait peu à peu préparés ». Pour le lecteur qui entre chez Ferron pour l’une des rares fois de sa vie, compagnon seulement des contes de l’auteur, « Les salicaires » ouvre toutes grandes les portes de l’œuvre, dans laquelle il ne pourra que vouloir s’avancer – je parle bien sûr ici de moi.
1. Jacques Ferron, Du fond de mon arrière-cuisine, Les salicaires, édition préparée par Pierre Cantin, avec la collaboration de Luc Gauvreau, Bibliothèque québécoise, Montréal, 2015, 267 p. ; 12,95 $.
2. Michel Lapierre, « Jacques Ferron 30 ans plus tard », Le Devoir, 11 avril 2015.
3. Patrick Poirier, « Un livre au crépuscule », dans Jacques Ferron, Du fond de mon arrière-cuisine, p. 11.
EXTRAITS
La raison de la folie est d’abord sociale : on sélectionne un certain nombre de sujets, on les déclare irresponsables et on se sert d’eux comme repoussoirs pour que la grande majorité des gens se tiennent responsables de tout ce qu’ils font, ce qui facilite grandement leur gouvernement.
p. 194
[…] la mort ne vous effrayait pas, arc de triomphe de votre salut. Cette disparition individuelle marquerait votre accomplissement, car vous pensiez laisser le monde plus beau que vous ne l’aviez trouvé. […] Vous aviez oublié qu’on peut mourir en continuant de vivre, se survivant sur terre comme en enfer… Une sorte de bonheur vous poussait de l’avant, curieux de vieillir, bonheur juvénile expansif par petites secousses, animé par le rire contenu de tous vos devanciers condamnés au silence.
p. 240
Et puis, désabusé, vous aviez ressenti, avant la mort, avant la nuit, cette fatigue de vivre quand le soleil, encore haut, commençant à peine à s’adoucir, couvait de sa chaleur un bel après-midi de juillet. Vous veniez d’avoir cinquante ans, riche d’années sages et décisives cachées derrière votre dos, sur lesquelles vous comptiez beaucoup pour travailler, étudier, réfléchir. […] Cette fatigue inopinée vous mortifiait plus que la mort, car la mort n’est jamais vécue et vous aviez à vivre […].
p. 241