Née aux États-Unis en 1954 au confluent de deux cultures foisonnantes, l’allemande européenne et l’amérindienne étatsunienne, Louise Erdrich construit depuis plusieurs décennies une œuvre d’une grande originalité et d’une pénétrante lucidité.
Et cela, dans une langue élégante et prenante. La perception amérindienne y assume la préséance, sans que l’auteure renonce pour autant à créer des récits à racines simplement humaines et à portée universelle. Rien n’est circonscrit, par exemple, lorsqu’elle dévoile dans Le jeu des ombres la riposte d’Irène face à un mari qui a lu son journal intime : la contre-offensive de l’épouse pourrait honorer le Décaméron aussi volontiers que le répertoire d’une auteure amérindienne. Récit à la fois enraciné et ouvert au monde.
Ascendances et priorités
 L’admirable diversité des œuvres signées Louise Erdrich doit sans doute une part de son ampleur aux divers métissages dont l’auteure peut déployer la richesse. Son père est un Américain d’origine allemande, tandis que sa mère est de sang français pour une demie et amérindien (chippewa/ojibwé) pour la seconde moitié. La plupart des livres optent pour un versant ou l’autre, Le jeu des ombres par exemple, mais certains, tel La chorale des maîtres bouchers, entremêlent les deux.
L’admirable diversité des œuvres signées Louise Erdrich doit sans doute une part de son ampleur aux divers métissages dont l’auteure peut déployer la richesse. Son père est un Américain d’origine allemande, tandis que sa mère est de sang français pour une demie et amérindien (chippewa/ojibwé) pour la seconde moitié. La plupart des livres optent pour un versant ou l’autre, Le jeu des ombres par exemple, mais certains, tel La chorale des maîtres bouchers, entremêlent les deux.
Il est difficile, à propos de Louise Erdrich, de parler de maturation ou d’épanouissement stylistique, mais possible d’entrevoir une évolution sociopolitique. Peut-être pas au palier des convictions, mais à celui de l’expression publique. D’une part, en effet, l’auteure offre dès ses premiers pas littéraires la fluidité et la profondeur d’une écriture adulte et parfaitement maîtrisée ; d’autre part, le regard qu’elle porte sur le monde amérindien se modifie au fil des ans, l’analysant d’abord sans référence aux autres acteurs politiques, pour le situer ensuite de façon critique dans le chassé-croisé étatsunien. Dans un premier temps, les caractéristiques amérindiennes sont décrites en toute candeur, lacunes et manies comprises ; les œuvres plus tardives souligneront de plus en plus durement la responsabilité de Washington, de la population blanche et de l’Église catholique dans les difficultés vécues par les Indiens et les Métis. L’humilité et l’effacement appartiennent à la première période : « Mais nous, les Indiens, nous avons tellement l’habitude des coups tordus intérieurs que nous nous contentons d’en rire. Nous naissons plus lourds, mais pas une balance ne suffirait à nous peser. Dès le premier jour, nous sommes coincés. L’histoire, les politiques personnelles, les mélanges des familles » (Bingo Palace). On sourira à la lecture des missives naïves que le vieux père Damien adresse directement au pape (Dernier rapport sur les miracles à Little No Horse), comme on partagera la douleur impuissante de la tribu blessée par le lynchage de quatre des siens (La malédiction des colombes), mais on ne s’étonnera pas si l’attitude la plus courante des Amérindiens côtoie la résignation : l’heure d’une résurgence des cultures amérindiennes n’avait pas encore sonné. L’alcool, le chômage, la frénésie du jeu, les démêlés avec la police bouchaient l’horizon. L’argent gouvernemental ajoutait ses mirages : il infléchissait sans vergogne les décisions de la tribu : « Oh, j’argumentai. Je fis tout mon possible. Mais l’argent du gouvernement se balançait devant leur nez. À la fin, dans mon rôle de président, on me présenta une lettre tapée à la machine qu’il me faudrait signer, donnant officiellement acte que Lulu était expulsée » (Love Medicine).
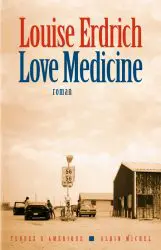 Presque vingt ans plus tard, le ton aura changé : « Nous sommes en 1823. Les États-Unis ont cent quarante-sept ans, et le pays tout entier est fondé sur la volonté de s’emparer des terres indiennes aussi vite que possible et d’autant de façons qu’on puisse humainement le concevoir. La spéculation foncière est la Bourse de l’époque. Tout le monde est dans le coup. George Washington, Thomas Jefferson » (Dans le silence du vent). La réparation n’a peut-être pas encore été offerte, mais elle est réclamée avec plus de vigueur. Surtout, on la réclame non comme une marque de pitié, mais au nom de l’élémentaire équité.
Presque vingt ans plus tard, le ton aura changé : « Nous sommes en 1823. Les États-Unis ont cent quarante-sept ans, et le pays tout entier est fondé sur la volonté de s’emparer des terres indiennes aussi vite que possible et d’autant de façons qu’on puisse humainement le concevoir. La spéculation foncière est la Bourse de l’époque. Tout le monde est dans le coup. George Washington, Thomas Jefferson » (Dans le silence du vent). La réparation n’a peut-être pas encore été offerte, mais elle est réclamée avec plus de vigueur. Surtout, on la réclame non comme une marque de pitié, mais au nom de l’élémentaire équité.
Conclure ou ne pas conclure ?
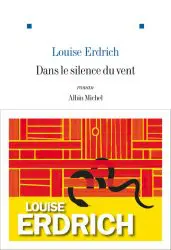 À mesure que s’étoffe la renaissance des nations amérindiennes aux États-Unis comme au Canada, des protestations émergent donc enfin à propos de crimes qu’ignorait hier encore la justice des Blancs. Louise Erdrich s’attaque à visière levée à plusieurs de ces hontes. Quand la mère de Joe est victime d’un viol brutal (Dans le silence du vent), la révolte de son jeune fils hésite entre deux avenues : d’un côté, Joe se révolte parce que son père, pourtant rompu aux roueries du système judiciaire de par sa fonction de juge, n’actionne pas aussitôt l’artillerie lourde ; Joe peinera avant de comprendre que son père sait la futilité de certains gestes. « L’ennui avec la plupart des affaires de viol sur les réserves indiennes c’était que même après qu’il y avait eu une accusation, le procureur fédéral refusait souvent d’amener l’affaire devant la justice, pour une raison ou pour une autre. […] Mon père voulait s’assurer que cela n’arriverait pas » (Dans le silence du vent). De l’autre côté, Joe ne se résigne pas à laisser le coupable impuni ; peu lui importe l’opinion des adultes. Son père a-t-il percé le secret et correctement décodé la situation de Joe ? Louise Erdrich ne commet pas l’erreur d’en dire trop. Elle met dans la bouche du père des propos soigneusement équivoques : « La personne qui a tué Lark [le coupable] vivra en endurant les retombées humaines de son acte parce qu’il a pris une vie. Comme je n’ai pas tué Lark, mais que je voulais le tuer, je dois tout au moins protéger la personne qui s’est chargée de cette tâche ». En confiant cette contestation de l’inaction et l’aventureuse reconquête de la justice à un Indien de treize ans, Louise Erdrich ausculte l’avenir.
À mesure que s’étoffe la renaissance des nations amérindiennes aux États-Unis comme au Canada, des protestations émergent donc enfin à propos de crimes qu’ignorait hier encore la justice des Blancs. Louise Erdrich s’attaque à visière levée à plusieurs de ces hontes. Quand la mère de Joe est victime d’un viol brutal (Dans le silence du vent), la révolte de son jeune fils hésite entre deux avenues : d’un côté, Joe se révolte parce que son père, pourtant rompu aux roueries du système judiciaire de par sa fonction de juge, n’actionne pas aussitôt l’artillerie lourde ; Joe peinera avant de comprendre que son père sait la futilité de certains gestes. « L’ennui avec la plupart des affaires de viol sur les réserves indiennes c’était que même après qu’il y avait eu une accusation, le procureur fédéral refusait souvent d’amener l’affaire devant la justice, pour une raison ou pour une autre. […] Mon père voulait s’assurer que cela n’arriverait pas » (Dans le silence du vent). De l’autre côté, Joe ne se résigne pas à laisser le coupable impuni ; peu lui importe l’opinion des adultes. Son père a-t-il percé le secret et correctement décodé la situation de Joe ? Louise Erdrich ne commet pas l’erreur d’en dire trop. Elle met dans la bouche du père des propos soigneusement équivoques : « La personne qui a tué Lark [le coupable] vivra en endurant les retombées humaines de son acte parce qu’il a pris une vie. Comme je n’ai pas tué Lark, mais que je voulais le tuer, je dois tout au moins protéger la personne qui s’est chargée de cette tâche ». En confiant cette contestation de l’inaction et l’aventureuse reconquête de la justice à un Indien de treize ans, Louise Erdrich ausculte l’avenir.
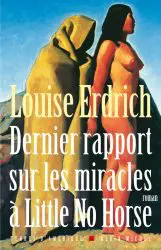 À la même jeune génération, Louise Erdrich confie encore autre chose : l’autonomie face au pouvoir religieux. L’immense mystification à laquelle s’adonne l’indestructible père Damien (Dernier rapport sur les miracles à Little No Horse) illustre l’emprise que l’Église catholique exerce sur nombre de tribus ; elle perd de sa poigne, mais impressionne toujours les générations adultes. En revanche, le quatuor d’adolescents qui conteste la justice publique (Dans le silence du vent) espionne le père Travis et ne se fait pas scrupule de le soupçonner de viol et de brutalité. Maladroitement, mais librement.
À la même jeune génération, Louise Erdrich confie encore autre chose : l’autonomie face au pouvoir religieux. L’immense mystification à laquelle s’adonne l’indestructible père Damien (Dernier rapport sur les miracles à Little No Horse) illustre l’emprise que l’Église catholique exerce sur nombre de tribus ; elle perd de sa poigne, mais impressionne toujours les générations adultes. En revanche, le quatuor d’adolescents qui conteste la justice publique (Dans le silence du vent) espionne le père Travis et ne se fait pas scrupule de le soupçonner de viol et de brutalité. Maladroitement, mais librement.
Des méandres aux rapides
Les romans de Louise Erdrich font alterner la confiante démesure du fleuve et les rapides où le flot se resserre et multiplie les risques. Le livre s’ouvre souvent sur un décor serein ou du moins stable, mais, au détour d’une péripétie, le drame frappe : l’auteure accélère la cadence, muscle ses phrases, rend la crise palpable et parfois terrifiante. Douleur et cruauté secouent ce qui était, un moment plus tôt, rassurant. Une enfant est jetée en pâture à la meute qui pourchasse le traîneau, une religieuse maquille en stigmate glorieux la blessure qu’elle vient d’infliger aux mains d’une adolescente, deux hommes se battent à mort pour la possession d’une femme, un chapelet sert à étrangler, etc.
Ainsi, au moment où la tribu s’adonne au bingo comme à son sport national régi par des règles connues et assagies et voit un jeune Indien gagner le véhicule qui constituait le gros lot, le racisme explose : cinq Blancs du Montana s’emparent du gagnant et trouvent drôle de lui faire tatouer contre son gré la carte de leur État sur le postérieur (Bingo Palace). Autre exemple, deux femmes (la mère et la fille) reçoivent le mandat d’évaluer et de vendre la collection d’art indien laissée par un défunt. Tout respire la modernité, la comptabilité sourcilleuse, le savoir-vivre des salons. Mais voilà qu’un vieux tambour retient l’attention de la plus jeune. Du coup, le tambour s’empare de l’avant-scène : sa fabrication, chacune de ses composantes, les ossements utilisés pour son assiette, son aura, tout y passe. Et surgit une scène aux confins du réel et du fantastique. Trois jeunes enfants sont seuls et le ventre vide dans une cambuse isolée où le chauffage épuise ses dernières gouttes de carburant. À distance, la mère flirte dans un bar et tente de troquer ses charmes contre un peu d’argent. Quand les enfants, dans leur effort pour réchauffer la maison, y mettent le feu, il leur faut chercher secours, à travers la neige et le froid, chez un voisin habitant à plusieurs kilomètres. À eux trois, à peine totaliseraient-ils quinze ans. La plus vieille, Shawnee, dirige l’expédition. Mission impossible. Les enfants croulent dans la neige et la mort s’annonce. Mais voilà que le tambour intervient. « Shawnee s’éveilla dans l’obscurité. Le martèlement d’un tambour lui interdisait de dormir, alors qu’elle en avait envie. […] Mais le tambour était sonore, insistant, un son plein qui l’agaçait. […] Ranimée par le tambour dès qu’elle s’apprêtait à renoncer, Shawnee continua à marcher » (Ce qui a dévoré nos cœurs). Au lendemain du drame, le propriétaire du tambour jure que l’instrument n’a émis aucun son… Superbe récit.
Ailleurs, c’est l’antipathique Tante, engluée dans sa détestation des drogues, qui refuse de révéler où elle a dissimulé la morphine que réclame la mourante. « En cet instant, Delphine suppliait véritablement du fond du cœur. Elle songea à tomber à genoux. La petite bouche froide de Tante se contracta, dans ses yeux luisait un inflexible triomphe. / ‘C’est sans importance, de toute façon, je l’ai vidée dans le lavabo’ » (La chorale des maîtres bouchers).
Autant de scènes où Louise Erdrich manifeste sa maîtrise de tous les rythmes littéraires et débusque les ultimes audaces des pires comme des meilleurs cœurs humains.
Des nouvelles tenaces
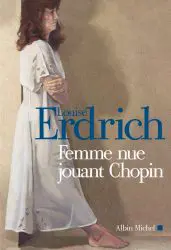 Plus romancière que nouvelliste, Louise Erdrich a publié deux recueils de nouvelles, La décapotable rouge et Femme nue jouant Chopin. Elle s’en explique : « […] il semble que la façon dont souvent (mais pas toujours) j’écris des romans consiste à commencer par des nouvelles dont je dois croire, à chaque fois, qu’elles sont terminées » (La décapotable rouge). Sort plausible, mais dont l’auteure elle-même conteste le réalisme : « La plupart des nouvelles de ce recueil sont ces textes embryonnaires qui n’ont pas voulu me lâcher » (ibid.). L’écrivaine hésite à les publier en recueil, car, reconnaît-elle, « nombre d’entre elles se trouvent dans [s]es romans » (ibid.). Un ami insiste pourtant et elle succombe à la proposition. Le lecteur de Louise Erdrich retrouvera ainsi dans ces deux recueils de nouvelles au moins une brassée de textes déjà insérés dans les romans. À chacun d’apprécier ou pas de tels doublons.
Plus romancière que nouvelliste, Louise Erdrich a publié deux recueils de nouvelles, La décapotable rouge et Femme nue jouant Chopin. Elle s’en explique : « […] il semble que la façon dont souvent (mais pas toujours) j’écris des romans consiste à commencer par des nouvelles dont je dois croire, à chaque fois, qu’elles sont terminées » (La décapotable rouge). Sort plausible, mais dont l’auteure elle-même conteste le réalisme : « La plupart des nouvelles de ce recueil sont ces textes embryonnaires qui n’ont pas voulu me lâcher » (ibid.). L’écrivaine hésite à les publier en recueil, car, reconnaît-elle, « nombre d’entre elles se trouvent dans [s]es romans » (ibid.). Un ami insiste pourtant et elle succombe à la proposition. Le lecteur de Louise Erdrich retrouvera ainsi dans ces deux recueils de nouvelles au moins une brassée de textes déjà insérés dans les romans. À chacun d’apprécier ou pas de tels doublons.
La forte voix de Louise Erdrich est de celles dont la littérature et le mieux-être social ont tous deux besoin : elle mérite le respect et l’admiration des plus vastes auditoires.
Livres évoqués dans ce texte :
Bingo Palace, Robert Laffont, 1996 ; Dernier rapport sur les miracles à Little No Horse, Albin Michel, 2003 ; La chorale des maîtres bouchers, Albin Michel, 2005 ; Ce qui a dévoré nos cœurs, Albin Michel, 2007 ; Love Medicine, Albin Michel, 2008 ; La malédiction des colombes, Albin Michel, 2010 ; Le jeu des ombres, Albin Michel, 2010 ; La décapotable rouge, Nouvelles choisies et inédites, 1978-2008, Albin Michel, 2012 ; Dans le silence du vent, Nouvelles choisies et inédites, 1978-2008, Albin Michel, 2013 ; Femme nue jouant Chopin, Albin Michel, 2014.
EXTRAITS
[Nestor] aurait pu lui expliquer que seule compte la terre, et lui recommander de ne jamais lâcher les documents, les titres, les traces des mots, toutes ces choses dont ses ancêtres n’avaient jamais compris qu’elles avaient un lien vital avec la terre et l’herbe sous leurs pieds.
Dernier rapport sur les miracles à Little No Horse, p. 257.
[…] être un Indien, c’est, d’une certaine façon, un imbroglio de paperasserie bureaucratique.
Par ailleurs, les Indiens se reconnaissent entre eux sans avoir besoin du pedigree fédéral, et cela – comme l’amour, le sexe, avoir ou ne pas avoir de bébé – n’a rien à voir avec le gouvernement.
Dans le silence du vent, p. 50.
[…] on sait que les tambours guérissent et on sait qu’ils tuent. Ils ne font plus qu’un avec leur gardien. Ils sont construits pour d’importantes raisons par des gens qui rêvent les détails de leur facture. Il n’y en a pas deux pareils, mais chaque tambour est apparenté à tous les autres tambours. Ils se parlent entre eux et offrent leurs chants aux humains.
Ce qui a dévoré nos cœurs, p. 55.
Les deux hommes tournaient maintenant avec une intensité figée, non pas tant de la rage qu’une vigilance froide et recueillie – pour tout, pour rien, pour quelque chose qu’ils n’admettraient pas avant que ce soit terminé, pour la honte, le ridicule de se battre pour une femme sur laquelle ils n’avaient de droit ni l’un ni l’autre…
La chorale des maîtres bouchers, p. 270











