Comme Camus, qui défendait ses causes en recourant à l’essai, au théâtre et au roman, Thomas King use de l’histoire, des nouvelles et du mythe pour dessiller les paupières du Blanc nord-américain et lui ouvrir la réalité indienne qu’il côtoie en la déformant.
Une telle salve prive ce même Blanc des excuses dont il se gargarise aujourd’hui encore pour justifier son ignorance. Et ses préjugés. Né à Sacramento, en Californie, en 1943, King vit aujourd’hui à Guelph, en Ontario. Peut-être peut-on lire dans ce destin binational le symbole d’un assaut mené contre une certaine Amérique à la fois canadienne et étatsunienne.
Un ton désarmant
Dès les premières pages de L’Indien malcommode, Un portrait inattendu des Autochtones d’Amérique du Nord1, l’empathie s’installe. King adopte, en effet, le ton de la conversation détendue et traite son lecteur en vis-à-vis respecté. Le je occupe un large espace, mais sans morgue ni nombrilisme. Une sympathique autodérision et une mémoire à cent lieues de la plainte sociopolitique désarment la critique : « Il y a une quinzaine d’années, une bande d’amis et moi avons fondé un groupe de tambour traditionnel ». Suivent quelques détails d’ordre géographique sur chacun des musiciens. King dévoile ainsi, malgré ce détour ou grâce à lui, un des axes majeurs de sa vision des choses : « Anichinabé, Métis, Salish de la côte, Cri, Cherokee. Nous n’avons pas grand-chose en commun. Nous avons le tambour et nous sommes tous autochtones. C’est tout ». De fait, King se repliera toujours sur ce constat : les Indiens ont beau appartenir à des centaines de tribus distinctes, ils partagent un dénominateur commun. Le problème sera que les Blancs, sans comprendre cette parenté, se permettent de définir et d’imposer les critères selon lesquels tel humain sera reconnu indien, mais pas son frère. Sur ce terrain, le Canada et les États-Unis partagent les mêmes torts et déploient leur autoritarisme avec la même brutalité.
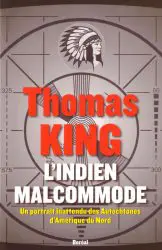 Le ton de King va-t-il, du coup, succomber à la colère et faire entendre une complainte douloureuse et rageuse ? Oui et non. Il étalera crûment les griefs des nations indiennes, mais il entretiendra savamment un climat civilisé. D’une part, en recourant à l’humour ; d’autre part, en intégrant à l’échange les vues de son épouse Helen. Les deux ingrédients se compénètrent d’ailleurs : « Helen, qui est toujours de bon conseil, a proposé que je coupe toutes les listes de moitié dans ce chapitre parce que, disait-elle, une liste n’a rien de très agréable, et puis dresser une liste, ça fait pédant. Évidemment, elle a raison. Mais moi, je voulais seulement voir ces noms écrits noir sur blanc et je voulais être sûr que vous les voyiez vous aussi ». Désarmant et efficace auprès du lecteur ; paix conjugale assurée.
Le ton de King va-t-il, du coup, succomber à la colère et faire entendre une complainte douloureuse et rageuse ? Oui et non. Il étalera crûment les griefs des nations indiennes, mais il entretiendra savamment un climat civilisé. D’une part, en recourant à l’humour ; d’autre part, en intégrant à l’échange les vues de son épouse Helen. Les deux ingrédients se compénètrent d’ailleurs : « Helen, qui est toujours de bon conseil, a proposé que je coupe toutes les listes de moitié dans ce chapitre parce que, disait-elle, une liste n’a rien de très agréable, et puis dresser une liste, ça fait pédant. Évidemment, elle a raison. Mais moi, je voulais seulement voir ces noms écrits noir sur blanc et je voulais être sûr que vous les voyiez vous aussi ». Désarmant et efficace auprès du lecteur ; paix conjugale assurée.
Entre ridicule et ségrégation
S’il est un secteur de l’univers étatsunien qui fait à l’Indien une place de choix, c’est celui du cinéma. Thomas King veille à rappeler les limites étroites de cette équivoque hospitalité. Il note que l’Indien est toujours l’ennemi, le perdant, l’humilié. Le faire-valoir du Blanc. L’humour qui caractérise sa plume allège pourtant ce qui penchait vers le pleur acerbe : les rôles dévolus aux Indiens dans le spectacle des États-Unis mettent en vedette aussi bien des acteurs blancs que d’authentiques Indiens. Ce qui, aux yeux de King, est doublement ridicule : d’une part, personne ne sait à quoi ressemble un Indien ; d’autre part, le public étatsunien ne sut jamais que son comédien le plus célèbre, Will Rogers, et sa vedette la plus adulée des médias était… un Indien. Rogers, souligne King, « a écrit plus de 4000 chroniques qui étaient relayées par plus de 600 journaux ». « Il n’y a qu’un petit problème ici, ajoute-t-il. Dans la cinquantaine de films qu’il a tournés, je ne crois pas que Rogers ait fait l’Indien une seule fois. Je ne me rappelle pas l’avoir déjà vu avec une coiffe de sachem sur la tête ou un tomahawk à la main. » Autrement dit, le public peut professer le mépris le plus virulent à l’égard de l’Indien sans savoir à quoi il ressemble et sans prendre conscience que son héros médiatique est, à son insu, un Cherokee qui ne joue jamais à l’écran ou au micro le rôle d’un Cherokee…
Le ridicule de la chose n’épuise pas la question. King précise, en tout cas, que cette société blanche, dressée contre l’Indien sans le connaître, s’est arrogé le droit, au Canada comme aux États-Unis, de parquer les Indiens dans des réserves, de diviser la population indienne en catégories scrupuleusement étanches et pourvues de droits différents, de retirer le titre d’Indien à ceux et celles qui ne se conformaient pas aux règles définies par les gouvernements blancs. « La culture populaire nord-américaine est littéralement bondée d’Indiens sauvages, nobles et agonisants, alors que, dans la vraie vie, il n’y a que des Indiens morts, des Indiens vivants et des Indiens en règle. » Comme quoi le racisme peut s’exercer aux dépens d’un humain à ADN variable.
Mais les traités…
 Les États-Unis et le Canada, après avoir oscillé entre le paternalisme et l’intrusion militaire et avoir sans cesse retouché la frontière entre l’Indien réel et ses multiples avatars imaginaires ou imposés, ont tenté de se donner bonne conscience en passant à la négociation et donc aux traités. Une fois de plus, Thomas King a beau jeu d’opposer la parole aux actes, les engagements aux oublis, les promesses aux gestes. « Cela dit, écrit-il, les ‘possibilités’ qu’on mentionne dans les documents gouvernementaux sont généralement des euphémismes pour dire : ‘Jamais de la vie.’ Et le ‘droit inhérent à l’autonomie gouvernementale’ est clarifié plus tard par le bémol suivant : Nulle loi adoptée par un gouvernement autochtone […] ne saurait être incompatible avec les lois essentielles au maintien de la paix, de l’ordre et du bon gouvernement au Canada. » Autrement dit, si collision il y a, le décret stipule que les décès endeuilleront le camp indien ! Les décrets n’engagent pas vraiment les Blancs. On regrettera que l’index du livre ne comporte aucune mention directe des innombrables traités.
Les États-Unis et le Canada, après avoir oscillé entre le paternalisme et l’intrusion militaire et avoir sans cesse retouché la frontière entre l’Indien réel et ses multiples avatars imaginaires ou imposés, ont tenté de se donner bonne conscience en passant à la négociation et donc aux traités. Une fois de plus, Thomas King a beau jeu d’opposer la parole aux actes, les engagements aux oublis, les promesses aux gestes. « Cela dit, écrit-il, les ‘possibilités’ qu’on mentionne dans les documents gouvernementaux sont généralement des euphémismes pour dire : ‘Jamais de la vie.’ Et le ‘droit inhérent à l’autonomie gouvernementale’ est clarifié plus tard par le bémol suivant : Nulle loi adoptée par un gouvernement autochtone […] ne saurait être incompatible avec les lois essentielles au maintien de la paix, de l’ordre et du bon gouvernement au Canada. » Autrement dit, si collision il y a, le décret stipule que les décès endeuilleront le camp indien ! Les décrets n’engagent pas vraiment les Blancs. On regrettera que l’index du livre ne comporte aucune mention directe des innombrables traités.
… et les paraboles
Autant sont nets les propos prêtés par Thomas King à son Indien malcommode, autant sont déroutantes ses nouvelles. Non qu’elles soient vides de sens, mais parce qu’elles peuvent en revêtir plusieurs. Même le titre du recueil, Une brève histoire des Indiens au Canada2 prête à confusion. Le livre identifie les revues et stations de radio qui diffusèrent la version initiale de chacune des nouvelles, mais ne situe pas ces présentations dans le temps. Le lecteur ne sait pas non plus quelles tendances baignent ces médias. Sont-ils extrémistes ? Modérés ? Spécialisés dans les soucis autochtones ? Dans ces conditions, espérer que surgisse d’une macédoine par ailleurs délectable une histoire cohérente de la réalité indienne au Canada serait un leurre. D’autant plus que certaines des nouvelles, par exemple « Si j’avais une chienne, je l’appellerais Helen », « Petites bombes » ou « Les méchants qui aiment Jésus », pourraient honorer n’importe quelle tribune, tant elles ignorent les enjeux indiens. Le livre y perd son unité, et c’est dommage, car plusieurs textes sont d’admirables fables sur les drames indiens. Par exemple, « Le bébé livré par avion » ou « Coyote et les sujets d’un pays ennemi ».
Une puissante cosmogonie
 Que les préjugés se taisent : la cosmogonie indienne n’a rien à envier à ses consœurs. Quand tel dictionnaire décrit la cosmogonie comme l’« idée que se firent de l’origine du monde les anciens poètes et les sages de la Grèce », il se montre indûment sélectif. Thomas King, quelque peu dispersé dans son recueil de nouvelles, renoue dans son dernier roman avec son plaidoyer central et déploie dans toute sa majesté l’immense récit qui donne à la culture indienne d’Amérique du Nord un Olympe plus respectable que l’original. Il est même probable que le lecteur peu familier avec les mythes indiens (comme moi) n’en saisira pas toute la richesse. La distance apparente entre le titre porté par l’édition originale anglaise (Doubleday Canada, 2014) et la présente traduction (Mémoire d’encrier, 2016) témoigne déjà de ce risque. En effet, là où l’original anglais arbore en titre The Back of the Turtle, le français opte pour La femme tombée du ciel3. Contradiction ? Pas du tout : regards distincts, mais convergents sur le même mythe.
Que les préjugés se taisent : la cosmogonie indienne n’a rien à envier à ses consœurs. Quand tel dictionnaire décrit la cosmogonie comme l’« idée que se firent de l’origine du monde les anciens poètes et les sages de la Grèce », il se montre indûment sélectif. Thomas King, quelque peu dispersé dans son recueil de nouvelles, renoue dans son dernier roman avec son plaidoyer central et déploie dans toute sa majesté l’immense récit qui donne à la culture indienne d’Amérique du Nord un Olympe plus respectable que l’original. Il est même probable que le lecteur peu familier avec les mythes indiens (comme moi) n’en saisira pas toute la richesse. La distance apparente entre le titre porté par l’édition originale anglaise (Doubleday Canada, 2014) et la présente traduction (Mémoire d’encrier, 2016) témoigne déjà de ce risque. En effet, là où l’original anglais arbore en titre The Back of the Turtle, le français opte pour La femme tombée du ciel3. Contradiction ? Pas du tout : regards distincts, mais convergents sur le même mythe.
Contrairement au Noé de la Bible, qui cherche ses repères dans un sol noyé par le déluge, de multiples tribus indiennes d’Amérique du Nord situent au ciel l’origine de la vie et des vivants. La chute que fit la femme pour échapper à un ours ne s’arrêta qu’en rencontrant ici-bas le dos d’une énorme tortue. Grâce au concours des animaux amphibies, un sol fécond s’étendit peu à peu sur le dos de la tortue. Ainsi le veut cette cosmogonie. Contre cette toile de fond, King bâtit un récit grandiose, confiant, moderne. En renaissant avec vigueur, la culture indienne se porte à la défense de la terre agressée par les conglomérats obèses et dévastateurs : « Les Indiens sont de retour. Bientôt les oiseaux repeupleront le ciel, les poissons la mer, les animaux la terre ; deux par deux, grands et petits, ils reviendront tous. […] En esprit, Sonny voit tout ce beau monde rassemblé sur la plage à attendre le second avènement des tortues ». La nature sera mieux défendue. Le consortium Domidion, responsable de déversements meurtriers, perdra son expert Gabriel Quinn, culpabilisé par la témérité de ses initiatives et ne ralentira sa dégringolade que grâce aux mensonges de ses relationnistes et au culte des médias pour la tragédie de demain.
Histoire, nouvelles, roman, Thomas King ne se borne pas à réclamer le respect de l’Indien, il rend ses nations dignes d’admiration. Il ose même l’optimisme.
Voir aussi : Approches diverses de l’« indianité » II : L’œuvre de Louise Erdrich
1. L’Indien malcommode, Un portrait inattendu des Autochtones d’Amérique du Nord, Boréal, Montréal, 2014, trad. de l’anglais par Daniel Poliquin, 320 p. ; 25,95 $.
2. Une brève histoire des Indiens au Canada, Boréal, Montréal, 2014, trad. de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, 29 4p. ; 24,95 $.
3. La femme tombée du ciel, Mémoire d’encrier, Montréal, 2016, trad. de l’anglais par Caroline Lavoie, 632 p. ; 34,50 $.
EXTRAITS
Cette version mi-siècle du colonialisme avait pour nom « cessation », et elle devint la politique officielle du gouvernement américain en 1953… […]
Pendant les treize années qui suivirent, le processus de cessation se répandit en Amérique comme la peste. Avant qu’on ne mette fin à cette politique, en 1966, 109 tribus avaient cessé d’exister, et un autre million d’acres de terres indiennes avaient été perdues.
L’Indien malcommode, p. 157.
J’ai pensé achever mon livre sur une note optimiste. […]
Cela étant dit, deux sujets d’actualité sont revenus régulièrement dans nos conversations : l’Alaska Native Claims Settlement Act (ou Loi sur le règlement des revendications foncières des Autochtones de l’Alaska) et l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
L’Indien malcommode, p. 281.
Une femme. Il n’aurait su dire avec certitude s’il s’agissait de l’une des deux Pieds-Noirs qu’il avait achetées aux enchères sur Internet ou de la jeune Crie que son frère Bert lui avait envoyée pour leur trentième anniversaire de mariage.
Une brève histoire des Indiens au Canada, p. 21.
On n’a pas pu l’incinérer. Trop toxique. Sites d’enfouissement, bouchons d’argile imperméable, puits d’injection, hors de question ça aussi. […]
On l’a donc mis en baril et envoyé à notre entrepôt de Tadoussac.
Au Québec ?
Oui.
Au moins, on sait où il se trouve.
La femme tombée du ciel, p. 522.











