Emmanuel Robin vit le jour en 1900 à Babeuf, en Haute-Picardie, et fut élevé par une mère institutrice, en l’absence d’un père parti peu après sa naissance ; admis en rhétorique supérieure au lycée Henri-IV, à Paris, il lia amitié avec Pierre Bost1 et Jean Prévost2.
Bientôt professeur de lettres en province, il se mit à la rédaction de son premier roman en 1927, Accusé, lève-toi, publié deux ans plus tard aux éditions Plon (le roman a été réédité sous le titre L’accusé chez Phébus en 1986). Bost, dédicataire du roman3, avait publié en 1925 Homicide par imprudence qui, s’il ne se déroule absolument pas dans le même milieu social que L’accusé, n’en développe pas moins ce thème de la « mauvaise conscience » qui marque en plein l’œuvre de Robin, thème combiné avec une certaine aboulie du personnage principal, certes plus gai que celui de L’accusé mais à peu près aussi inconséquent. Peu ou prou, ces auteurs, avec d’autres, furent considérés comme les fils spirituels de Dostoïevski4. C’est vraisemblablement à cause de cette proximité du récit de Robin avec l’inquiétude du romancier russe quant au mal, à la faute, à la culpabilité que des écrivains catholiques sombres, comme Georges Bernanos et François Mauriac, lui réservèrent le meilleur accueil ; et ce n’est pas pour rien non plus que put être convoqué, par comparaison, le nom de Julien Green5.
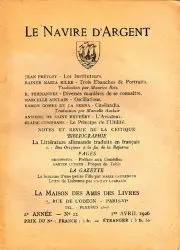 Quelle est la « situation » de Robin en 1929 ? Il a fait de modestes débuts, en 1924, dans la revue d’Adrienne Monnier, Le Navire d’Argent ; puis, quelques mois avant la publication d’Accusé, lève-toi, il donne à la revue Europe une courte nouvelle, « Bonheur », qui ne laisse en rien présager du roman à paraître tant le style en est gauche et mièvre. Une telle disparate se retrouvera lorsque, pressé par son éditeur, Robin finira par lui céder un deuxième roman, Catherine Pecq (1933), qui n’est pas entièrement dénué de qualités6, mais ne fait pas vraiment regretter que L’accusé soit resté le « seul » livre de notre auteur, pas plus que la longue nouvelle parue, toujours dans Europe, mais en 1939 cette fois, « Histoire de la mort ». De fait, pour des raisons à la fois personnelles et esthétiques, il semble qu’Emmanuel Robin n’ait pu ou voulu donner tout son talent que dans un unique ouvrage, cet Accusé dont il faut reconnaître qu’il est fort singulier.
Quelle est la « situation » de Robin en 1929 ? Il a fait de modestes débuts, en 1924, dans la revue d’Adrienne Monnier, Le Navire d’Argent ; puis, quelques mois avant la publication d’Accusé, lève-toi, il donne à la revue Europe une courte nouvelle, « Bonheur », qui ne laisse en rien présager du roman à paraître tant le style en est gauche et mièvre. Une telle disparate se retrouvera lorsque, pressé par son éditeur, Robin finira par lui céder un deuxième roman, Catherine Pecq (1933), qui n’est pas entièrement dénué de qualités6, mais ne fait pas vraiment regretter que L’accusé soit resté le « seul » livre de notre auteur, pas plus que la longue nouvelle parue, toujours dans Europe, mais en 1939 cette fois, « Histoire de la mort ». De fait, pour des raisons à la fois personnelles et esthétiques, il semble qu’Emmanuel Robin n’ait pu ou voulu donner tout son talent que dans un unique ouvrage, cet Accusé dont il faut reconnaître qu’il est fort singulier.
Un roman en forme de confession
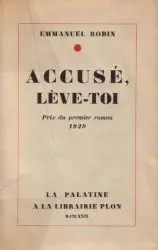 À comparer l’édition de 1929 d’Accusé, lève-toi avec celle de L’accusé, la première différence visible est la disparition d’un prologue dans lequel se mettait en place un régime narratif de la confession, voire de l’aveu : « […] vous m’excuserez de parler un peu de mon enfance. Même quand je vous parlerai de cet âge relativement innocent, n’oubliez pas de penser à chaque phrase : c’est un criminel qui parle. Oui, un criminel, même à cet âge-là ». L’adresse au lecteur s’achevait par une demande insolite puisque le narrateur, au lieu de réclamer l’indulgence et le pardon pour une faute que le récit va révéler, déclare : « […] je vous prie […] de ne pas détourner votre esprit de cette tâche […] : me juger ».Ce qui laissait entendre que l’accusation annoncée par le titre émanait aussi bien de la procédure judiciaire que du procès intenté au personnage-narrateur par sa – mauvaise – conscience même, attitude qui le caractérise et qui le rapproche, en amont, du Procès de Kafka ou, en aval, de La chute de Camus ; cette disposition mentale est corroborée par la fin du livre, en forme de post-scriptum, où la culpabilité du criminel est envisagée par lui-même comme un état sans rémission. Car la véritable culpabilité réside non dans le délit mais dans l’ignorance des raisons qui l’ont provoqué (« […] on m’a demandé de donner les raisons de mon crime […] je voyais avec évidence que je n’avais aucune raison à donner à mon acte »). Le lecteur comprend alors que c’est à lui, en tant qu’il est interpellé dans le récit, de se substituer à la fois à l’accusé et aux hommes de loi afin de démêler les motifs du meurtre décrit aux dernières pages : le texte liminaire était sans doute trop explicite en ce sens, la deuxième version installant plus subtilement cette relation entre l’espace du dedans et celui du dehors. Et, au terme de l’entreprise, force est de constater que l’ignorance avouée du narrateur n’est que feinte et que sa confession apparemment dénuée de toute explication les contient toutes, du point de vue psychologique et dramatique.
À comparer l’édition de 1929 d’Accusé, lève-toi avec celle de L’accusé, la première différence visible est la disparition d’un prologue dans lequel se mettait en place un régime narratif de la confession, voire de l’aveu : « […] vous m’excuserez de parler un peu de mon enfance. Même quand je vous parlerai de cet âge relativement innocent, n’oubliez pas de penser à chaque phrase : c’est un criminel qui parle. Oui, un criminel, même à cet âge-là ». L’adresse au lecteur s’achevait par une demande insolite puisque le narrateur, au lieu de réclamer l’indulgence et le pardon pour une faute que le récit va révéler, déclare : « […] je vous prie […] de ne pas détourner votre esprit de cette tâche […] : me juger ».Ce qui laissait entendre que l’accusation annoncée par le titre émanait aussi bien de la procédure judiciaire que du procès intenté au personnage-narrateur par sa – mauvaise – conscience même, attitude qui le caractérise et qui le rapproche, en amont, du Procès de Kafka ou, en aval, de La chute de Camus ; cette disposition mentale est corroborée par la fin du livre, en forme de post-scriptum, où la culpabilité du criminel est envisagée par lui-même comme un état sans rémission. Car la véritable culpabilité réside non dans le délit mais dans l’ignorance des raisons qui l’ont provoqué (« […] on m’a demandé de donner les raisons de mon crime […] je voyais avec évidence que je n’avais aucune raison à donner à mon acte »). Le lecteur comprend alors que c’est à lui, en tant qu’il est interpellé dans le récit, de se substituer à la fois à l’accusé et aux hommes de loi afin de démêler les motifs du meurtre décrit aux dernières pages : le texte liminaire était sans doute trop explicite en ce sens, la deuxième version installant plus subtilement cette relation entre l’espace du dedans et celui du dehors. Et, au terme de l’entreprise, force est de constater que l’ignorance avouée du narrateur n’est que feinte et que sa confession apparemment dénuée de toute explication les contient toutes, du point de vue psychologique et dramatique.
Composition et style
L’ouvrage est divisé en six chapitres, de longueur très inégale entre les cinq premiers et le dernier – à peine dix-sept pages sur plus de deux cents –, déséquilibre justifié si l’on s’attache moins au souci romanesque qu’à la logique démonstrative : une fois retracées les circonstances susceptibles de faire du personnage un criminel, il n’y a plus qu’à le laisser s’exécuter dans le même temps, brutal et bref, qu’il tue sa victime ; et pour que la machine infernale déroule parfaitement son ressort, il fallait que le meurtre paraisse fortuit, ce qu’il n’est évidemment pas, et qu’on évalue, a contrario, la préparation souterraine d’un assassinat qui, s’il ne peut pas être qualifié de prémédité, est pour le moins annoncé. Le premier chapitre pourrait s’intituler « Le roman familial », dans la mesure où il dessine le triangle père-mère-fils ; le deuxième, narrant une fugue du héros encore enfant, tourne à l’aventure dans un esprit proche de ces romans de l’adolescence qui ont marqué le début des années 1920, après Le grand Meaulnes d’Alain-Fournier7, Le premier de la classe de Benjamin Crémieux, L’inquiète adolescence de Louis Chadourne ou encore L’enfant inquiet d’André Obey ; puis vient la mort de la mère, précédant la fuite du héros, se décidant à quitter définitivement son père. Là se situe l’acmé du récit puisque, dès ce moment, commence la descente aux enfers, sur les plans social, moral et mental, l’avant-dernier chapitre décrivant comment le narrateur, employé dans un hôtel, vole son patron, jette l’argent dans un puits et laisse accuser la servante dont il est amoureux. Acte gratuit ? Certainement pas quand on assiste, au dernier chapitre, à un deuxième vol, bien plus crapuleux cette fois quoique tout aussi stupide – les 5000 francs dérobés sont perdus en une seule mise à la roulette –, au coup fatal porté à un chien en train de se noyer et à l’agression de Louise, une ancienne connaissance devenue maîtresse d’une nuit. Cela fait beaucoup pour quelques pages mais, nous l’avons dit, il s’agissait de précipiter la catastrophe à l’issue d’une gestation parfois lente.
Le principe adopté par Robin joue sur la porosité d’une frontière fictive entre la voix intérieure et un point de vue externe qui serait celui du lecteur/confident : « Je continue. Patience, nous arriverons toujours trop tôt au bout. Encore est-il heureux que je n’aie pas à vous apprendre que je l’ai assassinée / C’est une chose que je n’ai plus à dire, puisque vous l’avez lue dans les journaux. / Là-dessous, j’ai envie de mettre la date, de signer, puis de cesser d’écrire ». On perçoit bien l’intention de l’auteur de créer une confusion entre le temps « réel » de l’histoire vécue et celui de la confession, forcément plus distendu puisque tout entier tourné vers le passé du narrateur, censé éclairer sa personnalité ; et c’est, effectivement, du récit d’enfance que relève, en tant que genre, le roman pour les trois quarts de sa durée. Là encore, le fonctionnement est complexe dans la mesure où l’on a affaire d’une part au souvenir du premier degré, puis à un mécanisme qui fait jouer deux époques au sein de l’histoire et en ajoute une tierce qui est celle de la narration : « Je trouve encore de ces détails qui me reviennent quand j’écris ». À cela s’ajoute une quatrième dimension, celle, purement littéraire, de l’édification sur des ruines, voire sur du rien, ainsi que l’atteste l’incipit : « Personne ne m’a raconté ma petite enfance ». Ce qui suffirait à prouver le « peu de réalité », dirait André Breton, de la prétendue chronique d’un fait divers. Car, si c’est bien de fiction qu’il s’agit, on repère vite ce qui excède une simple « déposition », particulièrement pour la transcription des détails, grâce à des touches qui font inévitablement penser à Emmanuel Bove : « […] c’était une paire de chaussures neuves : les fils jaunes qui apparaissaient sur les bords n’étaient pas encore recouverts de cirage ». Sans doute est-ce ce second degré de l’écriture qui n’a pas été suffisamment perçu lors de la réception du livre au bénéfice d’une lecture plus dramatique, entièrement justifiée mais trop attachée au réalisme ; c’est ne pas mesurer la distance ironique voulue par l’auteur dans des notations qui semblent un miroir tendu au texte en train de s’écrire : « […] comment pourraient-ils croire à l’authenticité de ce roman que je jugeais exceptionnel […] ? » N’y a-t-il pas là un avertissement quant au caractère soi-disant authentique de la confession ? Cependant, d’autres sentences, bien timbrées, donnent au roman son accent grave, qui permet d’en percevoir la tonalité profonde : « Il me reste l’espérance noire d’une mort qui finisse tout ».
Une tragédie antique
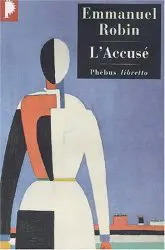 Voilà qui, prononcé dans le post-scriptum, donne à l’histoire sa dimension tragique, inaugurée par la disposition œdipienne du narrateur-enfant, la rivalité classique entre le fils et le père nourrissant une hostilité réciproque ; aux insultes du premier – « imbécile », « fou », « idiot », « crétin », « fainéant » –, répond la pensée intime du second : « Par-dessus tout je voulais éviter de ressembler à mon père ». Tout cela paraîtrait fort banal – mais le freudisme n’était pas encore vraiment de saison – si la psychologie du narrateur n’obéissait qu’à ce tropisme ; or, quelques pages à peine après le début, c’est contre lui-même qu’il commence à prononcer un réquisitoire apportant les preuves de sa cruauté et de sa culpabilité.
Voilà qui, prononcé dans le post-scriptum, donne à l’histoire sa dimension tragique, inaugurée par la disposition œdipienne du narrateur-enfant, la rivalité classique entre le fils et le père nourrissant une hostilité réciproque ; aux insultes du premier – « imbécile », « fou », « idiot », « crétin », « fainéant » –, répond la pensée intime du second : « Par-dessus tout je voulais éviter de ressembler à mon père ». Tout cela paraîtrait fort banal – mais le freudisme n’était pas encore vraiment de saison – si la psychologie du narrateur n’obéissait qu’à ce tropisme ; or, quelques pages à peine après le début, c’est contre lui-même qu’il commence à prononcer un réquisitoire apportant les preuves de sa cruauté et de sa culpabilité.
La pulsion destructrice du protagoniste est en effet révélée de différentes manières, d’abord par l’ambivalence des sentiments éprouvés à l’égard de sa mère, puis par la violence exercée sur un camarade de classe (« je lui frappai sauvagement la figure »). C’est cet épisode qui va déclencher la crise et préparer la rupture du narrateur avec son milieu familial ; le domicile paternel quitté, commence la progression vers l’évidence de l’acte final : « […] lorsque j’entendis des bruits de seau de toilette, j’aurais eu plaisir à tuer Louise », désir enfin assouvi au dénouement. Aussi, est-ce par ce biais que l’on peut situer le roman de Robin au plein du courant noir des années 1920-1930 et le considérer comme précurseur de l’existentialisme en littérature puisque, au moins pour la figure de l’antihéros, on va bien là du côté de Sartre. À ce dernier, on peut en effet emprunter son concept de « nausée » afin de montrer à quel point L’accusé exprime l’écœurement, de la sensation au sentiment, devant toute forme de réalité. L’emploi récurrent des termes « répulsion », « dégoût » traduit une disposition mentale d’un personnage très proche du nihilisme attiré, par ailleurs, par les coins sombres et les pièces fermées, annonçant la réclusion des personnages de Samuel Beckett.
D’où l’intérêt de relire l’œuvre d’Emmanuel Robin, même si elle ne vaut que pour un titre, afin de mieux saisir l’originalité d’un auteur oublié mais aussi sa participation à un mouvement littéraire dont quelques noms seulement demeurent connus dans la vulgate ; Robin, avec son Accusé, a marqué d’une belle pierre basaltique le roman du premier vingtième siècle qui vit s’imposer le désenchantement comme lecture du monde et, à cause d’une mauvaise conscience prégnante, la conviction que, fût-ce sans le savoir, les hommes sont tous des « fils de Caïn8 ».
1. Deux de ses romans ont été réédités récemment, Porte-malheur par Le Dilettante (Paris, 2009) et Faillite par La Thébaïde (Paris, 2013), tous deux préfacés par François Ouellet.
2. Pour ce qui est de sa production romanesque, Gallimard a repris Les frères Bouquinquant (1930) dans « L’Imaginaire » en 1999 ; Zulma, Le sel sur la plaie (1934) et La chasse du matin (1937) respectivement en 1993 et 1994.
3.« À PIERRE BOST son ami E. R. » ; juste retour puisque Robin avait été lui-même, avec Jean-Antoine Pourtier et Emmanuel Signoret, le dédicataire d’Homicide par imprudence. Bost a donné des comptes rendus du roman de Robin dans Les Nouvelles littéraires (1er juin 1929, p. 4) et dans Jazz (15 novembre 1929, p. 510).
4. Dont l’influence sera rappelée, après 1945, notamment par le célèbre article de Nathalie Sarraute « De Dostoïevski à Kafka » (Les Temps modernes, no 25, octobre 1947 ; repris dans L’ère du soupçon, Gallimard, « folio essais », 1987, p. 15-55) lorsque le débat sur les origines de l’« absurde » dans le roman français animera les grandes revues de l’époque.
5. Ces trois auteurs-là constituèrent, aux côtés d’André Maurois et de Jean Giraudoux, le jury du Prix du Premier Roman, créé par les éditions Plon et La Revue Hebdomadaire, décerné pour la première fois en 1929 à l’Accusé, lève-toi, publié chez… Plon.
6. Telles que les lui reconnaît Pierre Bost dans sa chronique de L’Europe Nouvelle (29 juillet 1933, p. 716-717).
7. Dans le chapitre IV, lorsque le narrateur découvre « l’île aux enfants », le souvenir d’Alain-Fournier est sensiblement présent ; les expressions qui, dans la suite du récit, entretiennent la nostalgie de ce paradis entrevu une seule fois jouent comme autant de résonances : « le souvenir de la fête obscure », « l’île abandonnée ».
8. La formule est de Paul Gadenne, dans son roman La plage de Scheveningen (Gallimard, 1952), méditation sur la condamnation à mort d’un personnage inspiré de Robert Brasillach.
Emmanuel Robin a publié : Accusé, lève-toi, Plon, 1929, et sous le titre de L’accusé, Phébus, 1986, et collection de poche « Libretto », 2003 ; Catherine Pecq, Plon, 1933.
EXTRAITS
Le train pénétra dans une région nivelée où les stations devenaient fréquentes. Tout ce que j’étais accoutumé à voir dans un paysage se fit de plus en plus rare et finit par manquer. Les arbres, au lieu de s’éparpiller, étaient parqués dans des bois minuscules découpés géométriquement. Les prairies avaient disparu ; les champs eux-mêmes perdaient du terrain. Des groupes de maisons basses s’aggloméraient aux carrefours des chemins et collaient aux routes. Jusqu’à l’horizon une ville formée de ces bandes disséminées s’étendait et la terre plate des champs avait l’aspect des terrains vagues où l’on va bâtir.
Les rivières aux eaux noires et stagnantes – des canaux peut-être ? – ne se cachaient pas au fond des vallées ; les collines avaient disparu ; l’eau, à laquelle nulle pente ne commandait plus, reposait sur ces plateaux comme une glissière de métal sur laquelle avançaient des péniches et, comme si elle avait perdu toute vertu nourricière, ses bords restaient secs et désolés, affreux comme des cils et des paupières brûlés.
Parfois le train, penché dans les courbes, tournait autour du vaste écueil d’une usine. D’immenses bâtiments noirs de suie reposaient en pleins champs. Leur amalgame de briques, de ferrailles, de cheminées, traversé de rails luisants et taché de flaques d’eau, semblait les débris d’une catastrophe.
L’accusé, p. 146.
Le souvenir des quelques années que j’ai passées dans cette ville est confus. Par un phénomène curieux, ces années proches de moi offrent des actions, des figures qui me reviennent en désordre, qui se pressent en moi sans que je sache les distinguer ; certains détails m’apparaissent, mais je ne retrouve qu’avec peine la suite des événements.
Il me semble que certains sentiments m’étouffaient ; mais je ne conserve de leur passage en moi qu’un grand malaise et leurs causes m’ont échappé. Bref, à ce moment de mon histoire, je ne trouve que peu de suite et je ne veux pas la chercher.
Il me faudrait faire un calcul pénible pour reconstituer approximativement ce à quoi mon temps fut employé. Certaines de mes anciennes années ont un visage, des traits marqués qu’évoque leur numéro. Les dernières sont des chiffres vides. J’ai éveillé bien des soupçons parce que je ne pouvais répondre aux questions les plus simples touchant ma vie pendant l’année écoulée ou l’année qui la précédait. Ma vue est brouillée lorsque je la pose si près et j’ai honte de cela comme d’une infirmité. Le juge d’instruction s’est irrité de m’entendre lui répéter : « Je ne me souviens pas » ; et mon humilité n’a jamais pu le convaincre que je ne cherchais pas à dissimuler.
L’accusé, p. 169-170.
Louise tressaillit parce qu’elle nous croyait seuls. « Tu veux bien que je reste ? » me chuchota-t-elle à l’oreille. Je la repoussai brutalement et elle glissa à terre.
Elle ne dit plus rien ; elle s’allongea sur le plancher et me laissa dormir.
Dans mon sommeil, je sentis soudain son corps à côté du mien. Elle se pressait contre moi et je lui cédai. Mon plaisir fut brutal et court.
J’étais bien réveillé. Elle se pâmait dans l’ombre et poussait des cris inarticulés. Elle tenait à moi comme une sangsue.
Je la giflai d’abord maladroitement, mais elle sembla n’avoir rien senti. Alors, d’un coup de reins, je me redressai, et elle avec moi, et saisissant sa tête des deux mains, je la fis retomber sur la barre de fer du lit.
Elle gémit et j’eus peur. Je pensai avec horreur qu’elle allait peut-être se dresser avec sa tête fendue d’où le sang coulait. Je saisis le poids qui fermait la porte et je lui pilonnai le crâne, tout hagard et suant d’effroi.
Je m’enfuis sans voir ni savoir. J’entendais continuellement ses os craquer.
L’accusé, p. 212.
La vie libre ? quelle dérision que cette liberté. Se réveiller le matin sans une tâche, sans un espoir, sans un désir et se replonger dans le sommeil – les jours où l’argent ne manque pas – jusqu’à en être écœuré ; […] remuer dans son cœur ou dans son ventre des chaleurs puantes et attendre, comme une fatalité, en fermant les yeux et avec dégoût, l’heure où on retombera dans ses vices. […] Où trouver en moi la force d’un regret ? Non, ce sang versé, cette bête affreuse qui frappait la victime, l’obscur souvenir de ma folie me remplissent d’horreur. Je n’ai pas le droit de parler de regret ni de repentir, parce que je sais que ce crime et non pas celui-là seul, mais dix, mais cent autres m’attendent et que je leur obéirai. […] Aucun pardon ne peut descendre jusqu’à moi ; le pardon ne peut pas me toucher.
L’accusé, p. 217-219.











