Après avoir piloté son enquêteur fétiche pendant presque une décennie au creux d’un Montréal agité, Maxime Houde a décidé en 2014 de changer à la fois de vedette et d’époque. Un an plus tard, il ressuscitait Stan Coveleski et revenait à l’atmosphère des années 1940-1950. Heureuse révision.
Flics ou truands ?
Le Montréal de la décennie 1940 laisse poreuse la frontière entre les criminels et la force policière. La prostitution, avec son Red Light, occupe le quartier que recouvre aujourd’hui Radio-Canada et elle y prospère grâce à une fervente complicité entre les souteneurs et les porteurs d’uniformes. Rigoureux et imperturbable, Maxime Houde observe cette osmose.
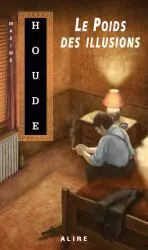 Contre cette toile de fond gluante, Houde raconte le pitoyable destin de Stan Coveleski, tombé du statut de policier à celui de loque humaine à la suite de la mort de son épouse. Dans Le poids des illusions1, un veuf amoché s’asphyxie dans le marécage montréalais. L’homme tente de se recycler en détective privé, mais son ancien milieu de travail garde souvenance et rancune de sa défunte probité et stérilise à plaisir toutes ses initiatives. L’alcool parachève l’érosion. Houde ne rend pas Coveleski larmoyant, mais aucun de ses lecteurs ne parierait un dollar sur le redressement du policier déchu. C’est alors que l’auteur jette dans la balance le solide et généreux soutien du sergent-détective Maranda : malgré les eaux glauques du Montréal interlope et la corruption policière généralisée, Coveleski voit surgir un espoir de rédemption. Le récit est à la fois plausible et invraisemblable, émouvant et caustique.
Contre cette toile de fond gluante, Houde raconte le pitoyable destin de Stan Coveleski, tombé du statut de policier à celui de loque humaine à la suite de la mort de son épouse. Dans Le poids des illusions1, un veuf amoché s’asphyxie dans le marécage montréalais. L’homme tente de se recycler en détective privé, mais son ancien milieu de travail garde souvenance et rancune de sa défunte probité et stérilise à plaisir toutes ses initiatives. L’alcool parachève l’érosion. Houde ne rend pas Coveleski larmoyant, mais aucun de ses lecteurs ne parierait un dollar sur le redressement du policier déchu. C’est alors que l’auteur jette dans la balance le solide et généreux soutien du sergent-détective Maranda : malgré les eaux glauques du Montréal interlope et la corruption policière généralisée, Coveleski voit surgir un espoir de rédemption. Le récit est à la fois plausible et invraisemblable, émouvant et caustique.
Têtu et fragile
Grâce à Maranda, Coveleski retrouve, dans L’infortune des bien nantis2, un brin de son ancienne efficacité. Pas au sein de la police, mais comme détective privé. Sans brusquer les transitions, Houde témoigne, jusque dans son écriture, du changement survenu chez Coveleski. Un certain humour, impensable dans le bouquin précédent, émerge chez le convalescent : « On accédait à l’entrée, située en retrait, en franchissant deux colonnes surmontées par des gargouilles aux crocs acérés. Ces bêtes jugèrent que je n’étais pas dangereux car, à mon passage, elles restèrent sur leur perchoir ».
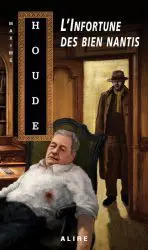 Autour de Coveleski, le romancier fait évoluer Montréal. Pendant que Pax Plante et Jean Drapeau tisonnent un réveil de la moralité publique et que Duplessis fait appel aux policiers provinciaux pour étouffer les réclamations syndicales, la métropole québécoise oscille entre le balayage et l’enlisement. Une fois encore, Houde excelle à mener de front, d’une part, le destin d’un homme meurtri et en quête de guérison et, d’autre part, les enquêtes qui, comme la commission Caron, exhument les sédiments de la corruption montréalaise ; il réussit même à pousser l’enquête de Coveleski jusqu’à la porte de l’hôtel de ville sans jamais torturer la vraisemblance. Par une implacable logique d’auteur, il rompra la relation entre Maranda et Coveleski et exigera de son détective privé des gestes répugnants ; Montréal et la conscience de Coveleski seront tous deux traités sans recours à la guimauve. On peut même se demander si Houde salit Coveleski pour se libérer de lui, de manière à se distinguer d’un Conan Doyle incapable de se défaire de Sherlock Holmes… Le prix Saint-Pacôme signala à juste titre la qualité de ce polar.
Autour de Coveleski, le romancier fait évoluer Montréal. Pendant que Pax Plante et Jean Drapeau tisonnent un réveil de la moralité publique et que Duplessis fait appel aux policiers provinciaux pour étouffer les réclamations syndicales, la métropole québécoise oscille entre le balayage et l’enlisement. Une fois encore, Houde excelle à mener de front, d’une part, le destin d’un homme meurtri et en quête de guérison et, d’autre part, les enquêtes qui, comme la commission Caron, exhument les sédiments de la corruption montréalaise ; il réussit même à pousser l’enquête de Coveleski jusqu’à la porte de l’hôtel de ville sans jamais torturer la vraisemblance. Par une implacable logique d’auteur, il rompra la relation entre Maranda et Coveleski et exigera de son détective privé des gestes répugnants ; Montréal et la conscience de Coveleski seront tous deux traités sans recours à la guimauve. On peut même se demander si Houde salit Coveleski pour se libérer de lui, de manière à se distinguer d’un Conan Doyle incapable de se défaire de Sherlock Holmes… Le prix Saint-Pacôme signala à juste titre la qualité de ce polar.
Horizon nouveau
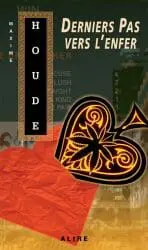 Dans le livre suivant, Coveleski s’éclipse et le ton s’alourdit. Pour Derniers pas vers l’enfer3, Houde trempe sa plume dans une encre opaque et corrosive. Il met en scène Daniel Martineau, enquêteur au Service de police de la Ville de Montréal, mais il l’immerge dans une corruption policière différente de celle que visait le criminologue Jean-Paul Brodeur dans ses recherches sur les commissions d’enquête (cf. La délinquance de l’ordre, Hurtubise HMH, 1984). Martineau s’abouche avec le crime, essaie de jouer un caïd contre l’autre, s’attache à la favorite d’un rapace de haut vol, se ruine comme le pire joueur compulsif, rêve d’une fuite cossue vers les pays du soleil, etc. Pitoyable délire. Rien en Martineau ne rappelle le mal à l’âme de Coveleski ou sa capacité de rebondissement, rien qui n’émeuve comme le sort immérité de Maranda. En décrivant correctement un monde englué dans la rapacité et le sadisme, Houde a convié son public à un dépaysement radical qu’il n’a que trop bien réussi. Trop bien.
Dans le livre suivant, Coveleski s’éclipse et le ton s’alourdit. Pour Derniers pas vers l’enfer3, Houde trempe sa plume dans une encre opaque et corrosive. Il met en scène Daniel Martineau, enquêteur au Service de police de la Ville de Montréal, mais il l’immerge dans une corruption policière différente de celle que visait le criminologue Jean-Paul Brodeur dans ses recherches sur les commissions d’enquête (cf. La délinquance de l’ordre, Hurtubise HMH, 1984). Martineau s’abouche avec le crime, essaie de jouer un caïd contre l’autre, s’attache à la favorite d’un rapace de haut vol, se ruine comme le pire joueur compulsif, rêve d’une fuite cossue vers les pays du soleil, etc. Pitoyable délire. Rien en Martineau ne rappelle le mal à l’âme de Coveleski ou sa capacité de rebondissement, rien qui n’émeuve comme le sort immérité de Maranda. En décrivant correctement un monde englué dans la rapacité et le sadisme, Houde a convié son public à un dépaysement radical qu’il n’a que trop bien réussi. Trop bien.
Retour aux sources
 Heureusement, Coveleski renaît avec un nouveau souffle, même si L’infortune des bien nantis lui a demandé un comportement peu compatible avec une éthique minimale ; La misère des laissés-pour-compte4 nous le ramène plus autonome qu’au temps de Maranda, plus ancré dans son régime sec, plus confiant dans son humour pourtant maladroit, encore jalousé par des policiers toujours peu fiables, mais moins primaires. Houde retrouve d’ailleurs avec naturel les propos tenus par le Coveleski du passé. Pax Plante revient à la surface, mais peut-être inspiré plus qu’autrefois par un esprit de vengeance : « Plante cherchait à se venger de l’exécutif de la ville – surtout de J.-O. Asselin – pour avoir été viré de son poste à la moralité ». Chose certaine, Coveleski mène cette fois une enquête minutieuse, méfiante, approfondie, que seul pouvait mener à bon port un policier possédé par son instinct de chasseur. Pour sa part, Houde, qui tient son théâtre en main ferme, couronne son enquête de manière déstabilisante : les amours de son enquêteur versent dans l’incertitude, celui qui prétendait l’accueillir dans son clan ne lui propose plus qu’une flaque boueuse, les cadres de la police pratiquent le chantage et les conspirations profitables… Louables caractéristiques d’un auteur qui n’a que faire des fins hollywoodiennes et qui, surtout, veut commencer son prochain polar dans la plus grande liberté qui soit. Parions sur lui.
Heureusement, Coveleski renaît avec un nouveau souffle, même si L’infortune des bien nantis lui a demandé un comportement peu compatible avec une éthique minimale ; La misère des laissés-pour-compte4 nous le ramène plus autonome qu’au temps de Maranda, plus ancré dans son régime sec, plus confiant dans son humour pourtant maladroit, encore jalousé par des policiers toujours peu fiables, mais moins primaires. Houde retrouve d’ailleurs avec naturel les propos tenus par le Coveleski du passé. Pax Plante revient à la surface, mais peut-être inspiré plus qu’autrefois par un esprit de vengeance : « Plante cherchait à se venger de l’exécutif de la ville – surtout de J.-O. Asselin – pour avoir été viré de son poste à la moralité ». Chose certaine, Coveleski mène cette fois une enquête minutieuse, méfiante, approfondie, que seul pouvait mener à bon port un policier possédé par son instinct de chasseur. Pour sa part, Houde, qui tient son théâtre en main ferme, couronne son enquête de manière déstabilisante : les amours de son enquêteur versent dans l’incertitude, celui qui prétendait l’accueillir dans son clan ne lui propose plus qu’une flaque boueuse, les cadres de la police pratiquent le chantage et les conspirations profitables… Louables caractéristiques d’un auteur qui n’a que faire des fins hollywoodiennes et qui, surtout, veut commencer son prochain polar dans la plus grande liberté qui soit. Parions sur lui.
1. Maxime Houde, Les poids des illusions, Alire, Québec, 2008, 470 p. ; 15,95 $.
2. Maxime Houde, L’infortune des bien nantis, Alire, Québec, 2011, 376 p. ; 14,95 $.
3. Maxime Houde, Derniers pas vers l’enfer, Alire, Québec, 2014, 280 p. ; 24,95 $.
4. Maxime Houde, La misère des laissés-pour-compte, Alire, Québec, 2015, 278 p. ; 24,95 $.
EXTRAITS
La bouteille de Croix d’Or était toujours dans la boîte à gants. J’en pris une lampée pour me réchauffer, une couple d’autres pour égayer le retour à la maison et je me couchai.
Le poids des illusions, p. 60.
Durant tout le mois de novembre, les communistes firent les manchettes grâce aux grèves en France, le blocus de Berlin qui se poursuivait et la guerre civile en Chine, où les armées gouvernementales subirent de lourdes pertes. La peur des Rouges empoisonnait le climat international.
L’infortune des biens nantis, p. 33.
– L’important, c’est que Blanco ait réduit sa dette. En plus de son entente avec Sachetti, Martineau a économisé un joli petit magot ces vingt-quatre dernières heures… En songeant aux manœuvres qu’il a exécutées pour embobiner les deux mafieux, il ne peut s’empêcher de sourire.
Derniers pas vers l’enfer, p. 92.
– Donc, il n’y a pas de bookies en ville ?
– Non, non, admit Lebeau en esquissant un geste vague de la main. Y en a, c’est certain. Mais on en a besoin.
– Comment ça ?
– C’est là qu’on va chercher nos informations pour ensuite frapper.
La misère des laissés-pour-compte, p. 69.











