Depuis toujours, l’encre, le papier et les mots collent à la peau de Louise Lacoursière. Après avoir longtemps enseigné, puis dirigé un centre d’éducation aux adultes, la Shawiniganaise s’est tout naturellement tournée vers l’écriture, qu’elle a choisie comme deuxième carrière.
Rien d’étonnant, en fait, à ce que Louise Lacoursière conjugue maintenant romans historiques et biographies. Fille d’imprimeur, elle est aussi la sœur de l’auteur Jacques Lacoursière, vulgarisateur émérite de l’histoire du Québec. Depuis une quinzaine d’années, la bachelière en pédagogie se consacre à son nouveau métier d’écrivaine et d’animatrice culturelle.
La trilogie d’Anne Stillman McCormick
Louise Lacoursière utilise ses talents de recherchiste et de conteuse pour publier des romans et des sagas qui mettent en scène des personnalités de sa région natale, aujourd’hui tombées dans l’oubli. C’est ainsi que l’auteure a raconté la vie tumultueuse de l’Américaine Anne Urquhart Potter (1879-1969) dans Les carnets de Cora. La saga d’Anne Stillman McCormick. Mariée tout d’abord à James Alexander Stillman – leur divorce fera grand bruit à l’époque –, la millionnaire s’était ensuite unie à Fowler McCormick. Amoureuse de la nature, la philanthrope séjournera souvent dans le domaine qu’elle avait acquis à Grande-Anse (Mékinac), sur la rivière Saint-Maurice, ce qui lui voudra le surnom de Reine de la Mauricie.
La trilogie a rapidement obtenu du succès et a deux fois remporté le Prix du public au Salon du livre de Trois-Rivières, en 2000 et en 2003. De plus, Anne Stillman. Le procès a été finaliste au Prix littéraire Gérald-Godin et Anne Stillman. De New York à Grande-Anse a quant à lui été finaliste au Grand Prix littéraire Archambault. En 2005, le dernier tome des Carnets de Cora a reçu le Prix des abonnés des bibliothèques publiques de la Mauricie/Centre-du-Québec. Une version télévisuelle de la trilogie, soit une télésérie à grand déploiement, est présentement en préproduction.
Réalité et fiction
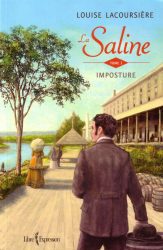
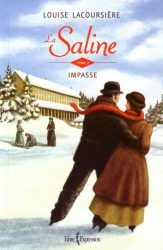 Alors qu’en 2004 elle en est à mettre le point final aux Carnets de Cora, Louise Lacoursière visite à Yamachiche la maison du médecin et poète Nérée Beauchemin (1850-1931). Comme plusieurs notables du XIXe siècle, l’homme de science était aussi un homme de lettres. Aujourd’hui classée monument historique, la belle demeure de Beauchemin a charmé l’écrivaine à un point tel qu’elle s’est bien juré qu’un jour, on retrouverait un de ses personnages dans le salon du médecin-poète. Il lui fallait pourtant encore créer ce personnage. Ainsi est né le docteur Antoine Peltier, originaire de Saint-Léon-le-Grand, situé près de Yamachiche, dans le comté de Maskinongé, et principal protagoniste de la trilogie La Saline.
Alors qu’en 2004 elle en est à mettre le point final aux Carnets de Cora, Louise Lacoursière visite à Yamachiche la maison du médecin et poète Nérée Beauchemin (1850-1931). Comme plusieurs notables du XIXe siècle, l’homme de science était aussi un homme de lettres. Aujourd’hui classée monument historique, la belle demeure de Beauchemin a charmé l’écrivaine à un point tel qu’elle s’est bien juré qu’un jour, on retrouverait un de ses personnages dans le salon du médecin-poète. Il lui fallait pourtant encore créer ce personnage. Ainsi est né le docteur Antoine Peltier, originaire de Saint-Léon-le-Grand, situé près de Yamachiche, dans le comté de Maskinongé, et principal protagoniste de la trilogie La Saline.
 Unissant la réalité et la fiction, l’écrivaine a fait le lien entre les deux médecins, celui qui a existé et celui qu’elle a inventé. Le fictif Dr Antoine Peltier racontera un jour sa fameuse visite. « Il s’agit d’un extrait des Roses d’automne, composé par un autre médecin […]. Il habite le village voisin » (« Aux branches que l’air rouille et que le gel mordore, / Comme par un prodige inouï du soleil, / Avec plus de langueur et plus de charme encore, / Les roses du parterre ouvrent leur cœur vermeil. »)
Unissant la réalité et la fiction, l’écrivaine a fait le lien entre les deux médecins, celui qui a existé et celui qu’elle a inventé. Le fictif Dr Antoine Peltier racontera un jour sa fameuse visite. « Il s’agit d’un extrait des Roses d’automne, composé par un autre médecin […]. Il habite le village voisin » (« Aux branches que l’air rouille et que le gel mordore, / Comme par un prodige inouï du soleil, / Avec plus de langueur et plus de charme encore, / Les roses du parterre ouvrent leur cœur vermeil. »)
Tout en dessinant les grandes lignes du récit, Louise Lacoursière doit en situer l’action. Que le Dr Peltier soit né à Saint-Léon-le-Grand n’est pas le fruit du hasard, car l’écrivaine voulait faire revivre à l’entrée de ce village, près de Louiseville, le St. Leon Springs Hotel aujourd’hui disparu. Ce spa de luxe où les Américains venaient prendre les eaux a en effet bel et bien existé, mais l’hôtel de renommée mondiale a été détruit en 1904. « Érigé en bordure de la rivière du Loup1 sur le territoire de La Saline, ainsi nommé par la population à cause d’une source d’eau minérale aux multiples vertus thérapeutiques, ce chic établissement attirait une clientèle fortunée. »
Médecin de campagne au XIXe siècle
L’auteure peut maintenant donner libre cours à son imagination, qu’elle a très féconde, et raconter l’histoire d’un simple villageois devenu médecin de campagne à la fin du XIXe siècle. Le Dr Peltier passera des bras de sa fougueuse maîtresse américaine Judy à ceux de sa femme Mathilde, avec laquelle il fondera une famille. Grâce aux allées et venues de l’omnipraticien auprès de ses patients, le lecteur suivra les péripéties de mille et un personnages tous plus colorés les uns que les autres. Les talents de chercheuse de Louise Lacoursière ne sont plus à démontrer. La trilogie abonde en détails sur la ruralité de l’époque, l’omniprésence de l’Église catholique et le monde politique du Québec d’antan. On croise Louis Riel et Honoré Mercier – l’idole du médecin –, Louis Cyr et le curé Labelle. On revit la douloureuse émigration de tant de Québécois en Nouvelle-Angleterre. « Ils s’attendaient à trouver dans les ‘factories’ des villes l’abondance tant espérée. »
Quant au monde de la médecine rurale, il est finement documenté, avec une grande habileté. À chaque acte médical ou intervention que pratique le Dr Peltier, le lecteur est tenu en haleine, attendant les résultats, mais demeure étonné par la pratique d’une médecine bien différente de celle d’aujourd’hui. Si « [l]es droits obtenus en 1847 avaient changé le visage de la médecine au Québec », on est loin du XXIe siècle. Le médecin conseillera sa clientèle et cherchera des solutions aux maux dont souffre toute société. Défilent ainsi des cas de violence conjugale, d’alcoolisme et de morphinomanie, de mort d’enfants, de meurtre et de suicide, d’adultère et d’ignorance concernant l’homosexualité, d’inceste et de silence. « Marie-Ange était convaincue que toutes les premières-nées s’adonnaient à ce genre d’activités secrètes avec leur père. » L’enfer de Dante se conjugue à la condition humaine.
Le village, mais aussi la ville et le wigwam
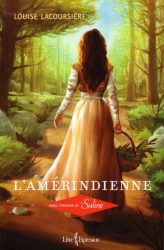 Les personnages de Louise Lacoursière sortent parfois de leurs terres et villages pour explorer d’autres mondes. Montréal et Québec, les deux grandes villes québécoises de l’époque, ne sont pas en reste dans La Saline. Antoine Peltier n’a-t-il pas étudié à Montréal chez les jésuites du collège Sainte-Marie et fait sa médecine dans la métropole, grâce à la générosité de son oncle ? Une des jeunes patientes du médecin de campagne, enceinte à la suite d’un inceste, ne trouve-t-elle pas refuge à Québec, à « l’Hospice de la Miséricorde, dirigé par les sœurs du Bon-Pasteur, et dont la mission consistait, comme à Montréal, à accueillir les mères célibataires » ?
Les personnages de Louise Lacoursière sortent parfois de leurs terres et villages pour explorer d’autres mondes. Montréal et Québec, les deux grandes villes québécoises de l’époque, ne sont pas en reste dans La Saline. Antoine Peltier n’a-t-il pas étudié à Montréal chez les jésuites du collège Sainte-Marie et fait sa médecine dans la métropole, grâce à la générosité de son oncle ? Une des jeunes patientes du médecin de campagne, enceinte à la suite d’un inceste, ne trouve-t-elle pas refuge à Québec, à « l’Hospice de la Miséricorde, dirigé par les sœurs du Bon-Pasteur, et dont la mission consistait, comme à Montréal, à accueillir les mères célibataires » ?
Judy O’Shaughnessy, l’Américaine mal mariée et principale protagoniste féminine des romans, est un des rares personnages à passer d’un monde à l’autre, du village à la ville, puis au campement indien, ouvrant même une herboristerie à Montréal grâce aux conseils de son amie Alanis, une Abénaquise de Saint-François-du-Lac. Judy est L’Amérindienne, sujet et titre du dernier volume de la trilogie. Après avoir délaissé ses amours coupables avec le beau docteur Peltier, elle vivra en paix dans le wigwam de son époux Simon Watso, au sein de la tribu abénaquise. « La nature est ton alliée, Judy. En plus de te nourrir et de te soigner, elle te procure la paix. Quand tu la connaîtras mieux, tu rendras également hommage à Tabaldak !2 »
Pour La Saline. Imposture et La Saline. Impasse, Louise Lacoursière a reçu le Prix du public au Salon du livre de Trois-Rivières et a été finaliste au Prix littéraire Gérald-Godin ; pour l’ensemble de son œuvre, elle a reçu le Grand Prix de la culture Le Nouvelliste et, tout récemment, le prix Adagio 2017.
1. Louiseville est située en Mauricie, sur la rive nord du lac Saint-Pierre, et traversée par deux rivières : la Petite et la Grande rivière du Loup.
2. « Au début du monde, le Créateur, que les Indiens Abénakis appellent Tabaldak, créa la terre » (www.lespasseurs.com).
Livres évoqués dans cet article : Les carnets de Cora. La saga d’Anne Stillman McCormick, Libre Expression, 2004 ; Anne Stillman. T. I, Le procès, Libre Expression, 2004 ; Anne Stillman. T. II, De New York à Grande-Anse, Libre Expression, 2004 ; La Saline. T. III, Imposture, Libre Expression, 2012 ; La Saline. T. II, Impasse, Libre Expression, 2012 ; L’Amérindienne. Dans l’univers de La Saline, Libre Expression, 2017.
EXTRAITS
Les bourgeois à l’aise pouvaient s’offrir le luxe de voyager seuls dans leur véhicule hippomobile alors qu’Antoine et ses semblables empruntaient de plus en plus le tramway pour se déplacer dans Montréal, sillonnée d’est en ouest et du sud au nord par un chemin de fer à rails plats.
La Saline. T. I, Imposture, p. 12.
Il était tout ce qu’elle avait désiré d’un amoureux : attentif, ouvert, à l’écoute, aimant, tendre. En plus, il consacrait sa vie à soigner les gens, un rêve qu’elle caressait depuis son enfance. Si elle avait partagé son quotidien, elle aurait été à ses côtés pour l’aider à soulager les douleurs, les misères.
La Saline. T. II, Impasse, p. 77.
La tradition orale voulait que les Abénakis aient fui la Nouvelle-Angleterre voilà près de deux cents ans, menacés d’extermination par les Anglais. Après des déplacements de Sillery au Saut-de-la-Chaudière, leurs ancêtres, guidés par les Jésuites, s’étaient enfin établis sur la rive est de la Saint-François, là où les Français leur avaient concédé des lots.
L’Amérindienne. Dans l’univers de La Saline, p. 37.











