Belle prise pour Albin Michel : Underground Railroad1, le sixième roman de Colson Whitehead (un auteur jusque-là publié en français chez Gallimard), cumule les récompenses. Il a remporté le prix Pulitzer 2017, le prix Arthur-C.-Clarke 2017 et le National Book Award 2016. Honneurs bien mérités : l’œuvre est éblouissante.
Underground Railroad est aussi le dernier livre lu par Barack Obama pendant qu’il occupait le Bureau ovale. Selon le 44e président américain, le roman de Whitehead « rappelle que la douleur d’avoir été esclave se transmet de génération en génération et il explique aussi comment elle peut changer les esprits et les cœurs2 ». L’œuvre de l’écrivain new-yorkais éveillera des résonances particulières à la lumière des tensions raciales et de la montée des groupes d’extrême droite qui défraient actuellement la chronique aux États-Unis et dans le reste du monde.
Cora la fugitive
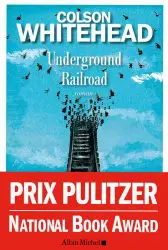 L’héroïne du roman, Cora, est une jeune esclave de seize ans vivant sur la plantation de coton de la famille Randall, en Géorgie, avant la guerre de Sécession. Elle n’avait que dix ou onze ans quand sa mère, Mabel, s’est enfuie pour ne jamais revenir, ne lui laissant rien, hormis un petit lopin de terre ingrate que la fillette défend avec une opiniâtreté surprenante. Ainsi quand Blake, « le grand chêne », décide d’y installer une bicoque pour son chien, elle saisit une hachette et reprend possession des lieux en démolissant la niche. Cette fermeté du caractère lui sera très utile par la suite, car sa fuite en compagnie de Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, l’entraîne dans le plus périlleux des voyages vers les États libres du Nord. Les frères Randall, surtout Terrance, sont impitoyables envers les fugitifs. L’exécution de Big Anthony, aspergé d’huile et rôti sous les yeux des autres esclaves pendant que les Randall et leurs invités sirotent du rhum, envoie un message clair : « Ne vous rebellez pas ». Même chose avec la « Piste de la Liberté », cette interminable rangée de cadavres noirs pendus aux arbres sur une route de campagne en Caroline du Nord. De surcroît, les fuyards doivent échapper aux miliciens et aux patrouilleurs qui ne les lâchent pas d’une semelle. L’un d’eux, Arnold Ridgeway, se montre particulièrement coriace. Cora a tout intérêt à ne pas se faire attraper, car Ridgeway n’a toujours pas digéré l’évasion réussie de Mabel. Il fait de la capture de Cora une affaire personnelle.
L’héroïne du roman, Cora, est une jeune esclave de seize ans vivant sur la plantation de coton de la famille Randall, en Géorgie, avant la guerre de Sécession. Elle n’avait que dix ou onze ans quand sa mère, Mabel, s’est enfuie pour ne jamais revenir, ne lui laissant rien, hormis un petit lopin de terre ingrate que la fillette défend avec une opiniâtreté surprenante. Ainsi quand Blake, « le grand chêne », décide d’y installer une bicoque pour son chien, elle saisit une hachette et reprend possession des lieux en démolissant la niche. Cette fermeté du caractère lui sera très utile par la suite, car sa fuite en compagnie de Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, l’entraîne dans le plus périlleux des voyages vers les États libres du Nord. Les frères Randall, surtout Terrance, sont impitoyables envers les fugitifs. L’exécution de Big Anthony, aspergé d’huile et rôti sous les yeux des autres esclaves pendant que les Randall et leurs invités sirotent du rhum, envoie un message clair : « Ne vous rebellez pas ». Même chose avec la « Piste de la Liberté », cette interminable rangée de cadavres noirs pendus aux arbres sur une route de campagne en Caroline du Nord. De surcroît, les fuyards doivent échapper aux miliciens et aux patrouilleurs qui ne les lâchent pas d’une semelle. L’un d’eux, Arnold Ridgeway, se montre particulièrement coriace. Cora a tout intérêt à ne pas se faire attraper, car Ridgeway n’a toujours pas digéré l’évasion réussie de Mabel. Il fait de la capture de Cora une affaire personnelle.
Une lecture rétrofuturiste de l’histoire
De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, Cora et Caesar empruntent alors la trajectoire secrète de l’Underground Railroad (« chemin de fer clandestin »). Élément important de l’histoire américaine, ce circuit ne renvoie pas à un véritable réseau de voies ferrées, sauf dans l’imagination de Whitehead. Historiquement, l’expression fait référence à un ensemble de routes et de refuges cachés dans le but d’aider les esclaves à fuir vers les États libres du Nord ou vers le Canada. Les points d’arrêt étaient surnommés des « gares » ; les fuyards, des « passagers » ou de la « cargaison », et on appelait « conducteurs » ceux qui leur venaient en aide (de libres citoyens noirs – souvent d’anciens esclaves –, des abolitionnistes du Nord, des philanthropes ou des chefs religieux). Sans dénaturer les faits, Whitehead a choisi d’y greffer une composante rétrofuturiste en prenant l’expression au pied de la lettre et en imaginant un train circulant en cachette sous la terre. Les tunnels creusés laborieusement et dans le plus grand péril prennent alors la valeur d’un puissant symbole. Ce n’est pas la première fois que l’auteur flirte avec la science-fiction. Il l’avait déjà fait dans L’intuitionniste (1999), histoire se déroulant dans un monde parallèle dominé par les ascenseurs, et surtout dans Zone 1 (2011), récit de zombies qui se voulait un hommage personnel à La nuit des morts-vivants de Romero.
Les mécanismes du racisme
Cora ne fait pas que courir : les circonstances la forcent parfois à trouver un abri. C’est le cas, en Caroline du Nord, lorsqu’elle aboutit chez Martin et Ethel Wells. Martin est le fils d’un militant abolitionniste, qui a repris sans conviction les activités de son père. Sa femme Ethel n’est de mèche avec lui que pour sauver sa propre peau (il était extrêmement risqué pour des Blancs de venir en aide aux esclaves en fuite). Cora devra passer plusieurs mois dissimulée dans les combles de leur maison, à retenir son souffle pour que Fiona, la bonne, ne découvre pas sa présence. Elle n’aura guère de distraction à part la lecture d’un vieil almanach à la lueur d’une bougie ou la contemplation d’un parc, le soir, à travers une petite fenêtre. D’étranges rassemblements s’y tiennent à la nuit tombée. Le parc tient lieu de colline de Justice et Cora assistera à d’horribles rituels… Dans ce sixième roman, où il donne la pleine mesure de son talent, Colson Whitehead explore les mécanismes du racisme aux États-Unis. Il montre des personnages pourris par la haine et d’autres animés par la plus poignante des empathies. Les faits qu’il relate sont souvent atroces et troublants, mais le propos est si sobre et si bien dosé que le lecteur est atteint non seulement au cœur, mais dans son humanité. Tour de force narratif, Underground Railroad est un roman à la fois palpitant et à méditer.
1. Colson Whitehead, Underground Railroad, traduit de l’américain par Serge Chauvin, Albin Michel, Paris, 2017, 402 p. ; 32,95 $.
2. Barack Obama cité par Khadija Moussou, « Barack Obama : les livres qui lui ont sauvé la vie », Elle, 18 janvier 2017, en ligne, www.elle.fr/Loisirs/Livres/Dossiers/Barack-Obama-les-livres-qui-lui-ont-sauve-la-vie/The-Underground-Railroad-de-Colson-Whitehead.
EXTRAITS
Le troisième jour, juste après le déjeuner, on rappela les cueilleurs occupés aux champs ; les lavandières, cuisinières et palefreniers furent interrompus dans leurs tâches, le personnel de maison dans son ménage. Tous se rassemblèrent sur la pelouse. Les hôtes de Randall sirotèrent du rhum épicé tandis que Big Anthony était aspergé d’huile et rôti. Les spectateurs se virent épargner ses hurlements, car dès le premier jour on lui avait tranché ses attributs virils, qu’on lui avait fourrés dans la bouche avant de la coudre. L’échafaud fumait, noircissait et brûlait, et les figures sculptées dans le bois se tordaient dans les flammes comme si elles étaient vivantes.
p. 67-68
La littérature anti-esclavagiste était illégale dans cette région du pays. Les abolitionnistes et sympathisants qui s’aventuraient en Géorgie et en Floride étaient chassés, fustigés et molestés par la foule, recouverts de goudron et de plumes. Les méthodistes et leurs inanités n’avaient pas leur place dans le giron du roi Coton. Les planteurs ne toléraient pas la contagion.
p. 75
Les cadavres pendaient aux arbres comme des ornements pourrissants. Certains étaient nus, d’autres à demi vêtus, le fond de pantalon noirci d’excréments attestant que leurs intestins s’étaient vidés à l’instant où leur nuque s’était rompue. D’horribles plaies et blessures marquaient la chair des deux corps les plus proches, ceux qu’éclairait la lanterne du chef de gare. […] « Désormais, ils appellent cette route la Piste de la Liberté, dit Martin en replaçant la toile. Les cadavres la jonchent tout du long, jusqu’à la ville. »
p. 199
Quel est ce monde, pensa-t-elle, qui fait d’une prison vivante votre seul refuge. Était-elle libérée de ses liens ou prise dans leur toile ? Comment décrire le statut d’une fugitive ? La liberté était une chose changeante selon le point de vue, de même qu’une forêt vue de près est un maillage touffu, un labyrinthe d’arbres, alors que du dehors, depuis la clairière vide, on en voit les limites. Être libre n’était pas une question de chaînes, ni d’espace disponible.
p. 235
La première et la dernière chose qu’elle offrit à sa fille, ce fut des excuses. Cora dormait encore dans son ventre, pas plus grosse qu’un poing, quand elle s’excusa par avance du monde où elle allait l’amener. Cora dormait à côté d’elle dans la soupente, dix ans plus tard, quand Mabel s’excusa de faire d’elle une enfant perdue. Cora ne les entendit ni l’une ni l’autre.
p. 381











