 J’ai été vaincu. Par mon propre sang. Celui qu’on appelle la parentèle dans nos nuits d’insomnie. Alors nous avons quitté, Charlotte et moi, un village dont je tairai le nom, dont je ne parlerai plus jamais. L’indifférence ne mérite ni mépris ni silence, seulement un long regard déterminé. Nous avons quitté la mort dans l’arme.
J’ai été vaincu. Par mon propre sang. Celui qu’on appelle la parentèle dans nos nuits d’insomnie. Alors nous avons quitté, Charlotte et moi, un village dont je tairai le nom, dont je ne parlerai plus jamais. L’indifférence ne mérite ni mépris ni silence, seulement un long regard déterminé. Nous avons quitté la mort dans l’arme.
Bientôt, je rendrai mes mots puisqu’ils seront saisis par la vie infinie s’immisçant dans les fissures d’une nature qui parle à tort et à travers au lieu de me répondre avant de crever la bouche ouverte, bouche pleine d’images merveilleuses qui ne naîtront jamais parce que je suis entouré de sourds parfaitement familiaux.
Sur la route de Saint-Georges-de-Beauce, dans le petit froid de l’automne, que des interrogations furieuses sur la méchanceté fondamentale de l’espèce humaine. Dans notre nouvelle maison, à deux pas de l’hôpital que je fréquenterai désormais, nous avons fait l’amour afin de débaptiser l’affront à notre intégrité entre des caisses de livres sur un matelas aux draps toujours défaits. Ainsi nous avons épuisé notre énergie vitale pour effacer quarante années de souffrance et d’affreux malentendus. Quarante années entourées de regards étonnés, cela vous forge des nerfs d’acier et un certain stoïcisme parmi de braves gens préoccupés par le pain et le train-train quotidiens sur fond d’activités socio-métalliques.
Par contre, je vais m’ennuyer de mes « ailes angels » préférées, mes chères corneilles qui, été comme hiver, me cassaient les oreilles pendant mes envolées poétiques, maiscorneilles qui me signifiaient souvent, trop souvent, que la nature schizophrène contrôle le jeu de la vie et garde le dernier mot dans le corps comme dans la chair.
Je n’oublierai jamais le mythique Château blanc, discothèque fréquentée, en leur folle jeunesse, entre autres par le comédien Fabien Cloutier et… Nelly Arcan. En ce lieu j’ai griffonné les premières pages de Babelle 1. Après le déluge, assis à une petite table branlante dans un coin obscur au fond de la salle, en compagnie de grosses bières et d’amis précambriens souvent, trop souvent en peine d’amour dans le bruit et les fourreurs. En état de pure ivresse, je me téléphonais tandis que je notais des bribes d’aveux, des commentaires vaseux et de lamentables lamentations sur la cruauté de l’amour. Mais j’avais peine à ouïr les transes et les confidences tant le disco tonitruant de Pierre Gravel envahissait l’espace public, entraînant la jeunesse beauceronne dans une grotesque tarentelle sans foi ni loi. Au fond de la salle de danse, j’étais un écrivain impudique qui tenait salon dans ce lieu que je baptiserai plus tard « le confessionnal des fesses ». En ce lieu, le jeune prolétariat magané gravitait autour de mon narcissisme ontologique et savait ma perversité.
Ainsi j’écrivais des vertiges dans cet espace public aux secrets d’alcôve et dans le temps de mes cuites furieuses en compagnie de Jacques Poulin et, parfois, de Jacques Hardy, qui n’avait pas peur d’affronter un authentique monde souterrain bafoué, méprisé et ridiculisé par la gentry de Sillery. Ces portes de l’enfer fermées à double tour, nous les avons ouvertes souvent, si souvent avant de partir en virant virer la Beauce à l’envers qu’on oubliait parfois de revenir au bercail pour coucher, ivres morts ou gazés, dans le fossé ou dans des autos déglinguées déjà dans le fossé.
J’écris cela aux abois dans ma chaise de bois (rime facile), parce que la maladie couve toujours avant de se découvrir intègre et nue au détour (autre rime facile) et que, de la cuisine, je vois l’hôpital où j’ai reçu autrefois ma ration mensuelle de mort lente entre radiographies existentielles et prises de sens. J’écris cela dans le déclin d’un hiver qui n’a rien d’épormyable, un hiver qui n’en finit pas de finir alors que le Québec s’enfonce de plus en plus dans l’insignifiance collective sur fond de liberté blanche.
Ça fait que… en défaisant mes caisses, je suis tombé sur Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat et Le mal des anges d’André Loiselet, deux livres déjantés aux phantasmes odieux. Le réalisme froid et ordurier dans Le mal des angesdonne la réplique au matérialisme brut et brutal d’Éden, Éden, Éden. C’est ainsi que je me suis souvenu que ces deux livres m’avaient inspiré, en partie, le délire descriptif que l’on trouve dans Babelle 1. Après le déluge. Ces deux livres, je les avais lus l’un après l’autre, dans mon demi-sous-sol rue de Rougemont et dans un climat vertigineux aux vapeurs suspectes.
Dans Éden, Éden, Éden, l’intrigue se passe en Algérie pendant la guerre de l’indépendance, si on peut l’appeler ainsi. D’une couverture à l’autre, tout est question de domination, surtout et avant tout sexuelle, dans une mise en scène matérialiste sans compromis et, surtout, sans aucune psychologie. Dans ce « roman », tout, absolument tout est réduit à des fonctions sexuelles sur fond de besoins vitaux irrépressibles, telles la faim et les fonctions excrémentielles sans parler de la bestialité. Là, la pyramide des besoins s’est écroulée et a été nivelée par le bouteur des humeurs déjantées.
En accord avec les lois de la thermodynamique, la guerre autorise la perte de l’Autre, mais aussi le gain du prédateur sous toutes ses formes, mais gain qui ne peut jamais rester en l’état ou en vase clos, gain qu’on ne peut jamais thésauriser. Donc il doit se dissiper en dépenses dans des postures dominatrices sans aucun code ou impératif moral, l’énergie un temps engrangée et dépensée n’ayant ici aucune finalité. Dans le jeu à somme nulle de la vie et de la mort, l’échange s’effectue dans une atmosphère irréelle où sévit l’enfer d’un éternel présent.
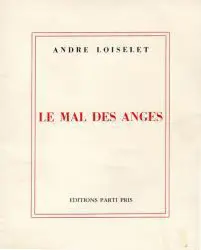 Quant à la plaquette Le mal des anges d’André Loiselet, j’y ai relevé la force du langage brut ramené au ras du sol pollué par la dépossession tranquille qui a marqué pendant des siècles l’imaginaire du peuple québécois. Quand Loiselet a publié son livre en 1968, le Québec n’était pas encore sorti collectivement de son défaitisme historique qui lui faisait dire de haut en bas de l’échelle sociale que « quand deux esclaves se rencontrent, ils parlent en mal de la liberté » (proverbe africain). Alors, quand je lis : « J’ai donc dû monter derrière elle, à quatre pattes, comme un cochon, pour ne rien perdre de chaque fesse rose et charnue », nous sommes rendus au dernier degré de la possession-dépossession, à l’image du pauvre et pâle mâle québécois qui végétait, après la révolution industrielle et avant la Révolution tranquille, dans de sinistres usines où il crachait ses poumons avant de râler son dernier râlement. Tout comme aujourd’hui où le pâle mâle québécois, tout contrit, se fait odieusement crucifier par une délirante rectitude politique. Bref, les Québécois ont-ils été vaincus encore une fois avant même d’avoir vécu… le pouvoir ? Mais la seule pornographie que l’on devrait interdire n’est-elle pas celle, justement, du pouvoir ?
Quant à la plaquette Le mal des anges d’André Loiselet, j’y ai relevé la force du langage brut ramené au ras du sol pollué par la dépossession tranquille qui a marqué pendant des siècles l’imaginaire du peuple québécois. Quand Loiselet a publié son livre en 1968, le Québec n’était pas encore sorti collectivement de son défaitisme historique qui lui faisait dire de haut en bas de l’échelle sociale que « quand deux esclaves se rencontrent, ils parlent en mal de la liberté » (proverbe africain). Alors, quand je lis : « J’ai donc dû monter derrière elle, à quatre pattes, comme un cochon, pour ne rien perdre de chaque fesse rose et charnue », nous sommes rendus au dernier degré de la possession-dépossession, à l’image du pauvre et pâle mâle québécois qui végétait, après la révolution industrielle et avant la Révolution tranquille, dans de sinistres usines où il crachait ses poumons avant de râler son dernier râlement. Tout comme aujourd’hui où le pâle mâle québécois, tout contrit, se fait odieusement crucifier par une délirante rectitude politique. Bref, les Québécois ont-ils été vaincus encore une fois avant même d’avoir vécu… le pouvoir ? Mais la seule pornographie que l’on devrait interdire n’est-elle pas celle, justement, du pouvoir ?
Au contraire de Loiselet, j’ai privilégié le monologue intérieur, le stream of consciousnesspropre aux joyciens d’un langageurqui abolit la distanciation propre au roman classique. Ce langageurne choisit rien, se laissant porter par ses seules émotions spontanées non structurées, non rationalisées et non hiérarchisées dans un flot verbal à la tessiture jouale. Le monologue intérieur décrit subjectivement le monde sans aucun filtre discriminatoire, sur tous les tons et tous les temps.
Dans Éden, Éden, Éden comme dans Babelle 1. Après le déluge, nous trouvons des corps-à-corps furieux où l’énergie se dissipe en dépense effrénée. Le dominant soumet l’Autre, mais ce faisant il obéit sans s’en rendre compte à l’empire du chaos énergétique qui gère l’univers en fuite et en route jusqu’à sa dilatation extrême et sa fatidique dissolution. Par contre, le langage de Babelle 1. Après le déluge s’éloigne de celui d’Éden, Éden, Éden en ce sens qu’il fait corps avec la chair, qu’il colle au décor et vibre avec le sujet et contre le sujet. Ici, le cœur ravageur joue et jouit de son corps destructeur afin de montrer à la vie ce que la nature lui offre comme fruit de ses efforts : un bien triste spectacle de chairs affolées et affolantes au mouvement brownien, des particules élémentaires (bien avant celles d’un Houellebecq…) en quête constante de l’énergie nécessaire à la création et à la destruction d’une hiérarchie naturelle de ridicules prédateurs plus ou moins impériaux. Comme si toutes les actions et les émotions se trouvaient guidées par les affects fondamentaux de la sexualité et de la prédation détachés de toute référence morale, ne gardant qu’un contenant dynamique et anhistorique. Ainsi, dans mes visions, je voyais des corps-à-corps vertigineux, des cœurs nauséeux et des culs en perpétuel désir dans une mêlée inouïe faisant table rase du passé et du présent sans aucune vision du futur. Il faut préciser ici qu’en 1974, on ne regardait pas à la dépense dans un climat de défonce générale.
Je me souviens d’avoir situé Babelle 1. Après le déluge dans un contexte anachronique. Après la soumission passée et la violence collective du peuple québécois pendant la Révolution tranquille, je voyais une future violence individuelle sans but ni fin, incarnée dans un personnage indéterminé et indéterminable, déraciné, narcissique à souhait et… anhistorique.
N’est-ce pas, chers lecteurs, ce que nous vivons aujourd’hui en Occident, cette guerre de tous contre tous dans l’enfer d’un éternel présent ?
*Renaud Longchamps voit ses œuvres complètes publiées ou rééditées chez Trois-Pistoles. En 2012, il a publié Dans la nuit blanche et noire, ouvrage qui regroupait l’ensemble de ses textes jusqu’alors parus dans Nuit blanche. En 2018, cet essai fera l’objet d’une nouvelle édition dans ses œuvres complètes (T. IX, Profanations) où il inclura ses plus récentes critiques. En plus d’Amours/Mexico, il a publié dernièrement Quelques réflexions sur le pont du Titanic. Finalement, les éditions Trois-Pistoles continueront la publication de ses œuvres complètes avec les tomes X, Confessions, et XI, Visions.
EXTRAITS
Les soldats assoupis se redressent, hument les pans de la bâche, appuient leurs joues marquées de pleurs séchés contre les ridelles surchauffées, frottent leur sexe aux pneus empoussiérés…
Pierre Guyotat, Éden, Éden, Éden.
La sentinelle roule le projecteur sur le châssis, le faisceau arde les seins qui palpitent, semés de sucre sous les pans encrassés du treillis…
Pierre Guyotat, Éden, Éden, Éden.
Je frotte ma poitrine à la toison de son sexe, une alouette y est prise ; à son cri, chaque fois que ma poitrine pèse sur le corps, jaillissent des larmes sur mes yeux ; un sang chaud ruisselle hors de mes oreilles ; la pluie d’excréments éclabousse le rocher…
Pierre Guyotat, Éden, Éden, Éden.
De sa bouche sort une langue, et comme un chat lapant son lait, il travaille l’entrecuisse d’une jouvencelle ; il lèche une grotte pourpre, luisante et veloutée ; il caresse la chose, le fantastique piège animal de l’étudiante dont la robe ressemble à un parapluie oublié dans un salon.
André Loiselet, Le mal des anges, p. 46.










