L’écriture pour Michel Ouellette est une nécessité, un besoin fondamental et incontournable. Il a d’ailleurs beaucoup écrit : dix-sept pièces de théâtre publiées, trois recueils de poèmes, trois livres pour la jeunesse, deux romans et un livre d’art. De nombreuses pièces restent inédites, bien qu’une vingtaine d’entre elles peuvent être consultées au Centre des auteurs dramatiques. Ouellette a aussi réussi ce que peu d’écrivains arrivent à faire : se réinventer constamment, tout en produisant une œuvre d’une grande cohérence.
En effet, les thèmes explorés restent les mêmes, mais ils évoluent et se transforment sans cesse. Au cœur de l’œuvre demeure une question centrale : comment comprendre les relations humaines, surtout les liens familiaux ? Dans sa thèse de maîtrise en création, il affirme d’emblée que son but est semblable à celui d’André Major : « rendre le monde lisible1 ». Il ajoute cependant : « Dans mon cas, il me faut aussi trouver unenouvelle langue afin de ‘retrouver l’illusion radicale’, une nouvelle forme pour montravail d’écriture car ‘[d]épasser une forme, c’est passer d’une forme à une autre’2. » Passer d’une forme à l’autre pour mieux cerner son objet de prédilection résume bien la pratique de Ouellette, qu’on peut diviser en trois époques : celle des années 1990, qui porte sur l’exploration des rapports familiaux et humains en lien avec l’Ontario français, surtout le nord de la province ; celle des années 2000, dont les textes plus universalistes soulignent davantage l’inspiration mythique qui a toujours traversé l’œuvre ouellettienne ; et enfin celle des écrits introspectifs des dernières années. Comme l’auteur retourne souvent à des textes qu’il a laissés en friche, les frontières entre les époques sont souventperméables.
Prise 1 : la « famille » franco-ontarienne sur les planches
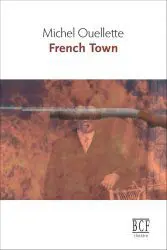 Michel Ouellette est d’abord et avant tout connu et reconnu comme dramaturge. Sa deuxième pièce de théâtre publiée, French Town, lui a valu le Prix du Gouverneur général en 1994. La pièce met en scène trois enfants d’une même famille : Pierre-Paul, l’aîné, qui a fui sa ville natale après une altercation très violente avec son père ; Cindy, la cadette, qui refuse tout ce qui est typiquement associé à la féminité ainsi qu’à la faiblesse de sa mère ; et Martin, le petit dernier, né plusieurs années après les autres et peu avant la mort du père, de sorte qu’il n’a pas subi la violence paternelle. Tous les trois se réunissent à Noël et à Pâques pour vider la maison natale à la suite du décès de leur mère. Chacun a un rapport bien différent au passé, au père, à la mère et à la maison familiale. Leur divergence d’opinion se manifeste dans leur choix linguistique : Pierre-Paul, qui a quitté French Town depuis de nombreuses années, a adopté une langue française hyper-normative qui illustre son rejet de la famille et du passé ; Cindy, qui porte les vêtements de son père et répare le vieux « pick-up truck », jure constamment en français et en anglais ; Martin, qui veut pour sa part ranimer la mémoire de ses parents, acheter la maison familiale et s’impliquer dans la communauté francophone, opte pour une langue vernaculaire, mais correcte. Au fil de la pièce, Cindy évoluera vers une acceptation de son passé, se réconciliera avec sa mère et décidera de ne plus se répandre en invectives, alors que Pierre-Paul, emprisonné dans sa langue artificielle, se suicidera.
Michel Ouellette est d’abord et avant tout connu et reconnu comme dramaturge. Sa deuxième pièce de théâtre publiée, French Town, lui a valu le Prix du Gouverneur général en 1994. La pièce met en scène trois enfants d’une même famille : Pierre-Paul, l’aîné, qui a fui sa ville natale après une altercation très violente avec son père ; Cindy, la cadette, qui refuse tout ce qui est typiquement associé à la féminité ainsi qu’à la faiblesse de sa mère ; et Martin, le petit dernier, né plusieurs années après les autres et peu avant la mort du père, de sorte qu’il n’a pas subi la violence paternelle. Tous les trois se réunissent à Noël et à Pâques pour vider la maison natale à la suite du décès de leur mère. Chacun a un rapport bien différent au passé, au père, à la mère et à la maison familiale. Leur divergence d’opinion se manifeste dans leur choix linguistique : Pierre-Paul, qui a quitté French Town depuis de nombreuses années, a adopté une langue française hyper-normative qui illustre son rejet de la famille et du passé ; Cindy, qui porte les vêtements de son père et répare le vieux « pick-up truck », jure constamment en français et en anglais ; Martin, qui veut pour sa part ranimer la mémoire de ses parents, acheter la maison familiale et s’impliquer dans la communauté francophone, opte pour une langue vernaculaire, mais correcte. Au fil de la pièce, Cindy évoluera vers une acceptation de son passé, se réconciliera avec sa mère et décidera de ne plus se répandre en invectives, alors que Pierre-Paul, emprisonné dans sa langue artificielle, se suicidera.
Par ses thèmes, l’espace mis en scène et les langues employées, French Town inscrit d’emblée l’écriture de Ouellette dans la filiation des œuvres d’André Paiement et de Jean Marc Dalpé, qui sont, à l’époque, associées à la littérature particulariste, engagée, de la prise de parole franco-ontarienne. À mon avis, le fait que Ouellette a été dramaturge en résidence au Théâtre du Nouvel-Ontario au début des années 1990 et qu’il y a adapté la pièce phare d’André Paiement, Lavalléville, a aussi généreusement contribué à sa réputation d’« écrivain du pays ». Pourtant, ce qui est mis en scène dans French Town est un drame familial bien universel, soit celui de la construction de soi au sein d’une famille où le père abuse de la mère. Qu’est-ce qu’un homme, un père, une femme ou une mère ? À qui et à quoi s’identifier ? Que l’œuvre penche plus du côté du particularisme ou du côté de l’universalisme, le processus d’écriture de French Town, dont les manuscrits se trouvent au Centre de recherche en civilisation canadienne-française, est représentatif du parcours de l’auteur. En effet, les premières versions soulignent l’intention politique de Ouellette, qui souhaitait mettre en scène l’engagement des membres d’une même famille dans les causes communautaires franco-ontariennes (l’obtention d’églises, d’écoles, de collèges et d’une université francophones), à diverses époques de l’histoire de l’Ontario français. La version finale, elle, raconte le drame familial que l’on connaît axé sur l’incommunicabilité, dont les répliques des personnages, le plus souvent des monologues en parallèle, en sont la marque la plus tangible. Certes, la critique a associé cette difficulté de dire à celle de se dire des Franco-Ontariens. La pièce devenait dès lors, pour eux, un miroir reflétant la réalité des francophones du Nord de l’Ontario. Elle déborde toutefois largement ce cadre interprétatif référentiel par la réflexion qu’elle propose sur les rapports père-fils, mère-fille et entre membres d’une même fratrie.
Les premières pièces de Ouellette portent toutes sur cette difficulté de dire, de se dire et de s’inscrire dans une généalogie familiale. Elles abordent toutes la construction du soi en rapport avec les origines familiales. Dans Corbeaux en exil (1992), cette thématique se manifeste par le désir d’écrire de Pete, qui fouille dans l’histoire de sa ville, s’inspire d’un ouvrage historique sur MacPherson (l’ancien nom de la ville de Kapuskasing) et imagine, à partir de lettres et de photos de son grand-père Simon, la vie que celui-ci menait à titre de gardien au camp de concentration de prisonniers allemands qui se trouvait dans cette petite ville du Nord ontarien. Cette pièce, incontestablement en avance sur son temps, n’a jamais été montée en dépit de sa force narrative exceptionnelle. Elle préfigure également ce qui deviendra la caractéristique principale du théâtre de Ouellette, soit le fait qu’il soit très « littéraire ».

 Presque toutes les pièces de cette première époque, qui se termine au tournant des années 2000 avec la publication de Tombeaux (1999), Requiem (2001, la suite de French Town) et Fausse route (2001), abordent la question de l’accès à la parole, le plus souvent dans un cadre familial. La plus représentative est sans aucun doute L’homme effacé (1997). Autre drame familial, cette pièce a comme personnage principal Thomas, qui quitte Sudbury afin de retrouver sa blonde qui l’a laissé parce qu’il n’arrivait pas à s’affirmer face à sa mère. Incapable de retrouver Annie, il sombre dans l’aphasie et la folie, erre dans les rues de Toronto avant d’être interné à l’hôpital psychiatrique. La pièce s’y déroule en un va-et-vient entre le présent et le passé. Thomas est un autre « fils à maman » qui n’a pas de père, comme le lui rappelle Annie : « T’as jamais connu ton père, Thomas. Parce que ta mère faisait tout pour l’oublier. Mais l’oubli ça comble pas le vide. Une question cherche toujours sa réponse. C’est pour ça que j’ai emmené Ève avec moi aujourd’hui ». Annie, qui a reconnu Thomas sur la photo que la police a publiée afin de connaître son identité, amènera leur fille lui rendre visite alors qu’il ignorait son existence. À la toute fin de la pièce, Thomas retrouve la parole grâce à sa fille et prononce son nom, Ève, mais il est trop tard, car elle est déjà sortie de scène avec sa mère.
Presque toutes les pièces de cette première époque, qui se termine au tournant des années 2000 avec la publication de Tombeaux (1999), Requiem (2001, la suite de French Town) et Fausse route (2001), abordent la question de l’accès à la parole, le plus souvent dans un cadre familial. La plus représentative est sans aucun doute L’homme effacé (1997). Autre drame familial, cette pièce a comme personnage principal Thomas, qui quitte Sudbury afin de retrouver sa blonde qui l’a laissé parce qu’il n’arrivait pas à s’affirmer face à sa mère. Incapable de retrouver Annie, il sombre dans l’aphasie et la folie, erre dans les rues de Toronto avant d’être interné à l’hôpital psychiatrique. La pièce s’y déroule en un va-et-vient entre le présent et le passé. Thomas est un autre « fils à maman » qui n’a pas de père, comme le lui rappelle Annie : « T’as jamais connu ton père, Thomas. Parce que ta mère faisait tout pour l’oublier. Mais l’oubli ça comble pas le vide. Une question cherche toujours sa réponse. C’est pour ça que j’ai emmené Ève avec moi aujourd’hui ». Annie, qui a reconnu Thomas sur la photo que la police a publiée afin de connaître son identité, amènera leur fille lui rendre visite alors qu’il ignorait son existence. À la toute fin de la pièce, Thomas retrouve la parole grâce à sa fille et prononce son nom, Ève, mais il est trop tard, car elle est déjà sortie de scène avec sa mère.
Prise 2 : retour aux sources
Au tournant des années 2000, Ouellette publie un premier roman, Tombeaux, qui s’inscrit dans la suite des pièces des années 1990 et aborde les mêmes thématiques. Le passage au genre romanesque semble être dû, à ce moment-là, à une production trop dense : le milieu théâtral franco-ontarien ne peut pas monter plusieurs nouvelles pièces à chaque année et ne peut pas ou ne veut pas monter des pièces de Ouellette à chaque saison théâtrale. Le genre romanesque, qui n’est pas régi par les mêmes contraintes, attire le dramaturge. Dans sa thèse de doctorat, Ouellette retourne au roman3 mais pour des raisons différentes. Il a alors aussi publié des poèmes dans un ouvrage collectif (Symphonie pour douze violoncellistes et un chien enragé, 2002) et un récit poétique (Frères d’hiver, 2006), qui sera mis en scène par Joël Beddows en 2011, de même que rédigé une thèse de maîtrise en création dans laquelle il a réfléchi à son processus de création. La thèse de doctorat vise plutôt à cerner son rapport aux différents genres littéraires en analysant les liens qui existent entre ceux-ci et l’évolution de la pensée scientifique à diverses époques. Ce « roman » hybride comporte des séquences rédigées sous forme de répliques, des passages très poétiques ainsi qu’une trame narrative romanesque. Il s’inscrit dans le prolongement d’Iphigénie en trichromie (2009), pièce écrite dans le cadre de la maîtrise, de La colère d’Achille (2009), de Willy Graf (2007) et du Testament du couturier (2002), qui se fondent sur la symbolique et la mythologie grecques. Le testament du couturier, par exemple, est une pièce futuriste qui met en scène un univers aseptisé où les humains craignent l’infection. Mais il s’agit aussi d’une pièce qui se fonde sur le passé, notamment la peste à Eyam au XVIIe siècle, l’« épuration » raciale du nazisme, la crise du sida, maladie que certains appelaient la « peste moderne », ainsi que la crainte des virus informatiques. L’incommunicabilité sévit dans ce monde où tout est interdit. Pour en rendre compte, Ouellette n’a conservé, dans chaque scène, que les répliques d’un personnage. Les paroles des autres doivent être déduites de ce que celui-ci dit. Cette pièce d’une grande force illocutoire a remporté le prix Trillium.
Prise 3 : les routes de l’intime

 Ces dernières années, Ouellette privilégie une écriture de l’intime qu’inaugurait en fait Frères d’hiver. Ce premier récit poétique ou recueil de poèmes (l’ouvrage oscille entre les deux) ainsi que le recueil de poèmes Pliures (2016) parlent aussi de relations familiales, mais elles sont abordées de l’intérieur. Dans Frères d’hiver, Pierre tente de comprendre le suicide de son frère Paul. Le lecteur a accès à ses réflexions, aux poèmes que Paul a écrits pour Wendy dont il est amoureux ainsi qu’aux observations de celle-ci, racontées par un narrateur hétérodiégétique. La métaphore du froid et de l’hiver convoquée par les activités hivernales que pratiquaient les deux frères durant leur enfance qualifie l’effritement des relations et de l’amour entre les frères. Dans Pliures, c’est la mort du père qui est le catalyseur de l’écriture. Ouellette explore tout ce qui l’a séparé de son père au fil des ans, y compris l’incompréhension de celui-ci face au métier d’écrivain de son fils et le silence qui caractérisait leur relation, silence désormais permanent.
Ces dernières années, Ouellette privilégie une écriture de l’intime qu’inaugurait en fait Frères d’hiver. Ce premier récit poétique ou recueil de poèmes (l’ouvrage oscille entre les deux) ainsi que le recueil de poèmes Pliures (2016) parlent aussi de relations familiales, mais elles sont abordées de l’intérieur. Dans Frères d’hiver, Pierre tente de comprendre le suicide de son frère Paul. Le lecteur a accès à ses réflexions, aux poèmes que Paul a écrits pour Wendy dont il est amoureux ainsi qu’aux observations de celle-ci, racontées par un narrateur hétérodiégétique. La métaphore du froid et de l’hiver convoquée par les activités hivernales que pratiquaient les deux frères durant leur enfance qualifie l’effritement des relations et de l’amour entre les frères. Dans Pliures, c’est la mort du père qui est le catalyseur de l’écriture. Ouellette explore tout ce qui l’a séparé de son père au fil des ans, y compris l’incompréhension de celui-ci face au métier d’écrivain de son fils et le silence qui caractérisait leur relation, silence désormais permanent.
 Que nous réserve Michel Ouellette dans les prochaines années ? Bien des surprises, je suppose. Son plus récent roman, Trompeuses lumières (2017), est un retour dans son nord natal et au thème de la parole ; il met en scène un personnage que les villageois ont nommé Lazarus car, comme un revenant, il est aphasique, amnésique, sans empreintes digitales et donc sans identité. Son arrivée suscite une quête mémorielle collective. On est cependant loin de la littérature particulariste des années 1990. Comme le dit si bien la quatrième de couverture, ce roman a des « accents métaphysiques, à la frontière de la réalité et de l’onirisme ». Il amène certainement « les villageois […] à se questionner sur l’existence même des choses et des événements », mais il incite aussi les lecteurs et lectrices à réfléchir au sens de la vie. Sa pièce la plus récente, Le dire de Di (2018), à la fois conte poétique et fable fantastique, nous transporte dans un univers sylvestre nordique et dans la vie familiale, pleine de secrets, d’une jeune fille de seize ans. Retour aux sources sans doute, mais dans une forme générique inédite, dans un style d’écriture hautement personnel et dans une langue riche, variée et imagée. Voyage dans l’imaginaire et dans la psyché humaine par l’entremise d’une exploration des liens familiaux, l’œuvre de Michel Ouellette est sans conteste l’une des plus fortes et des plus originales de l’Ontario français.
Que nous réserve Michel Ouellette dans les prochaines années ? Bien des surprises, je suppose. Son plus récent roman, Trompeuses lumières (2017), est un retour dans son nord natal et au thème de la parole ; il met en scène un personnage que les villageois ont nommé Lazarus car, comme un revenant, il est aphasique, amnésique, sans empreintes digitales et donc sans identité. Son arrivée suscite une quête mémorielle collective. On est cependant loin de la littérature particulariste des années 1990. Comme le dit si bien la quatrième de couverture, ce roman a des « accents métaphysiques, à la frontière de la réalité et de l’onirisme ». Il amène certainement « les villageois […] à se questionner sur l’existence même des choses et des événements », mais il incite aussi les lecteurs et lectrices à réfléchir au sens de la vie. Sa pièce la plus récente, Le dire de Di (2018), à la fois conte poétique et fable fantastique, nous transporte dans un univers sylvestre nordique et dans la vie familiale, pleine de secrets, d’une jeune fille de seize ans. Retour aux sources sans doute, mais dans une forme générique inédite, dans un style d’écriture hautement personnel et dans une langue riche, variée et imagée. Voyage dans l’imaginaire et dans la psyché humaine par l’entremise d’une exploration des liens familiaux, l’œuvre de Michel Ouellette est sans conteste l’une des plus fortes et des plus originales de l’Ontario français.
Michel Ouellette a publié :
Corbeaux en exil, théâtre, Le Nordir, 1992 ; French Town, théâtre, Le Nordir, 1994 ; Le bateleur, théâtre, Le Nordir, 1995 ; Cent bornes, avec Laurent Vaillancourt, livre illustré, Prise de parole, 1995 ; L’homme effacé, théâtre, Le Nordir, 1997 ; La dernière fugue suivi de Duelet de King Edward, théâtre, Le Nordir, 1999 ; Tombeaux, roman, L’Interligne, 1999 ; Requiemsuivi de Fausse route, théâtre, Le Nordir, 2001 ; Le testament du couturier, théâtre, Le Nordir, 2002 ; Symphonie pour douze violoncellistes et un chien enragé, avec Michel Louis Beauchamp et Louise Nolan, poésie, Le Nordir, 2002 ; Frères d’hiver, poésie, Prise de parole, 2006 ; Willy Graf, théâtre, Prise de parole, 2007 ; Iphigénie en trichromie suivi de La colère d’Achille, théâtre, Prise de parole, 2009 ; Fracture du dimanche, roman, Prise de parole, 2010 ; La guerre au ventre, théâtre, Prise de parole, 2011 ; ABC Démolition, théâtre, Prise de parole, 2013 ; La fille d’argile, théâtre, Prise de parole, 2015 ; Pliures, poésie, Prise de parole, 2016 ; Trompeuses lumières, roman, Prise de parole, 2017 ; Le dire de Di, théâtre, Prise de parole, 2018.
1. André Major, Le sourire d’Anton ou L’adieu au roman, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2001, p. 77.
2. Michel Ouellette, Iphigénie en trichromie suivi deEntre construction et déchéance. Réflexions sur le processus de création littéraire, thèse de maîtrise, Université d’Ottawa, Ottawa, 2004, p. 5. Michel Ouellette cite Jean Baudrillard, Illusion, désillusion esthétiques, Sens & Tonka, Paris, 1997, p. 41 et 43.
3. Ce roman a été publié aux éditions Prise de parole sous le titre de Fractures du dimancheen 2010.
EXTRAITS
PIERRE-PAUL Dans cette chambre, j’allais me réfugier. Je tirais les rideaux. J’allumais ma petite lampe de chevet que maman m’avait achetée pour m’encourager dans mes études. Et je prenais mon Petit Larousse illustré, le seul livre dans cette maison d’illettrés. Et pendant des heures je tournais les pages. J’apprivoisais les mots. Je les découvrais. Quelle chaleur ! Quel réconfort !
CINDY Stie de chambre de tabarnak ! Dans c’temps-là, je portais des maudites robes fleuries. Mais fallait pas que je les salisse. Chrisse, pouvais rien faire à cause de ça. Stie, moé, je voulais toujours courir pis jouer dans le sable. Mais c’était toujours : « Envoye, dans ta chambre ! »
SIMONE Envoye, dans ta chambre !
PIERRE-PAUL Je ne voulais pas sortir. Je cherchais un vocabulaire pour dire ma peine. Je me sauvais dans les pages de ce dictionnaire. Je goûtais, enfin, à la liberté.
[…]
PIERRE-PAUL Bientôt, mon âme se calmait. J’allais au début du dictionnaire. Je mémorisais les règles de grammaire, les tableaux de conjugaison, le pluriel des noms, les préfixes et les suffixes. Quelle joie !
CINDY J’ouvrais les rideaux. J’argardais dehors. Le bois, au loin. Pis je voyais le soleil pis les nuages. Pis je rêvais d’aventures, stie. M’imaginais sur le bord d’une crique en train de me bâtir un radeau pour faire le tour du monde. M’imaginais dans une cabane dans les arbres comme Tarzan. Ah ! Ahaha !… M’imaginais rencontrer des Indiens pis partir à la chasse avec eux autres.
French Town, Prise de parole, p. 32-34.
À dix ans, j’ai décidé de réécrire le monde, d’arrêter de lire pour commencer à écrire, parce que j’avais pris conscience de l’illusion dans laquelle je vivais, ce monde de tromperies et de mensonges dans lequel toutes les histoires sont fausses, où tous les adultes sont des imposteurs, où les enfants pleurent d’incompréhension, où j’ai pleuré. J’ai beaucoup pleuré avant d’arriver à coucher des mots vrais sur le papier. Il a fallu que je me vide de tout ce qui était faux en moi pour constater que tout au fond, à la fin des larmes, à l’épuisement de la source, il y avait quelque chose de dur, de solide, sur lequel je pouvais reconstruire, une petite île en moi, un bout de roc.
Frères d’hiver, Prise de parole, p. 17.
Vous aviez votre moulin
J’avais des mots d’automne
Embrochés qu’ils étaient
Sur des feuilles mortes
Ou dans des corps perdus
La chair meurtrie
Désespère
Claque dans mes mains
J’ai erré pendant que vous œuvriez
À la sueur de votre front
À la douleur du dos et des bras
Vos mains dans un coffre d’outils
Moi, j’enfonçais des aiguilles dans mes yeux
Pour ne pas voir plus loin que le mal immédiat
Je taisais la souffrance lointaine
Me crevant les oreilles
Pour ne pas entendre l’écho de votre douleur sourde
Qui voulait jaillir des profondeurs
De notre relation
Qui ne tenait qu’à un fil de trame
Rompu
Excusez-moi
Si j’insiste
J’ai tenu votre regard
À ce moment-là
Quand vos yeux étaient de cendre
Et que votre langue
Bois mort dans votre bouche éteinte
Ne traversait plus vos lèvres brûlées par le sel de votre vie
J’ai tenu bon
Malgré le gel
Seul le silence entre nous
Vous avez tourné la tête
Sur mes positions
J’aurais voulu prendre votre main
Prendre votre visage entre mes mains











