Que veut dire exactement écrire « sur » la Côte-Nord ? On peut rêver d’elle – sans y être jamais allé. On peut y être passé en coup de vent ou y avoir vécu peu ou prou. On peut avoir décidé de s’y installer ou y être né. On peut y avoir vécu depuis des centaines d’années. On a là les principaux cas de figures qui tracent de façon sommaire les diverses postures de ceux et celles qui écriront sur la Côte-Nord. Pour faire simple, disons que deux types de narrateurs surtout se disputent la paternité des écrits nord-côtiers. Les gens d’ailleurs, qui la découvrent pour différentes raisons, seront les premiers à écrire sur la Côte ; ils ont beaucoup écrit dans le passé, et aujourd’hui encore ils continuent à construire le corpus des textes nord-côtiers. Mais depuis la moitié du XIXe siècle, les Nord-Côtiers écrivent. Ils auront dans un premier temps le souci d’écrire leur histoire. Puis, de l’étudier. Et, plus récemment, de diverses manières, mais davantage à travers un large processus de poétisation et d’esthétisation, de la raconter et de la chanter. C’est le cas aussi bien pour les Montagnais – les Innus d’aujourd’hui – que pour les francophones et les anglophones.
Dans la plupart des textes de ceux et celles qui ont relaté leurs voyages au Canada aux XVIe et XVIIe siècles, le golfe, le fleuve Saint-Laurent, ses îles et la Côte-Nord sont présents. Cela se vérifie dans les relations de Jacques Cartier et de Champlain notamment, mais aussi dans celles du récollet Sagard et des premières religieuses qui traverseront l’Atlantique, les Hospitalières et les Ursulines – parmi celles-ci, Marie de l’Incarnation. Un endroit surtout y est nommé et décrit : Tadoussac, escale obligée avant la remontée de « la rivière » vers Québec.
Mais le fait historique qui continue depuis ce temps à séduire l’imaginaire des créateurs concerne la jeune Marguerite de Roberval, abandonnée sur une île du golfe par son oncle, Jean-François de Roberval, en 1542. Au XVIe siècle, Marguerite de Navarre, André Thevet et François de Belleforest évoqueront cette rocambolesque et tragique aventure. En 1990, Anne Hébert publiera à son tour sa pièce de théâtre, L’île de la demoiselle.
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
L’écriture missionnaire
Les premiers textes des Récollets qui parlent de la Côte-Nord sont encore mal connus, mais ceux des Jésuites le sont davantage. On les retrouve surtout dans les Relations des Jésuites, publiées entre 1632 et 1672, et dans les Relations inédites, qui relatent l’activité missionnaire sur la Côte entre 1672 et 1678. Les Jésuites sont les seuls à avoir écrit « sur » la Côte de façon régulière, sur plus de 100 ans à vrai dire, entre 1641, date qui marque les débuts des missions jésuites à Tadoussac, et 1782, date de la mort du père La Brosse au même endroit, le dernier jésuite missionnaire sur la Côte-Nord. Les textes des Jésuites sont la première grande contribution écrite au corpus nord-côtier.
L’écriture missionnaire sera une constante de l’histoire de la Côte. Elle reprendra de sa vigueur au XIXe siècle avec l’arrivée des Oblats, puis au début du XXe siècle, avec celle des Eudistes. Les textes de ces missionnaires sont encore à découvrir. On aurait tort de les considérer comme négligeables. Leur littérarité est souvent indiscutable et le lecteur d’aujourd’hui y découvre surtout des « récits », instructifs et souvent passionnants.
Parmi tous les textes écrits sur la Côte-Nord par des religieux, il faudrait aussi faire une place à ceux du premier évêque du Golfe Saint-Laurent, Mgr Labrie, qui a laissé ce que l’on pourrait considérer comme le premier grand essai nord-côtier, sa lettre pastorale, Sur la forêt (1948), un texte qui fit du bruit à son époque.
Des récits de naufrage
Les récits qui racontent des naufrages arrivés dans le Saint-Laurent et surtout dans les alentours de l’île d’Anticosti, souvent surnommée le « cimetière du golfe », sont nombreux. Le célèbre naufrage de la flotte de l’amiral Walker, en 1711, à l’île aux Œufs, sera souvent évoqué et deviendra le prétexte à bien des écrits de genres divers, aussi bien à Québec qu’à Montréal. Au siècle suivant, l’écrivain Faucher de Saint-Maurice racontera encore la célèbre légende de « L’Amiral du brouillard ».
Mais le récit le plus puissant du genre reste sans doute Lettres du père Crespel et son naufrage à Anticosti en 1736 d’Emmanuel Crespel, qui raconte le naufrage de La Renommée en novembre 1736 et le terrible hiver qui s’ensuivit pour les naufragés. Le récit parut en français, en Allemagne, en 1742, et connut ensuite un succès d’édition européen. Il ne paraîtra à Québec qu’en 1808. La plus récente réédition date de 2009.
Les premiers textes en langue montagnaise (en innu) sont publiés à Québec un peu après la conquête de 1760
Le jésuite Jean-Baptiste de La Brosse publie en 1767, à Québec, un livre en montagnais qui restera longtemps en usage chez les Innus de la Côte-Nord, le célèbre Nehiro–Irinui. Ce recueil, autant catéchisme que livre de prières, sera imprimé une première fois à 2 000 exemplaires, et quelques fois réimprimé par la suite.
XIXe SIÈCLE
La Côte-Nord à Québec
Il est intéressant de signaler qu’au moment où le « mouvement littéraire de Québec » s’organise autour des années 1860, la Côte-Nord est mise à contribution grâce à une des figures marquantes du mouvement, l’abbé historien Jean-Baptiste-Antoine Ferland, dont le récit de voyage, Le Labrador, sera publié en 1863. Ce texte est le premier à peindre, en 1858, le territoire de ce qu’on appelle aujourd’hui la Basse-Côte-Nord, plus précisément le littoral entre Mingan et Blanc-Sablon. Mais surtout, Le Labrador « poétise » la Côte pour la première fois. Il demeure aujourd’hui encore, autant par son propos que par son écriture tout en finesse, un document de première importance.
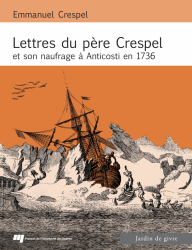
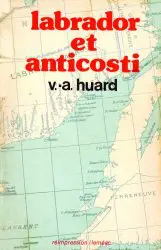 Signalons aussi que la même année 1863, Ferland publiera un autre récit, Louis-Olivier Gamache. Gamache, un personnage bien réel, que l’auteur a rencontré lors d’un voyage dans le golfe, mais dont la légende s’est emparée pour faire de lui le « sorcier de l’île d’Anticosti ».
Signalons aussi que la même année 1863, Ferland publiera un autre récit, Louis-Olivier Gamache. Gamache, un personnage bien réel, que l’auteur a rencontré lors d’un voyage dans le golfe, mais dont la légende s’est emparée pour faire de lui le « sorcier de l’île d’Anticosti ».
Après Ferland, quelques autres écrivains raconteront aussi leur voyage dans cette partie du Québec encore si lointaine et si peu connue. Faucher de Saint-Maurice évoquera la Côte et le golfe dans plusieurs de ses récits. Mais un autre texte mérite ici d’être signalé, Labrador et Anticosti, paru à la fin du XIXe siècle, de l’abbé Victor-Alphonse Huard. Ce récit raconte une expédition menée en 1895 alors que l’abbé accompagne son évêque dans sa visite pastorale. Enfin, on ne saurait oublier une œuvre majeure dont les prétentions littéraires sont nettement plus affirmées, Récits du Labrador (1894), du Français Henry de Puyjalon, qui avait fait de la Côte-Nord son pays d’adoption.
En Minganie, on commence à écrire
Parmi les fondateurs de Pointe-aux-Esquimaux – aujourd’hui Havre-Saint-Pierre – un jeune adolescent, Placide Vigneau, veut conserver la mémoire de certains faits et gestes pour qu’ils ne sombrent pas dans l’oubli. Entre 1857 et 1923, il écrira la chronique de chaque année. Ses textes seront publiés plus tard sous le titre d’Un pied d’ancre, en 1969. L’œuvre demeure de toute première importance aujourd’hui encore à cause de son contenu, mais elle nous dit surtout que, sur la Côte-Nord, on commence enfin à écrire.
XXe SIÈCLE
Des écrits en anglais
Dans le corpus des écritures nord-côtières, la contribution des textes rédigés en anglais, même si ceux-ci semblent occuper une modeste place, mérite d’être soulignée. En 1908, Napoléon-Alexandre Comeau publie Life and Sport on the North of the Lower St. Lawrence and Gulf […] – traduit en français en 1945 sous le titre de La vie et le sport sur la Côte-Nord. Mais on trouve des textes rédigés en anglais qui évoquent la Côte-Nord dès le XVIIIe siècle. Après son naufrage dans le golfe, l’amiral Walker, pour se défendre, publiera à Londres, en 1720, A Journal or Full Account of the Late Expedition to Canada. Au siècle suivant, John Uriah Gregory écrit ses récits de voyages en anglais ; un de ses manuscrits sera traduit et publié en français en 1886 sous le titre d’En racontant. Récits de voyages en Floride, au Labrador et sur le fleuve Saint-Laurent. Quant à James MacPherson Le Moine, il publie en 1878 The Chronicles of the St. Lawrence. Mais l’ouvrage le plus important de cette époque est sans doute celui de Henry Youle Hind, qui remonta la rivière Moisie avec son frère en 1861, expédition racontée dans Explorations in the Interior of the Labrador Peninsula: The Country of the Montagnais and Nasquapee Indians (Londres, 1863, 2 volumes).
Au siècle suivant, après Napoléon-Alexandre Comeau, d’autres auteurs publieront aussi en anglais. Des récits, des journaux, des témoignages, des biographies, des autobiographies et parfois des études évoqueront ou bien des événements et des personnages du passé, ou bien les développements industriels des années 1950, ou plus précisément la vie des « Coasters » de la Basse-Côte-Nord.
Doctor of the Snows (1979) évoque la vie pleine d’aventures du docteur Hodd en Basse-Côte-Nord. Charles O. Goulet et Douglas Glover restent quant à eux fascinés par la tragique aventure de Marguerite de Roberval. Le premier publie The Isle of Demons (2000) et le second, Elle: A Novel (2003) – en français, Le pas de l’ourse (2003).
Des écrits en français
Dans la première moitié du XXe siècle, la Côte-Nord reste encore une région éloignée et somme toute encore peu fréquentée. Les gens instruits qui la visitent, et qui souvent viennent de Québec, publient parfois leurs impressions de voyage où se mêlent données historiques, factuelles et impressionnistes. Ainsi, par exemple, dans La côte nord du Saint-Laurent et le Labrador canadien (1908) d’Eugène Rouillard ou dans Notes sur la côte nord du Bas Saint-Laurent et le Labrador canadien (1926) d’Edgar Rochette.
Dans la première moitié du siècle, parmi les quelques auteurs connus qui s’intéressent à la Côte, on pense surtout à Damase Potvin, qui publie par exemple Les Îlets-Jérémie en 1928, et quelques années plus tard, Puyjalon. Le solitaire de l’Île-à-la-Chasse (1938) et Le Saint-Laurent et ses îles (1941).
À cette époque, la Côte-Nord s’apprête à vivre son développement industriel. On viendra d’ailleurs pour y travailler et pour s’y réaliser. Yves Thériault commence alors son œuvre de romancier. La Côte-Nord, son peuplement, son histoire, sa géographie et son développement riche en promesses vont d’emblée l’intéresser et le fasciner. C’est d’abord l’hommage aux peuples premiers avec Agaguk et Ashini (1958 et 1960), puis des histoires de mer et de navigation qui ont pour décor le littoral et le fleuve – le golfe surtout. On pense tout de suite à deux romans : Les temps du carcajou (1965) et La passe-au-Crachin (1972). Mais c’est dans Roi de la Côte-Nord (1960), ouvrage consacré à Napoléon-Alexandre Comeau, que Thériault livre le plus clairement sa fascination pour ces jeunes qui viennent de Montréal et d’ailleurs et qui rêvent de monter vers le Nord, vers Sept-Îles et Schefferville, « race neuve » qui va fabriquer un « pays nouveau », transformant ainsi l’ancienne Terre de Caïn « en terre de richesse et de plaisance ».
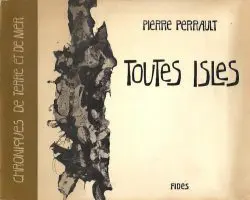
Dans les mêmes années, le cinéaste et poète Pierre Perrault filme sa série Au pays de Neuve-France, dont les commentaires alimenteront plus tard les récits de Toutes Isles. Chroniques de terre et de mer (1963).
En Minganie, quelques auteurs et non des moindres vont chacun à leur manière rendre la Basse-Côte-Nord célèbre. Gilles Vigneault dans ses chansons mettra Natashquan sur la carte du monde. Et le « poète de la Minganie », de Havre-Saint-Pierre, Roland Jomphe, fait connaître aux visiteurs du Québec et d’ailleurs les riches beautés des îles Mingan. C’est au même endroit que le jeune médecin, Jean Désy, séduit par la nature nord-côtière, amorce son œuvre écrite.
 À la même époque, la Côte-Nord s’organise peu à peu et devient objet d’études. Elle commence notamment à s’intéresser à son histoire, mais aussi aux écritures qui la concernent. Elle prend alors déjà conscience de l’ampleur historique du corpus des écritures nord-côtières, dont le point de départ est les écrits de Jacques Cartier. Ce dont atteste de façon déjà impressionnante La Côte-Nord dans la littérature. Anthologie (1971) de Mgr René Bélanger, qui voulait déjà « étudier la littérature en fonction de l’histoire et de la géographie ».
À la même époque, la Côte-Nord s’organise peu à peu et devient objet d’études. Elle commence notamment à s’intéresser à son histoire, mais aussi aux écritures qui la concernent. Elle prend alors déjà conscience de l’ampleur historique du corpus des écritures nord-côtières, dont le point de départ est les écrits de Jacques Cartier. Ce dont atteste de façon déjà impressionnante La Côte-Nord dans la littérature. Anthologie (1971) de Mgr René Bélanger, qui voulait déjà « étudier la littérature en fonction de l’histoire et de la géographie ».
La « nouvelle » Côte-Nord fascine aussi les créateurs étrangers. Henri Vernes transporte son héros sur les grands chantiers d’Hydro-Québec dans Terreur à la Manicouagan (1960). Bernard Clavel publie L’homme du Labrador (1982). L’Écossais Kenneth White visite la Côte et écrit La route bleue (1983), qui sera récompensé par le prix Médicis étranger. Quelques années plus tard, Laure Morali refera pour ainsi dire le même trajet que White dans La route des vents (2002).
L’écriture montagnaise s’affirme
Après la mort du jésuite La Brosse, les Montagnais de la Côte-Nord continuent de prier dans leur langue. En 1844, l’oblat Durocher fera rééditer pour la troisième fois le Nehiro-Irinui du jésuite. Les Montagnais sont donc désormais en mesure de lire leur langue, ce que confirment les nombreux témoignages de visiteurs. On dit même que certains écrivent de courtes lettres en montagnais. Deux siècles de traduction auront permis par conséquent aux autochtones de la Côte-Nord de découvrir leur langue autrement, en la lisant et en l’écrivant.
Cette maîtrise de la langue va leur permettre de revendiquer et de s’affirmer aux XVIIIe et XIXe siècles à l’occasion de pétitions, de lettres et de requêtes. Très vite cependant, les chefs montagnais vont réaliser que pour être compris, pour être efficaces, ils doivent aussi écrire dans les langues des maîtres, le français ou l’anglais.
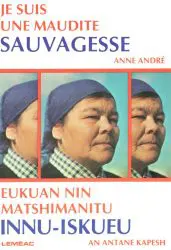 Le début du XXe siècle verra s’accentuer la dépossession territoriale et culturelle. Mais le Livre blanc de 1969 fera réagir et mobilisera les énergies. Les Amérindiens se mettront alors à écrire dans les revues et les journaux. Le lectorat visé désormais n’est plus le même : on ne veut plus seulement s’adresser aux autorités, mais à tous les Blancs, d’ici ou d’ailleurs. Chez les Montagnais-Innus, entre 1972 et 1990, paraîtront une dizaine de textes, notamment ceux des Albert Connolly, Mathieu André, Pierre Gill et Bernard Cleary. Mais une œuvre surtout se démarque, qui dérange, écrite par une femme, et qu’il faut lire absolument, Je suis une maudite sauvagesse (1976) d’An Antane Kapesh (Anne André).
Le début du XXe siècle verra s’accentuer la dépossession territoriale et culturelle. Mais le Livre blanc de 1969 fera réagir et mobilisera les énergies. Les Amérindiens se mettront alors à écrire dans les revues et les journaux. Le lectorat visé désormais n’est plus le même : on ne veut plus seulement s’adresser aux autorités, mais à tous les Blancs, d’ici ou d’ailleurs. Chez les Montagnais-Innus, entre 1972 et 1990, paraîtront une dizaine de textes, notamment ceux des Albert Connolly, Mathieu André, Pierre Gill et Bernard Cleary. Mais une œuvre surtout se démarque, qui dérange, écrite par une femme, et qu’il faut lire absolument, Je suis une maudite sauvagesse (1976) d’An Antane Kapesh (Anne André).
Il faudra attendre presque quinze ans avant que paraisse le premier recueil de poésie, de Rita Mestokosho, Eshi uapataman nukum (1995).
Mais la chanson innue avait pris son envol dès 1984 avec les textes des Florent Vollant, Claude et Philippe McKenzie. Kashtin paraîtra en 1989. Le désormais célèbre festival Innu Nikamu – fondé en 1984 – fêtera son 35e anniversaire en 2019. Depuis, de nouveaux chansonniers se sont fait connaître. Parmi eux, Matiu et Shauit.
ET AUJOURD’HUI ?
La littérature innue occupe le devant de la scène
 Au début du siècle, les travaux de Maurizio Gatti sur la littérature amérindienne (2004 et 2006) et l’anthologie dirigée par Laure Morali, Aimititau ! Parlons-nous ! (2008), sont des signaux annonciateurs : le paysage littéraire québécois ne sera plus le même désormais. Les femmes innues qui écrivent ont leur nom dans l’anthologie de Laure Morali, mais on les connaît encore peu. Et voilà que l’année suivante, Joséphine Bacon apparaît dans l’actualité littéraire pour ne plus la quitter, avec son recueil Bâtons à message / Tshissinuatshitakana (2009).
Au début du siècle, les travaux de Maurizio Gatti sur la littérature amérindienne (2004 et 2006) et l’anthologie dirigée par Laure Morali, Aimititau ! Parlons-nous ! (2008), sont des signaux annonciateurs : le paysage littéraire québécois ne sera plus le même désormais. Les femmes innues qui écrivent ont leur nom dans l’anthologie de Laure Morali, mais on les connaît encore peu. Et voilà que l’année suivante, Joséphine Bacon apparaît dans l’actualité littéraire pour ne plus la quitter, avec son recueil Bâtons à message / Tshissinuatshitakana (2009).
Puis ce sera, dans les années qui vont suivre, ce que la critique a parfois appelé l’arrivée « en fanfare » des littératures des Premières Nations. Chez les Innus, ce sont les femmes surtout qui écrivent et publient. Il faut les nommer : Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Natasha Kanapé Fontaine, Marie-Andrée Gill, Rita Mestokosho, Manon Nolin et quelques autres. Les publications seront désormais plus nombreuses et plus régulières. Pour l’instant, un genre littéraire surtout semble mobiliser les énergies, la poésie.
Et chez les francophones et les anglophones?
Chez les anglophones, Cléophas Belvin trace un portrait historique de la Basse-Côte-Nord dans The Forgotten Labrador: Kegashka to Blanc-Sablon (2006). Et plus récemment, Clarissa Smith évoque son enfance dans Broken Wings (2009).
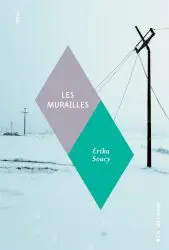
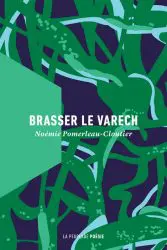 Quant aux auteurs d’expression française, certains plus âgés et d’autres très jeunes, originaires de la Côte ou d’ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à représenter la région de la Côte-Nord dans des productions souvent originales où se côtoient les principaux genres littéraires. Les œuvres les plus récentes sont, comme celles qui paraissent aujourd’hui au Québec, fortement marquée du sceau de la modernité. Contentons-nous de citer quelques noms que nous classons ici par ordre alphabétique : Maxime Allen, Camille Bouchard, Hélène Bouchard, Serge Bouchard, Myriam Caron, Francine Chicoine, Christine Cormier, François X Côté, Jean Désy, Nicolas Dickner, Germaine Dionne, Philippe Ducros, Monique Durand, Gilbert Dupuis, Rodolphe Gagnon, Vital Gagnon, Simon Harel, Claude Jasmin, Arthur Lamothe, Claude Marceau, Pascal Millet, Laure Morali, Michel Noël, Noémie Pomerleau-Cloutier, Jacques Poulin, Gérard Pourcel, Emmanuelle Roy, Erika Soucy, Jean-Yves Soucy, Denis Thériault, Jennifer Tremblay, France Vézina, Michel Vézina, René Viau, Marco Vigneault, Wajdi Mouawad.
Quant aux auteurs d’expression française, certains plus âgés et d’autres très jeunes, originaires de la Côte ou d’ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à représenter la région de la Côte-Nord dans des productions souvent originales où se côtoient les principaux genres littéraires. Les œuvres les plus récentes sont, comme celles qui paraissent aujourd’hui au Québec, fortement marquée du sceau de la modernité. Contentons-nous de citer quelques noms que nous classons ici par ordre alphabétique : Maxime Allen, Camille Bouchard, Hélène Bouchard, Serge Bouchard, Myriam Caron, Francine Chicoine, Christine Cormier, François X Côté, Jean Désy, Nicolas Dickner, Germaine Dionne, Philippe Ducros, Monique Durand, Gilbert Dupuis, Rodolphe Gagnon, Vital Gagnon, Simon Harel, Claude Jasmin, Arthur Lamothe, Claude Marceau, Pascal Millet, Laure Morali, Michel Noël, Noémie Pomerleau-Cloutier, Jacques Poulin, Gérard Pourcel, Emmanuelle Roy, Erika Soucy, Jean-Yves Soucy, Denis Thériault, Jennifer Tremblay, France Vézina, Michel Vézina, René Viau, Marco Vigneault, Wajdi Mouawad.
On ne saurait enfin passer sous silence un phénomène qui a profondément marqué la vie littéraire nord-côtière des dix dernières années : grâce à Francine Chicoine, le Camp littéraire de Baie-Comeau a permis à de nombreuses personnes de la Côte et d’ailleurs d’écrire et de publier des haïku – de nombreuses publications des éditions David d’Ottawa en témoignent. Ce n’est pas exagéré de dire que Baie-Comeau a été pendant quelques années « la capitale du haïku » au Québec. Hélène Bouchard, une fidèle du camp littéraire, continue à Sept-Îles les travaux commencés à Baie-Comeau par Francine Chicoine.
EXTRAITS
[J]e fus éveillé brusquement par le tapage inaccoutumé de la manœuvre et par les bonds auxquels se livrait notre yacht sur une mer qui devait être bien houleuse. […] Nous longions la côte de l’Anticosti, et nous n’avions plus qu’une dizaine de milles à parcourir pour arriver à la baie des Anglais, lorsque soudain s’éleva une bourrasque de vent d’ouest qui rendit notre course en avant absolument impossible. Nous n’avions plus qu’à virer de bord et à chercher un refuge quelque part. Mais les refuges sont rares sur cette côte de la grande île, et c’est ce qui rend la navigation si dangereuse en ces parages.
V.-A. Huard, Labrador et Anticosti, Leméac, 1972 [1897], p. 194.
Ceux qui habitent la Côte Nord ont conscience d’être à l’un des endroits les plus beaux du monde. Ils n’ont que faire de maudire un peu de froid l’hiver. Et puis, le froid, c’est le gel du muskeg pour ceux qui vont loin en forêt. C’est l’immobilisation des fleuves et on y peut voyager en toute aise.
Yves Thériault, Roi de la Côte Nord, L’Homme, 1960, p. 36.
On a connu des soirs d’hiver
À la chandelle ou sans lumière
Par les grands bois
Par les grands froids
On a connu bien des journées
En regardant dans les marées
Par les grandes voiles
Par les étoiles
On a connu lunes nouvelles
À y attendre des nouvelles
Sur le chemin
Sur le destin
Roland Jomphe, Amour et souvenance au cœur de Minganie, 1986, p. 89.
[I]ls habitent une rivière et mille branches d’un pays semé de mollières, de chablis, de sphaignes élucubrant les tourbes, d’arbres tordus par les vents épineux, de kalmia tressés où les mouches se dressent au passage.
Pierre Perrault, Toutes isles, L’Hexagone, 1990 [1963], p. 176-177.
Je pleure, je vide
Mon âme
De souffle court
Assez pour respirer
Pour espérer…
Nutshimit la vraie terre
Menashkuau la forêt
Ka uishamit qui m’appelle
Nitapin Je m’assois
Tshetshi mishkaman pour trouver
Tshiaminiun la paix
Je me suis fait belle
Pour qu’on remarque
La moelle de mes os
Survivante d’un récit
Qu’on ne raconte pas
« Joséphine Bacon à José Acquelin » dans Aimititau ! Parlons-nous !, Mémoire d’encrier, 2008, p. 310-311.
Les caribous
les bisons les chevaux
les cerfs viendront
avec la terre
noyer les oléoducs
Nous brûlerons
les écoles résidences
les papiers lois
Nous incarnerons
un feu immense.
Natasha Kanapé Fontaine, Manifeste Assi, Mémoire d’encrier, Montréal, 2014, p. 64.











