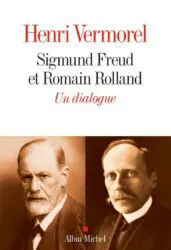L’ouvrage1 impressionne dès l’abord par son volume, la somme de documentation et de connaissances qu’il contient, l’effort de synthèse qu’il représente et la complexité des questions qu’il soulève. L’entreprise est conduite avec sérieux mais son ambition semble parfois avoir débordé son auteur, ce qui, en maints passages, en rend la lecture difficile. Nous sommes ici dans le monde de la psychanalyse, dont Henri Vermorel est en France un vieux routier, etil ajoute à ce savoir une longue pratique de la psychiatrie. Donc un livre à ne pas mettre entre toutes les mains… Face au rapport entre Romain Rolland et Sigmund Freud, libre au lecteur de juger les interprétations pertinentes, éclairantes, ou forcées.
L’échange de lettres – relativement peu nombreuses mais substantielles – commence en 1923 pour s’achever en 1936 (Freud de dix ans l’aîné de Rolland mourra en 1939 et celui-ci en 1944). Quand la correspondance s’engage, Rolland est un écrivain célèbre en France et au-delà des frontières, mais il a défendu la cause du pacifisme pendant la Première Guerre dans son article « Au-dessus de la mêlée », ce qui lui valut beaucoup d’ennemis et de violentes attaques pour trahison envers la patrie. Freud de son côté élabore les principes clés de la psychanalyse qui se cherche encore. L’ombre toujours présente de la guerre, achevée mais mal achevée car elle engendre l’illusion de la paix, va s’épaissir par celle des totalitarismes fasciste et nazi et se faire de plus en plus menaçante.
Au-delà des rapports personnels entre les deux écrivains, il fallait donc largement retracer le contexte : l’ouvrage s’y emploie et y réussit. Mais d’autres intervenants paraissent dans ces rapports. Stefan Zweig en première ligne, écrivain déjà très connu et répandu, ayant l’art de rapprocher les intellectuels de son temps. Le duo initial où chacun constituait un puissant foyer de pensée devient donc un trio qui, à son tour, à l’occasion de lettres ou de visites, s’ouvre vers Rainer Maria Rilke, Maxime Gorki, Jean-Richard Bloch, Thomas Mann et bien d’autres, pour des échanges épisodiques mais toujours marquants. Ainsi se tisse un réseau serré d’échanges. En suivre les ramifications oblige Henri Vermorel, soucieux du détail, à des retours en arrière où le lecteur s’égare un peu, à des développements récapitulatifs parfois lents et redondants (par exemple la visite à Vienne de Romain Rolland à Freud, ou le voyage de celui-ci à l’Acropole). De toute évidence l’ouvrage aurait gagné à être élagué et allégé, à s’en tenir plus rigoureusement au sujet central mais on devine bien que l’auteur a voulu en faire une synthèse historique et celle de son expérience propre de la psychanalyse. Il présente donc plusieurs ouvrages en un seul.
Zweig incite en vain Freud à écrire son autobiographie. Rolland a en quelque sorte écrit la sienne, transposée dans son long roman Jean-Christophe. Le thème de la création revient souvent dans la correspondance – et on peut noter à travers la traduction la belle plume élégante de Freud, qui ne dédaignait pas le style. Il y discute à maintes reprises de l’épilepsie et de l’hystérie chez les créateurs, question qui aujourd’hui paraît datée. Les deux hommes ont été incontestablement et explicitement stimulés en profondeur dans leur création par le jeu de « l’écriture en miroir », qui relève du rapport entre les inconscients. Le transfert y joue un rôle majeur – pour le plus grand profit d’une lecture psychanalytique ! Parler d’estime, voire d’admiration réciproque est insuffisant : il s’agit d’une véritable fécondation, comme le prouve le nombre d’écrits composés par l’un et l’autre pendant toute la durée de leur dialogue.
Cet ouvrage tend en fait à devenir un exposé de la pensée de Freud dans lequel en certains chapitres se raréfient les références à Rolland. Un portrait aussi qui insiste sur son penchant à la persécution, curieusement alimenté chez cet esprit rationnel par la « mystique » des nombres et des dates fatidiques. S’y ajoutent une intolérance à la critique (qui jouera un rôle dans la rupture avec Jung), une propension aux évanouissements et une obsession de la mort.
L’échange atteint sa plus haute intensité quand il porte sur la religion, la « mystique juive » entrant en résonance avec la tradition chrétienne et avec la « germanité » (la référence à Goethe est constante). Freud, on le sait, faisait profession d’athéisme souvent réaffirmé. Sans se considérer comme chrétien, Rolland s’ouvrait à une spiritualité diffuse et étrangère aux dogmes mais très présente qui trouvait son expression dans la création artistique : son Jean-Christophe doit beaucoup à Beethoven. En ses dernières années il tournera son attention vers un Orient mystique, et néanmoins agissant dans l’orientation concrète de la vie, incarné par Gandhi avec qui Rolland, infatigable épistolier, entretiendra une correspondance. Sous cet angle, le point central de la correspondance avec Freud porte sur ce que celui-ci nomme « le sentiment océanique » qui submerge la personne, « le fait simple et direct de la sensation de ‘l’éternel’ (qui peut très bien n’être pas éternel, mais simplement sans bornes perceptibles, et comme océanique » (lettre de Rolland du 5 décembre 1927). Freud répond le 20 juillet 1929 : « Dans quels mondes étrangers pour moi n’évoluez-vous pas ! Je suis fermé à la mystique tout autant qu’à la musique ». Expérience étrangère à Freud donc mais qui en est plus qu’intrigué, déçu de ne pas la connaître et presque envieux de savoir que Rolland y a accès. Cependant le « sentiment d’étrangement » qu’il a éprouvé sur l’Acropole s’en approche sans doute.
Cette correspondance a donc conduit très loin le dialogue de deux écrivains et êtres hors du commun. Malgré ses lacunes et ses maladresses, l’étude d’Henri Vermorel (je souligne les termes de sa conclusion) démontre que « le chemin de Freud peut apparaître chez l’homme de la modernité, comme une quête du sacrédans l’inconscient individuel où il s’est réfugié après la mort de Dieu, ce qui donne au mode de pensée de la psychanalyse un caractèrerationnel renforcé par la passion, […]ravivé par les échanges avec Romain Rolland ».
1. Henri Vermorel, Sigmund Freud et Romain Rolland. Un dialogue, Albin Michel, Paris, 2018, 629 p. ; 44,95 $.